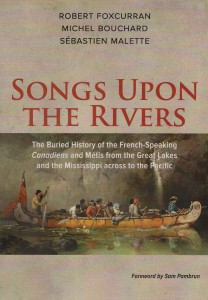Mise en contexte : Le matin du 24 novembre, j’ai reçu un courriel qui m’a abasourdi. L’un de mes amis les plus chers venait de mourir. Il fallait s’y attendre, car cela faisait plusieurs années qu’il combattait avec acharnement cette maladie qui nous effraie tous, s’offrant aux protocoles expérimentaux pour prolonger sa vie et en souffrant les conséquences. Rémi m’a fait l’honneur de prendre la parole à ses funérailles qui ont eu lieu le samedi 26 novembre en la chapelle de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avenue Pierre-Bertand, à Québec. Voici donc les quelques remarques que j’ai livrées ce jour-là pour rendre hommage à ce grand ami qui était, à bien des égards, le frère que je n’ai jamais eu.
Ce carnet de voyages et rencontres en Franco-Amérique n’est peut-être pas la meilleure place pour en parler. Cela fait plus d’un mois que j’y pense. Il y a quand même une certaine logique. Rémi était l’un des premiers étudiants que j’ai rencontrés à l’Université Laval. Ni lui ni moi ne pouvions nous imaginer à ce moment-là l’influence que l’un en viendrait à exercer sur l’autre, et cela pendant une quarantaine d’années, au Québec et ailleurs.
Alors, je suis fier de vous présenter mon ami, Rémi Tremblay, disparu depuis peu. Je vous demanderais de me pardonner un récit aussi personnel et intime.
Rémi Tremblay, un homme d’exception

Québec, 1971. Moi et ma famille venions de nous installer à Québec, immigrants des États-Unis. J’avais été engagé comme professeur de géographie à l’Université Laval. L’une de mes premières tâches fut de participer à un cours intitulé « Cas géographiques ». À tour de rôle, de semaine en semaine, un professeur se présentait devant les étudiants de première année pour parler de ses recherches. Puisque je venais d’écrire une thèse de doctorat à l’Université de Washington sur la croissance et la diffusion de l’Église mormone aux États-Unis entre 1850 et 1970, j’ai choisi de leur en parler. Je n’y ai pas ressenti un grand intérêt de leur part et suis retourné à mon bureau après un peu déçu. Tout à coup, un jeune homme de 20 ans fit irruption dans mon bureau en me saluant et en disant : « Hé, merci, c’était ben intéressant ça, c’est la première fois que j’entends parler des Mormons ! » Je lui demande son nom, « moi, mon nom, c’est Rémi Tremblay ! » et il est parti et je ne l’ai pas revu. Il a quitté la géographie après un an pour étudier en droit. C’était son droit !
Québec, 1978, sept ans plus tard. Je rentre en ville à la suite d’une année sabbatique passée en Louisiane. Un dimanche, en arrivant à la chapelle située au 765 Boulevard Charest Ouest, je vois plusieurs nouveaux visages dont deux particulièrement attrayants. Il s’agissait de ceux de Rémi et d’Hélène qui, après des mois et des mois d’études et de prières, avaient décidé de tenter leur chance auprès de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et quelle chance que ce fut…et pour eux et surtout pour nous ! Rémi m’a vite rappelé notre seule rencontre d’il y a sept ans : « Tu vois, j’avais retenu quelque chose de ta causerie ! »
Quand je pense à l’historique de la foi mormone à Québec, deux noms surgissent : celui de Jerald Izatt qui a semé une graine en 1970 et celui de Rémi Tremblay, venu dix ans plus tard, soigner le jardin laissé légèrement à l’abandon afin de le restaurer en beauté et toujours avec un souci particulier pour les jeunes de la génération montante. Ces bâtisseurs sont partis maintenant à moins de deux ans d’intervalle. L’Église mormone à Québec leur doit tant. Personne, à mon avis, n’a autant fait à Québec pour l’Église et ses membres que celui dont nous célébrons aujourd’hui la vie.
Hier, j’ai vérifié les médias sociaux pour voir ce que les gens disaient de la disparition de Rémi. J’y ai glané une dizaine de commentaires. Sans exception, c’étaient des commentaires des jeunes, de deux générations différentes, qui avaient été influencés par cet homme. Je les cite :
1ière génération
J’ai tellement de bons souvenirs et des moments heureux de jeunesse passés avec lui. Quelle profonde tristesse. (Michael Landry)
J’ai le cœur très lourd. Rémi faisait partie intégrante de ma jeunesse. (Jolyn Louder)
Hélène et Rémy occupent une partie considérable de mes souvenirs d’enfance. Ils me sont très chers. (Lysanne Louder)
Cher Rémi, parti trop jeune et trop vite. (Anne Baillargeon)
Rémi, Rémi, Rémi, t’es ben beau répondit l’écho. (rappel d’une chansonnette d’Anne Baillargeon, Lucie Garneau et Jolyn Louder)
A great, great man. (Katee Louder)
2e génération
Je suis triste d’apprendre la nouvelle. Il fait un peu partie de notre famille à Québec. (Xavier Louder)
Un autre phare qui s’en va, mon second père en quelque sorte. Au delà de toutes ses qualités, je n’oublierai jamais sa générosité inégalable et le fait qu’il s’est tellement oublié pour les autres. Et il aimait tellement la vie et ses deux princesses. (J-P Dion)
Repose en paix, Rémi. Tu peux maintenant te reposer de ton gros combat et continuer de veiller d’en haut sur tous les jeunes à qui tu as tant donné. Merci de m’avoir aidé à remettre la main sur la barre de fer. (Philippe LeBlanc)
Repose en paix, cher Rémi. Tu vas nous manquer. Tu étais une personne gentille, drôle, généreuse et tu étais un modèle pour tout le monde ! On t’aime. (Mariana Ferland)
Les Saints des Derniers Jours appellent leur lieu de culte « La Maison de Dieu ». C’est bien, c’est respectueux, c’est sûrement vrai. Mais si nous sommes ici aujourd’hui assis dans ce bel édifice, nous le devons à Rémi Tremblay. Nous sommes peut-être dans la Maison de Dieu, mais nous sommes également dans la Maison de Rémi. Il a trouvé le site ; il en a recommandé l’achat, il a géré le projet de construction et il a surveillé les travaux !
Ce que Rémi aimait, j’ai essayé d’en dresser une liste partielle :

- Comme J-P l’a dit, il aimait ses « princesses ». Je me souviens d’une promenade avec Rémi. Où ? Je ne m’en souviens plus. Bois de Coulonge peut-être ou les Plaines ou le Domaine de Maizeret. Je sais que c’était un bel endroit et j’écoutais un Rémi, très sérieux, exprimer tout l’amour qu’il avait pour elles, ses princesses, et l’inquiétude qui l’habitait de l’avenir si quelque chose devait lui arriver. Un amour de jeunesse devenu un amour profond, respectueux et compréhensif. Plusieurs années de vie de couple vécues dans l’espoir de voir arriver un enfant et, enfin, l’enfant tant attendue qui arrive apportant avec elle de la joie insoupçonnée et inimaginable. Cette belle fille tout à fait spéciale n’aurait pas pu mieux tomber que dans cette famille.
- L’Évangile de Mathieu nous raconte qu’un jour on a demandé à Jésus, « Seigneur, quel est le plus grand commandement ? » Jésus répondit, « Tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Rémi aimait-il Dieu ? Nicolas Beaubien, l’évêque de la paroisse vient de nous dire que Rémi avait sans cesse servi Dieu depuis 30 ans. À deux reprises et pour une période de plus de dix ans, il a occupé les postes qui sont, à mon avis, les importants dans la hiérarchie de notre église, ceux de Président de branche ou d’Évêque. C’est dans ces cadres-là, surtout, que l’on doit composer avec les problèmes réels des gens. J’aimerais que chaque personne dans cette salle à qui Rémi Tremblay ait rendu service lève la main. S’il vous a rendu plus d’un service, levez l’autre main ! Voyez-vous ? Il n’y a plus rien à dire à ce sujet ! Rémi, de toute évidence, a respecté sans faille les deux plus grands commandements.
- Rémi aimait voyager : chez son frère, Robert, en France, au pied des Alpes ; à son condo en Floride dont il n’a pas eu le loisir de profiter autant qu’il aurait voulu et qu’il avait obtenu grâce à son ancien patron, Serge, de multiples voyages en ma compagnie dont je voudrais vous en faire part de deux. D’abord, celui en Caroline du Nord. J’avais dit à Rémi que j’y allais pour participer à un congrès de l’Association américaine d’études religieuses. Il me dit : « ah oui, ça m’intéresse, je peux-tu y aller ? » « Mais oui », je réponds, « allons-y ». En arrivant, un peu pressés, on s’entend pour que j’aille nous inscrire et qu’il s’occupe de la location d’une voiture parce que nous avions envie de profiter du séjour pour visiter les grandes universités de la région : North Carolina, North Carolina, Wake Forest et Duke. Rémi tenait aussi à voir le stade à Charlotte où évoluaient les Panthers. On s’est donnés rendez-vous 45 minutes plus tard. L’inscription faite, je sors et je vois Rémi arriver au volant d’une Lincoln Continentale. « C’est tout ce qu’ils avaient » m’a-t-il dit, sourire en coin. Un voyage à Salt Lake est à un Saint des Derniers Jours ce que est une visite au Vatican pour un catholique ou un pèlerinage à la Mecque pour un musulman. En 1983, Rémi et Hélène et quatre autres amis de Québec (Lucille-Anne Landry et son fils, Michael, Robert Lavoie et la vieille Germaine Comtois) entreprirent le hajj mormon en notre compagnie. Nous avons parcouru l’État de l’Utah à visiter les merveilles naturelles et les sites historiques, mais ce dont je me souviens le plus, c’est la fête des noces d’or de mes parents. Du Québec, nous avions apporté des aliments que les gens là-bas ne connaissent pas : divers fromages, multiplicité de pâtés et de terrines. Nous avons tout étalé sur une longue table pour que les convives en prennent. Rémi s’est placé en arrière de la table et a sorti son meilleur anglais pour aider les amis de mes parents à faire leur choix. Il a assumé, sans qu’on ne lui demande, un rôle clé à cette fête, lui a donné un ton non seulement jovial et festif, mais français. Le plus drôle, c’est qu’un mois plus tard, un ami de mon père l’a appelé pour lui demander le nom de son traiteur parce qu’il désirait en engager le même.
- Rémi aimait les Canadiens de Montréal et les Remparts de Québec. À l’apogée de la grande rivalité Canadiens/Nordiques, Carole Turcotte et moi avons tout essayé pour convertir Rémi, ce petit gars qui avait depuis toujours adoré la Sainte-Flanelle, en Nordique. Rien à faire ! Alors, jeudi soir, lorsque j’ai allumé la télévision pour regarder le match Canadien/Caroline joué au Centre Bell, j’étais en droit de m’attendre à ce qu’il y ait un moment de silence à la mémoire du Fan no. 1 des Canadiens de Montréal. Mais il n’y en a pas eu ! Depuis que les Remparts existent, Rémi et son frère, Aurélien, sont détenteurs de billets de saison. Maintenant, qui va accompagner Aurélien au Centre Vidéotron pour encourager les jeunes hockeyeurs, haranguer les entraîneurs et maudire les arbitres ?
- Rémi aimait son pays, le Québec. Cet été, il a eu 65 ans et, par conséquent, devint admissible à recevoir la pension de vieillesse du Canada. Il me dit, « hé, j’ai eu mon premier chèque du Fédéral ». Je réplique, « t’as pas honte, t’es pas gêné d’accepter du fric du Canada ? » « Mé voyons, Dean, ça fait plus de 40 ans que j’envoie mon argent à Ottawa, il était temps qu’on commence à me rembourser ! »
- Rémi aimait recevoir. Oui, les individus chez lui, comme les jeunes missionnaires, les membres de la famille et parfois les parfaits étrangers. Il aimait aussi recevoir les groupes, pas à sa table, mais pour leur montrer sa ville. Combien de fois a-t-il reçu une demande en provenance des Saints des Derniers Jours aux États-Unis pour leur organiser le gîte et faire une visite de Québec et sa région ? Il m’appelait et disait. « viens-t-en, j’ai besoin de toi, on reçoit des Yankees ». Pourquoi aimait-il faire cela ? Pour rendre service, certes, mais aussi parce qu’il était fier du Québec, de Québec, de sa culture, de son peuple. Il savait que le Québec était différent, spécial, unique et désirait partager cette réalité avec tous ceux et celles qui voulaient bien l’entendre. Rémi, de Jonquière, du Saguenay, Québécois pure laine, s’il y en a, et fier de l’être.
Terminons sur les paroles d’un autre fier Québécois, mort récemment à l’âge de 100 ans, le père Benoît Lacroix, dont je garde toujours un livre à la portée de la main. Je vous fais lecture des extraits de son poème intitulé « Le Chemin » :
Mais on a un chemin à suivre
Aller rejoindre ceux qui nous écoutent
Aller où on doit aller et rencontrer les gens
Le chemin de la vie
Le chemin le plus long à vivre
Trop pressé d’arriver avant de partir
Relié à des horaires
On a peur d’inventer des chemins
J’ai des souvenirs nostalgiques reliés à la campagne
Chemin désert près du bois
Un événement beau à vivre
Mon père disait : on va ouvrir le chemin en premier
Inventer son chemin
Battre son chemin avant de le trouver
Ces événements sont significatifs.
Si un chemin n’est pas ouvert
Si on ne sait pas où on va c’est pénible
On n’ouvre pas le chemin seulement pour soi
On l’ouvre pour tous ceux et celles qui vont le prendre…
Rémi savait d’où il venait ; il savait où il allait et il était toujours en avant en train d’ouvrir ou de débrousailler le chemin.
Actes de courage, d’attente
Des amitiés où la route est difficile
L’avenir est là, il nous attend
On ne peut l’éviter
Il est au bout de mon présent
Annexé à mon passé.
S’habituer à réinventer son chemin
Quotidiennement j’avance sur le chemin du bonheur
Bonheur jamais parfait
Malheur jamais définitif
il y a bonheur partout
Il y a peine partout
La vieillesse est un risque
Au bout de la vieillesse, une échéance inévitable
Tunnel de la fin de ma vie
Si j’entre dans le chemin.
J’ai appris à corriger mes erreurs
Nous sommes plus forts
Nous sommes meilleurs que le découragement, l’échec
La route est en avant, pas en arrière
Le pire est en arrière
Courage–Amitiés—Espoir
Voilà l’héritage que le père Lacroix nous a laissés. Voici le legs spirituel que nous laisse mon frère, Rémi Tremblay.