Mais quelle Amérique? Celle des nomades des temps modernes, celle des caravaniers à temps plein…et celle d’une Amérique blanche!
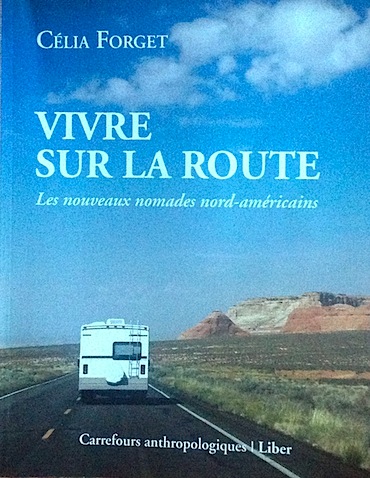
Un vrai délice cette étude ethnographique réalisée par Célia Forget dans le cadre de son doctorat effectué en cotutelle à l’université Laval et à l’Université de Provence sur une forme de mobilité continentale élaborée par les gens qui répondent à l’appel de la route et qui cherchent à être mobiles tout en restant chez eux. L’objectif de Vivre sur la route, version condensée de la thèse, est d’amener le lecteur en voyage à la découverte de cette population nomade. Pour mettre son étude en contexte, Forget cite les œuvres littéraires de Jack Kerouac (On the Road) et de John Steinbeck (Travels with Charley, Raisins de la colère), mais oublie celle plus près de nous de Jacques Poulin (Volkswagen Blues). Qui plus est, elle fait allusion à la myriade de voyages et de reportages entrepris à travers les États-Unis, en bus reconverti, par le légendaire journaliste télévisuel, Charles Kuralt, mais oublie ceux de l’ancien entraîneur de football professionnel, devenu commentateur sportif, John Madden qui, ayant peur des avions, préférait se déplacer de stade en stade, semaine après semaine, dans le « Madden Cruiser », un bus reconverti selon ses propres spécifications, portant l’effigie du « Joueur (NFL) de la semaine ». Malgré cette petite déficience et une défaillance linguistique que j’identifierai plus loin, Célia réussit son pari avec brio. En lisant ce petit livre captivant de 222 pages, j’avais envie, soit d’embarquer avec elle, soit de retourner moi-même là où j’ai tant de merveilleux souvenirs—sur la route
L’auteure prétend (page 100) que « la société nord-américaine, et principalement la société américaine, vit dans un climat de peur incessant entretenu par les médias ». Si tel est le cas, il faut admirer le courage de la chercheure qui, dans un premier temps, a sollicité un « lift » avec un parfait étranger, Byron, 63 ans, rencontré pour la première fois sur une halte routière en Caroline du Nord, et seule personne ayant accepté de l’accueillir à bord de son grand motorisé de douze mètres de long. Pendant deux mois, avec Byron comme guide, mentor, colocataire et ami, Célia a pu apprendre et mettre en pratique le mode de vie des caravaniers à plein temps. Dans un deuxième temps, seule, dans son propre motorisé loué pour l’occasion, elle a parcouru 14 000 kilomètres, sillonnant 21 États américains et deux provinces canadiennes, afin de pénétrer à fond et de comprendre ce monde de vagabonds de luxe. Elle est restée dans des campings, des déserts, des parc nationaux, des aires d’autoroute, des stationnements de Walmart, d’aéroport et d’hôtels et des truck stops. Alors, son expérience, comme la mienne—sur la route dans mon Safari Condo de manière plus ou moins continue depuis dix ans—contredit la thèse d’une société américaine dangereuse et violente. Elle dirait aujourd’hui, comme moi, qu’il y a « du bon monde » partout!

Mon propre mini VR au lac Témiscouata
Entre ces deux expériences continentales de terrain, l’ethnologue avait également résidé dans un terrain de camping au nord de Montréal, auprès de caravaniers québécois dont certains se retrouveraient le long de son chemin par la suite.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser en observant passer des rutilants véhicules récréatifs que sont les motorisés, caravanes à sellette ou bus reconvertis, passage qui évoque une vie simple caractérisée par la liberté, la paix et la félicité, le phénomène du caravaning est complexe. (Qu’il soit dit en passant que l’utilisation par l’auteure des termes RVing (vie dans un véhicule récréatif) et RVer (celui ou celle qui la pratique) dans son ouvrage est agaçant sinon déplorable. Pourquoi ne pas adopter les équivalents français « caravaning » et « caravanier »?) Célia Forget décrit, dissèque et analyse ce phénomène à partir du moment où le caravanier en herbe opte pour ce mode de vie jusqu’au moment où il décide de l’abandonner, car selon elle, « leur faim de la route » doit obligatoire céder un jour à « leur fin de la route ». Dans les deux cas, ce sont des décisions déchirantes. Dans le premier, on coupe avec le passé, on vend la maison familiale, on s’éloigne des enfants, des petits-enfants et des amis, on se débarrasse des biens accumulés depuis des éons. À des fins administratives, on invente une adresse fictive car la société n’est pas faite en fonction des gens mobiles. Dans le deuxième, il faut découvrir comment réintégrer la société sédentaire, souvent avec des moyens réduits et une santé fragile. Entre les deux, il y a le choix du véhicule récréatif dont le style et le prix varient énormément, l’apprivoisement du véhicule en ce qui a trait à la conduite et à l’entretien, l’aménagement de son intérieur pour le personnaliser, l’apprentissage de la route (devenir « blueliner » en suivant les petites routes ou « redliner » en se limitant aux autoroutes), le défi de vivre en couple dans un espace réduit (un couple qui va mal ne peut y survivre), la solitude du (de la) célibataire (difficilement soutenable à la longue), le choix des stationnements… La liste pourrait s’allonger indéfiniment.
Malgré la nature fluide du caravaning à plein temps, il s’établit néanmoins des rapports de territorialité et de sociabilité. Faisant appel aux notions de « territoire nomade » et de « territoire circulatoire » élaborées par des chercheurs français, Forget propose le concept contradictoire de « territoire de mobilité » qui n’est officialisé par aucune frontière géographique qui le contraindrait à un espace fixe. Il s’agit d’un « territoire flottant » se fabriquant au gré des déplacements. Par contre, une fois arrêté ou stationné, le caravanier est conscient de ses droits territoriaux. Comme le chien qui pisse sur les poteaux pour bien définir son territoire, le caravanier, figurativement, fait la même chose (page 128), le territoire flottant se transformant ainsi pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines en « territoire ancré ».
Que ce soit au paradis des caravaniers, c’est-à-dire sur les terrains de camping ou dans les RV resorts qui fournissent au gros prix une multitude de services permettant au campeurs/caravaniers d’être confortablement chez eux ou dans la désolation des déserts d’Arizona et de Californie qui attirent un nombre surprenant d’aventuriers de la route, les réseaux de sociabilité se créent rapidement. S’apprivoisant, s’amusant ensemble et s’entraidant, les caravaniers à temps plein se tissent souvent des liens durables. Il n’est pas rare qu’ils se donnent rendez-vous au même endroit l’année suivante et l’année d’après et que, dans l’intérim, ils s’envoient des centaines de courriels et des dizaines de cartes postales illustrant leurs voyages et leurs exploits.
Un aspect du caravaning à plein temps que passe sous silence Célia Forget, mais qui est digne de mention est l’absence de caravaniers de couleur! Si, depuis 50 ans, la ségrégation raciale n’existe plus officiellement aux États-Unis, elle existe encore bel et bien dans le monde du caravaning/camping, que ce soit à plein temps ou pas. Autrement dit, sur la route les minorités visibles sont invisibles. Il s’agit d’un monde de blancs. Pourquoi? Peut-être en raison d’un statut socioéconomique inférieur, mais ce serait là une explication trop facile. Se fiant aux idées développées par Célia Forget qui veut que le caravaning d’aujourd’hui fasse partie de la longue tradition de mobilité en Amérique, qui donna lieu au XIXe siècle au peuplement progressif du continent d’est en ouest par des pionniers, coureurs de bois, voyageurs et chercheurs d’or—toutes des migrations libres motivées par l’espoir d’un gain économique—on pourrait conclure que les Américains et Canadiens de couleur qui, eux, n’y ont à peu près pas participé sont exclus de cette « tradition ». Ils possèdent un bagage culturel et historique différent et nourrissent d’autres rêves. Dans toute ma vie de caravanier averti, il m’est arrivé de rencontrer une famille noire et personne d’ascendance asiatique. De l’espagnol, j’en ai entendu de la bouche de ceux qui entretenaient le gazon et taillaient les arbustes sur les terrains de camping aux États-Unis. Je ne peux que me demander si l’expérience de Célia Forget est pareille. Elle ne le dit pas.
Chapeau à cette petite Française venue découvrir l’Amérique. En le faisant, elle nous dévoile une Amérique bien particulière, une Amérique nomade, une Amérique insolite, une Amérique blanche! Par son travail, elle nous convainc que le tourisme, le voyage et le caravaning à temps plein ne sont pas du pareil au même. Embarquons avec elle!

Waouh de gros travaux : et la thèse et la critique. Tout cela est fort intéressant et donne envie d’en savoir plus: de lire la thèse et de connaître son auteure!
Cher Dean,
je suis bien contente que la lecture de mon livre vous ait intéressé. Comme vous le savez, vivre sur la route est une aventure extraordinaire et j’ai été fascinée par ce mode de vie que j’ai étudié pendant plus de 10 ans. Si vos recherches sur la Franco-Amérique m’ont inspirée pour ma recherche, vos aventures en Safari Condo l’ont été tout autant.
À la lecture de votre compte-rendu de mon livre, je me permettrais deux trois petits commentaires pour clarifier quelques-unes de vos interrogations. Les lectures sur la route, le voyage et le nomadisme ont été nombreuses et si j’en cite quelques-unes dans le livre, elles ne reflètent bien entendu pas toutes celles que j’ai dû laisser sur le bas-côté pour cette publication. Volkswagen Blues en fait partie. Un autre ouvrage présentait l’aventure de Joe Madden, mais là encore, il me fallait me limiter à un exemple.
Concernant la violence véhiculée dans les médias, je suis en parfait accord avec votre analyse. Elle est omniprésente dans les médias, mais la réalité (que j’ai rencontrée) est tout autre. Je vous confirme également que les minorités visibles ont été totalement invisibles sur mon terrain. Je le mentionne dans le livre (p.22), regrettant justement ne pas avoir eu l’occasion de rencontrer de personnes de couleur optant pour ce mode de vie. Grande défenseure de la langue française, j’aurais validé un terme français si ce dernier avait été utilisé par ma population d’études. Or, les francophones choisissant ce mode de vie se nomment tous entre eux les « full-timers ». J’ai donc privilégié le terme employé par mes informateurs afin de respecter leur propre appellation.
Encore merci pour votre compte-rendu. Je suis heureuse que vous ayez apprécié ce voyage au pays des full-timers en ma compagnie.
Au plaisir de vous croiser sur la route…