Enfant, à force de tourner les pages et de scruter les cartes de l’atlas que mes parents m’avaient offert en cadeau, je l’ai usé rapidement, mais pas avant d’avoir découvert sur une carte de l’Amérique du Nord—ou du Canada, je ne m’en souviens plus—un petit coin de la France. Juste en dessous de Newfoundland, c’était marqué St. Pierre & Miquelon (Fr). Est-ce possible que la France existe en Amérique? J’aimerais donc voir cela, me suis-je dit à huit ans. Cinquante-quatre ans plus tard, je m’y suis en fin rendu, accompagné du gros Jim Lansing d’Albany, NY, que j’ai rencontré à bord de l’Artheus, le bateau qui nous a transportés de Fortune, TN, à Saint-Pierre. L’an dernier, Jim, dans la trentaine avancée, avait fait la même découverte que moi et s’était promis de mettre Saint-Pierre à son prochain itinéraire qui l’emenerait à Terre-Neuve, au Labrador et au Québec via Blanc-Sablon. Ici, le Nordik Express l’attendrait pour le conduire, lui et sa voiture en conteneur, à Natashquan . De là, Jim comptait emprunter le nouveau tronçon de la 138 pour se rendre à Québec avant de rentrer chez lui. Je lui ai donné l’adresse d’un C&C à Baie Saint-Paul.
À ce temps-ci de l’année, la brume couvre le passage entre Fortune et Saint-Pierre. Après un voyage d’une heure trente sur une mer agitée, l’apparition du phare, situé sur la pointe du petit havre, et, quelques minutes plus tard, de l’édifice de la douane annonce enfin l’arrivée. La vérification des papiers est de rigueur ici et tous les passagers se


font renifler par un chien appartenant aux autorités françaises, histoire de s’assurer de l’absence de stupéfiants. Le bureau de postes sur la Place du Général-Charles-De Gaulle, les voitures de marque française (comparées aux mastodontes américains) et les menus en euros servent de rappels que nous sommes en France.

Ce qui saute aux yeux sur cette île au climat plutôt grisâtre et terne est la couleur des résidences, des commerces, des clubs et de l’énorme lycée. Les couleurs reflètent la gaieté. Ce sentiment est renforcé encore davantage par la musique d’un carrousel qui amuse les enfants de Saint-Pierre dont le nombre est impressionnant. Seule la cathédrale, d’ordinaire la structure la plus extravagante d’un village, déçoit par sa banalité.
Si les enfants sont relativement plus nombreux ici qu’au Québec et qu’en France métropolitaine, il faut en prendre en soin! En fait, c’est ce que font les jeunes gendarmes mobiles. Mobiles! Oui, car ces jeunes membres de la gendarmerie nationale, portant le képi à broderie jaune, changent de département d’outre-mer à tous les trois mois.

Roland avait fait trois mois en Guyane avant de venir ici où il lui reste un mois avant de rentrer en France. David repartira aussi dans un mois. Ce dernier avoue que le travail à Saint-Pierre est inintéressant. Il n’y a ni criminalité, ni délinquance. Les deux rêvent d’être mutés en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. À Saint-Pierre et Miquelon, disent les deux, le tour est vite fait! Les gendarmes mobiles, au nombre de trente, vivent en célibataires. Femmes ou blondes restent en France. Par contre, il y a une vingtaine de gendarmes réguliers qui portent le képi à broderie blanche. Ils viennent de la métropole avec leurs familles pour une période de trois à cinq ans. Selon Roland et David, aucun gendarme n’est de la place et les insulaires n’apprécient pas toujours cette présence autoritaire venue de la métropole, surtout celle des jeunes gendarmes mobiles!
Roland et David m’ont indiqué le chemin vers un autre point de rassemblent du village, le fronton basque. Tout l’été, dans un petit centre culturel à l’écriteau en basque s’organisent des compétitions de pelote, ce sport qui teste habilité, agilité et endurance.
Chez un commerçant de souliers, j’ai rencontré Glen Brooks et Carmella Goguen, charmant couple de Moncton, prisonniers de Saint-Pierre. Oui, prisonniers! Glen, ancien membre de la gendarmerie royale du Canada et pilote, et Carmella étaient arrivés à l’aéroport de Saint-Pierre de Moncton deux jours auparavant en route vers la capitale de Terre-neuve, St. John’s. Comptant passer une seule nuit à Saint-Pierre, ils s’apprêtaient à y passer leur troisième…et peut-être plusieurs autres encore, car le manque de visibilité résultant de l’épais brouillard ne permettait pas le décollage de leur Cessna. De bonne humeur, malgré tout, ils pouvaient difficilement trouver meilleur endroit pour découvrir, se reposer et manger.
En regagnant Terre-neuve, j’ai voyagé avec la famille Plantais qui devait s’installer le jour même dans sa résidence d’été sur la péninsule Burin. Il s’agit d’un genre de chalet appartenant à l’épouse terre-neuvienne de Guy, saint-pierrais. Cette union témoigne des liens étroits qui existent entre les Français de Saint-Pierre et Miquelon et leurs voisins canadiens. En 1978, en quête du travail, Guy est venu à Québec. Il n’en a pas trouvé suffisamment pour y rester. Toutefois, pendant un an, il s’est bien amusé à faire de la musique, seul et avec un petit groupe. Les Québécois ont trouvé cet accordéoniste saint-pierrais pas mal exotique! Son fils, Philippe, rêve d’aller en France, à Brest ou à Toulon, pour faire, comme il dit, de la marine militaire. J’ai posé à son père la question suivante : « comment un jeune homme comme lui, n’ayant connu que Saint-Pierre et le bout de la péninsule Burin à Terre-neuve, peut-il s’adapter à la vie trépidante en France? » Guy m’a assuré que son fils n’aurait aucune difficulté, d’autant plus que sa sœur aînée habite déjà Marseille. Et les autres membres de la famille? Un frère à St. John’s et une autre sœur à Calgary. Voilà, le destin aujourd’hui des jeunes saint-pierrais. En un mot : partir.
Les insulaires n’ont cessé de me dire de revenir en août ou en septembre quand il ferait beau soleil à tous les jours. Je pense qu’ils exagéraient un peu, mais j’ai envie de retourner voir et de vivre davantage mon rêve d’enfance.
Author Archives: Dean Louder
Battle Harbour, Labrador : bijou nordique de la préservation historique

Situé sur une petite île, à une dizaine de kilomètres de la terre ferme, au nord du détroit de Belle-Isle, Battle Harbour fut pendant plus de deux siècles le centre économique et social de la côte sud-est du Labrador. Sa renommée, il la

devait à la pêche de la morue et à la chasse aux phoques. En 220 ans, Battle Harbour n’a connu que trois propriétaires : la compagnie fondatrice appartenant à John Slade de Poole, en Angleterre, qui l’a établi aux années 1770 et qui l’a exploité pendant cent ans, avant de le vendre à la compagnie de Baine et Johnston Ltée dont l’exploitation s’est poursuivie sur le modèle instauré par Slade. Les activités poursuivies à Battle Harbour par ces deux firmes peuvent être considérées comme un microcosme de l’histoire de la pêcherie à Terre-neuve et au Labrador. En 1955, Baine et Johnston Ltée a vendu le site à la société de transport des frères Earle qui assure l’opération du site jusqu’au moment de l’effondrement de la pêche côtière une trentaine d’années plus tard. Celui-ci culminerait en 1992 par la signature d’un moratoire sur la pêche de la morue. En 1990, à la suite d’un long processus de relocalisation des habitants de Battle Harbour, orchestré par les autorités fédérales et provinciales, le site au complet, fut cédé à la Battle Harbour Regional Association qui s’est transformée peu de temps après en organisation à but non lucratif, le Battle Harbour Historic Trust, vouée à la protection, à la restauration, à l’interprétation et à la promotion des ressources patrimoniales de ce lieu chargé d’histoire.
Bien qu’administré aujourd’hui par un Conseil d’administration dirigé par Gordon Slade de St. John’s, l’âme de l’opération du Trust sur le terrain est Mike Earle, 39 ans, qui reçoit les gens de passage, leur sert des repas, leur interprète la construction, la reconstruction et la restauration des édifices et les divertit en soirée par la musique. Nous, les 24 participants au colloque annuel de la Eastern Historical Geography Association , avons apprécié particulièrement son interprétation de « Peein’ the Snow », balade terre-neuvienne rendue célèbre par Buddy Wasisname and the Other Fellers et dont le refrain suit :
Chorus: Peein’ in the snow and gazin’ down the hole, Is the only thing to me that looks like spring! (spring, spring) I said peein’ in the snow and gazin’ down the hole, Is the only thing to me that looks like spring!

Pour apprécier la beauté et la diversité du site qui est Battle Harbour, il faut user ses souliers, s’y déplacer du bas vers le haut et d’ouest en est. D’abord, du « tickle », mot terre-neuvien qui désigne un petit bras de mer qui sépare deux îles, en regardant vers le haut (nord). Puis, en montant la côte, un regard vers l’Ouest. Ensuite, de la crête, une prise de vue de loin et de près et, enfin, coup d’œil vers l’Est, et le tipi de bois, ainsi arrangé pour mieux sécher.

Au cœur du village, bien que le mot soit mal choisi dans le contexte labradorien, se trouve le quai. C’est ici que la morue arrivait avant d’être « splitté », salé et mis sur les « flakes » pour sécher au soleil. À deux pas de là, le magasin général où le pécheur se voyait obligé d’acheter à crédit de la compagnie, s’assurant d’une santé financière plutôt précaire. Aujourd’hui, à l’étage supérieur, les « colloqueux », comme nous, colloquent et prennent leurs repas. L’église St. James est le seul exemple qui reste de l’œuvre de l’architecte ecclésiastique, William Grey. De plus, elle est la plus vieille église anglicane au Labrador. Construite en 1852, elle fut le premier objet de restauration lorsque le Trust a entrepris ses activités. L’Auberge Battle Harbour, avec ses cinq chambres, est l’ancien hôpital construit par Wilfrid Grenier en 1893, un an après son arrivée dans la région (voir texte précédent). Enfin, ma structure préférée parce que j’y ai demeuré pendant mon séjour à Battle Harbour est la maison Spearing, seule maison jaune de Batttle Harbour. Selon mon « colloc », Gordon Handcock, Terre-neuvien de cœur, d’âme et de sang et guide attitré des géographes de l’ EHGA à l’occasion de cette tournée, cette maison a été déménagée ici de Double Island, île avoisinante, où elle avait abrité le gardien du phare et sa famille.
Elizabeth Mancke, historienne maritime à l’université d’Akron, en Ohio, et membre de notre groupe de 24, a peut-être le mieux résumé en peu de mots ce qu’était Battle Harbour : « How small the island, how large the opération ». Battle Harbour se situait au cœur de l’univers maritime mondial—une colonie. Il permettait aux grands propriétaires et commerçants européens d’y faire fortune et de développer un système de troc qui tenait les prolétaires, les pécheurs, en quasi esclavage et qui facilitait et encourageait la récolte exhaustive de la faune océanique, une tragédie écologique dont la planète pourrait ne jamais s’en mettre. Oui, si petite l’île, si grandes les conséquences de son existence et de son exploitation!
St. Barbe et Blanc-Sablon : La traversée au Labrador
Plusieurs de mes textes traitent d’une traversée. On dirait que j’aime les traversiers et c’est vrai; je ne m’en lasse jamais. L’une des raisons, c’est que l’on y rencontre toujours des gens fort intéressants et de bonne humeur. Aujourd’hui, à St. Barbe, tel est encore le cas! Les passagers laissent leurs véhicules (voiture, autobus, moto) et se massent le long du quai pour regarder l’Apollo arriver.

Celui-ci offre le service trois fois par jour entre St. Barbe, à Terre-neuve, et la côte du Labrador en passant par Blanc-Sablon, au Québec. La traversée d’une durée habituelle de deux heures sera un peu plus longue aujourd’hui, car depuis plusieurs semaines, l’Apollo fonctionne avec la moitié de ses forces, l’un des moteurs étant en panne.
Le plus fascinant de ces passagers—celui qui attire l’attention de tous—est Philippe de Trois-Rivières.

Étudiant en sciences et génie à UQTR, mais indécis quant à son avenir, il a décidé de mettre une halte à ses études et de poursuivre son rêve de partir en vélo. Nous l’avons rencontré lors du 38e jour de son périple. Parti de chez lui le 17 mai, Philippe avait parcouru la route 132 au Québec jusque Rivière-du-Loup. Franchissant le portage du Témiscouata sur la belle piste cyclable du « Petit Témis » qu’il n’avait pas aimée parce qu’il avait plu et ses pneus s’embourbaient, il est arrivé à Saint-Jacques, à l’entrée du Nouveau-Brunswick. Philippe est passé par le nord de la province (Saint Quentin, Kedgwick, Campellton, la baie des Chaleurs), la péninsule acadienne et la côte du détroit de Northumberland. Avant d’entrer en Nouvelle-Écosse, il a rendu visite à l’île du Prince-Édouard. Sous les pluies au Cap-Breton, il s’est rendu à North Sydney pour prendre le traversier à Terre-neuve : Port-aux-Basques, Stephenville, Cornerbrook, le parc national de Gros Morne avec ces nombreuses montées et descentes, et la péninsule septentrionale avant d’enfin arriver à St. Barbe où il pouvait rentrer brièvement au Québec faire escale avant de reprendre sa route vers la côte est de Terre-neuve. Mais pourquoi cette escale qui l’éloignait de sa destination ultime? La réponse est facile. Philippe est Québécois. Demain, c’est la Saint-Jean Baptiste. Il désirait fêter sa patrie parmi les siens sur le sol québécois à Blanc-Sablon.
Quelques minutes après avoir quitté le quai de St. Barbe, nous passions devant le hameau de Anchor Point. Deux heures et demi plus tard, nous nous approchions de Blanc-Sablon et, enfin, de son quai.

Curieux, n’est-ce pas, de passer par le Québec pour se rendre au Labrador, alors que la côte labradorienne compte de nombreuses baies protégés (L’Anse-au-Clair, Forteau, L’anse-au-loup…) qui pourraient facilement recevoir l’Apollo et ainsi raccourcir la distance et réduire le temps entre la côte terre-neuvienne et la côte labradorienne ? L’explication possible : tant qu’il s’agit un lien inter-provincial (Terre-neuve/Québec), une subvention généreuse du Fédéral est possible. Rien de telle pour une liaison intra-provinciale (Terre-Neuve/Labrador).
Red Bay, Labrador et les baleiniers basques

S’il existe en 2005 à Red Bay un centre de Parcs Canada pour interpréter l’utilisation de ces lieux au XVIe siècle par les baleiniers d’origine basque, c’est grâce, en grande partie, à Selma Barkham, septuagénaire dont l’intérêt pour les Pays basque remonte aux années cinquante. En 1972, après avoir travaillé au Mexique pour apprendre l’espagnol, Selma a entrepris des recherches dans les archives basques et espagnoles. Elle s’est plongée pendant de nombreuses années dans des milliers de documents, et notamment des actes notariaux, billets à ordre, testaments et contrats d’assurance. Elle y a puisé une mine de renseignements sur la pêche de la baleine pratiquée ici Le document le plus important a sans doute été celui concernant le naufrage en 1565 du San Juan. Ce bateau chargé d’huile de baleine devait lever l’ancre pour l’Europe lorsque emporté par de violents vents du nord. Les archéologues travaillant sous l’eau, en 1978, aurait retrouvé l’épave précisément à l’endroit où un autre bateau, le Bernier, a callé il y a un quart de siècle.

Au Centre d’interprétation de Parcs Canada où de nombreux artefacts, dont une chaloupa, sont en montre, on apprend que les Basques ont aménagé, à partir de 1540 jusqu’au début du XVIIe siècle, plusieurs stations de dépeçages de baleine le long de la côte du Labrador et du détroit de Belle Isle. Red Bay, connu par les Basques sous le nom de Buttes et doté d’un excellent havre, devint l’un des plus grands ports de pêche de la baleine. Certaines années, il y avait jusqu’à 800 hommes et jeunes garçons qui y chassaient le cétacé et travaillaient à la fabrication de l’huile. Outre la pêche de la morue, la pêche de la baleine par les Basques semble être la plus ancienne activité industrielle pratiquée par les Européens au Canada. À l’époque, l’huile de baleine éclairait toute l’Europe et se trouvait à la base de la fabrication manufacturière.
En ce qui concerne cette pionnière de la recherche sur les Basques au Canada, Selma Barkham, toujours active, a tourné son attention vers l’ïle de Old Ferolle, en face de Plum Point, TN, à peine quelques kilomètres au sud de St. Barbe, point d’embarcation pour Blanc-Sablon. C’est ici qu’elle nous a reçus. En sa compagnie, nous avons marché cet îlet de long en large, examinant ses sites archéologiques et appréciant sa faune et sa flore.


Laura-Lee Bolger à L’Anse aux Meadow
En trente-deux ans d’enseignement à l’université Laval, je n’ai eu qu’un étudiant originaire de Blanc-Sablon, cette petite localité (1 200 habitants), située sur la Basse-Côte-Nord du Québec, à cinq kilomètres de la frontière labradorienne et inaccessible par route. Je lui ai enseigné deux fois, une fois en ma trente-et-unième année et une fois en ma dernière année. Il s’agissait de Laura-Lee Bolger, anglophone de naissance et francophone par alliance et par choix. Maintenant, étudiante à la maîtrise en géographie historique, cartographie et systèmes d’information géographique, elle m’avait mis au parfum de ce colloque qui devait avoir lieu au Labrador. Il réunirait les membres de la Eastern Historical Geographers Association qui compte plusieurs de mes amis et anciens collaborateurs dont Wilbur Zelinsky avec lequel j’avais collaboré en 1982 pour la publication de This Remarkable Continent : An Atlas of United States and Canadien Society and Cultures. Wilbur, âgé de 84 ans est venu au colloque seul en conduisant sa propre voiture depuis la Pennsylvanie, et Laura-Lee, 29 ans, se trouvaient aux deux extrêmes de la pyramide des âges des participants au colloque. La participation de Laura-Lee
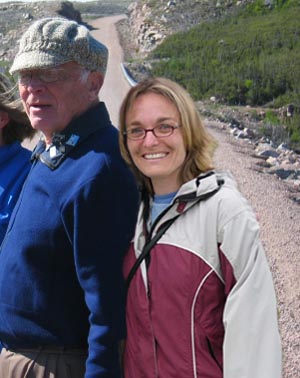
au colloque nous a permis de nous rendre véritablement compte des liens étroits qui lient les gens des deux côtés du détroit de Belle-Île, cet entonnoir hydrographique qui canalise le courant froid du Labrador et qui fait vivre sur plus de quatre siècles pêcheurs, chasseurs de phoques et baleiniers. Aussitôt arrivée à L’Anse aux Meadow, Laura-Lee (Québécoise) est tombée dans les bras de Bonnie (Terre-neuviènne), une amie de la famille qui faisait de l’interprétation sur le site. Au lendemain, à Battle Harbour, elle renouerait, à son insu, avec Jenetta (Labradorienne), sa cousine, qui y travaille comme cuisinière. Laura-Lee n’avait revu ni l’une ni l’autre de ces deux femmes depuis 1995, moment où elle avait quitté Blanc-Sablon pour poursuivre ses études à Sherbrooke, puis à Québec.
Autre coïncidence qui me rapproche, personnellement, de Laura-Lee : en 1971 sa belle-sœur, Diane Pintal avait suivi mon tout premier séminaire de second cycle offert à Laval. Grâce donc à Diane et à Laura-Lee, j’ai réussi dans ma carrière à littéralement boucler la boucle générationnelle.
Pourquoi vingt-quatre géographes, dont moi et Laura-Lee, nous étions-nous déplacés à l’Anse aux Meadow sur l’extrême point de la péninsule septentrionale de Terre-neuve?
Découvert en 1960, à la suite de longues années d’étude, par les Norvégiens, Anne Stine et Helge Ingstad, ce lieu

est celui du premier établissement européen reconnu en Amérique du Nord. Il pourrait s’agir du campement de Vinland qui fut établi par Leif Ericsson et qui fut de courte durée. Vers l’an 1 000, des marins scandinaves implantèrent ici une base à partir de laquelle ils explorèrent des régions plus au sud. On peut y trouver des traces de fer forgé et d’outils de menuiserie, ce qui fait croire que la fabrication et la réparation de barques étaient importantes. Selon l’interprétation qu’en fait Parcs Canada, l’éloignement de leur patrie et les conflits avec des autochtones auraient pu inciter les Scandinaves à abandonner ce site qui devint en 1978 le premier site culturel à figurer sur la liste du patrimoine mondial de la convention de l’UNESCO.
Depuis la découverte du site, Parcs Canada, se basant sur des fouilles archéologiques majeures, essaie de reproduire le plus fidèlement possible des structures d’habitation et de travail. L’interprétation se fait à l’intérieur comme à l’extérieur par les gens habillés en costumes d’époque. Ailleurs, des creux et des monticules rendent témoignage de ce qui aurait pu être un atelier ou un entrepôt.

