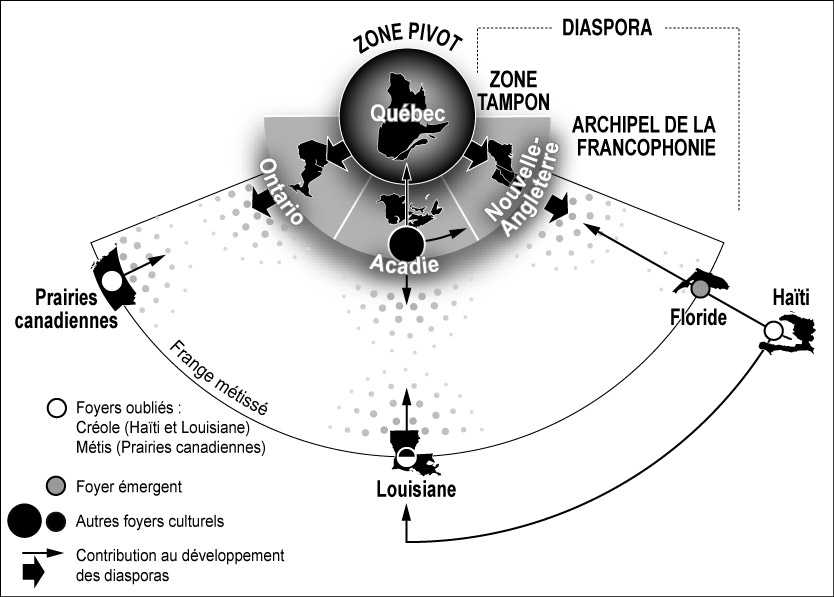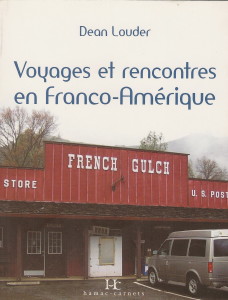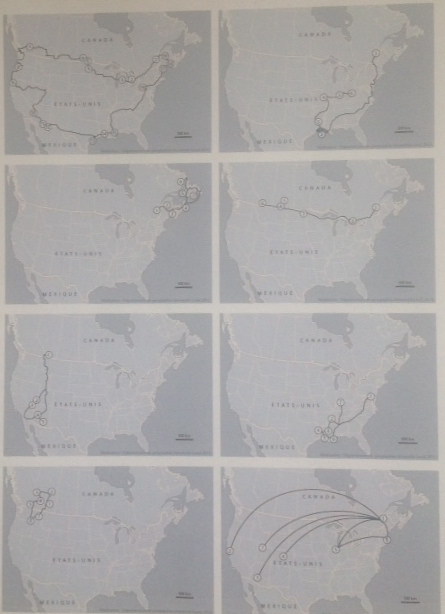Il n’y a plus d’eau dans le château d’eau de Sudbury. Il est question de lui trouver une nouvelle vocation, mais pour le moment, il sert de grand panneau publicitaire et toujours de point de repère majeur dans cette ville du Moyen-Nord de l’Ontario qui compte aujourd’hui 160 000 habitant dont environ 30% de langue française, ce qui en fait un important centre culturel franco-ontarien.
C’est au pied du tertre sur lequel repose le château d’eau que la rue Notre-Dame perce le centre-ville après avoir traversé le quartier Moulin-à-fleur, traduction « libre » de Flour Mill, traditionnellement francophone. Dans son livre choc, Hors du Québec point de salut?, publié en 1982, la journaliste Sheila McLeod Arnopoulos décrivait ainsi le comportement linguistique des résidents du quartier :
C’était le temps de Noël. Un mineur et sa femme discutaient d’étrennes à offrir à leurs enfants tout en déambulant le long de la rue Notre-Dame dans le quartier Moulin-à-fleur de Sudbury. « Une bicyclette pour Marie peut-être…des patins pour Jean-Charles? » Je marchais quelques pas derrière eux tout en les écoutant parler. En arrivant à proximité du complexe commercial situé au centre-ville et alors que la foule se fit plus dense, ils devinrent étrangement muets tous les deux. La conversation ne reprit qu’une fois qu’ils eurent pénétré à l’intérieur. Or ce n’était plus leur langue qu’ils parlaient, mais un anglais qui accusait un fort accent français. Une transformation mystérieuse s’était opérée au moment de quitter leur quartier : sur leurs visages français ils posèrent des masques anglais. Le passage d’une personnalité culturelle à une autre se fit tout à fait inconsciemment, comme un réflexe appris depuis longtemps. (p. 122)
Trente-deux ans plus tard, ce reflexe existe-il encore? J’ai profité de deux heures de temps libre au Salon du livre du Grand Sudbury pour essayer de trouver une réponse. Je n’ai pas réussi. Je ne peux que rendre mes impressions qui sont au nombre de trois et je laisserai les lecteurs de ce blogue qui connaissent mieux que moi le coin faire le point par le biais de leurs commentaires :
- Le quartier demeure un haut lieu de la francophonie sudburoise.
- Sur le plan ethnique et linguistique, le quartier s’est diversifié, la part franco-ontarienne ayant diminué.
- La charge patrimoniale est omniprésente.
D’abord, les institutions traditionnelles et symboles de la communauté francophone sont très visibles : drapeaux canadien et franco-ontarien, école secondaire du Sacré-Cœur, église Saint-Jean-de-Brébeuf, caisse populaire Desjardins.
Aperçu du quartier en arrivant du centre ville
De point de vue de l’affichage, hormis les institutions, la Bouquinerie du Moulin et le dépanneur Lagacé brillent par leur francité dans un paysage autrement dominé par l’affichage de langue anglaise. Le « Cartouche argenté », bien en évidence sur la rue Notre-Dame. offre au passant l’occasion de déguster de la poutine authentique!
Les silos désaffectés du moulin rappellent la fonction originale du secteur qui a donné au quartier son nom.
À quelques mètres des silos jaunes, un panneau indique le chemin vers le Musée du moulin à fleur, constitué d’un bâtiment principal en bois rond et quelques maisons d’époque (des années 20 et 30). Comme il arrive souvent dans ce pays de neige que nous habitons, les équipements à vocation touristique sont fermés en mai. Ce musée ne fait pas exception!
En parlant de l’hiver, j’ai appris en me promenant autour de l’église que les paroissiens réussissaient tant bien que mal à financer l’entretien de leur beau temple en louant à des fins d’entreposage de leurs engins l’immense salle située au sous-sol à des propriétaires de motos. Il paraît qu’il y en a des centaines! Ingénieux…astucieux! J’aurais bien aimé en prendre une photo, mais la salle est vide. Les motards ont déjà envahi les routes!
Moulin-à-fleur : nom exotique, nom musical qui rimait autrefois avec pauvreté et misère, nom au cœur de l’identité franco-sudburoise. Écoutons encore la journaliste qui cite Albert Ouellet, résident de Sudbury :
Les Canadiens français étaient les gens les plus pauvres de Sudbury. Les salaires payés aux mineurs étaient bas et leurs familles étaient nombreuses. À Moulin-à-fleur il n’y avait pratiquement rien que des taudis… (p. 176)
Le quartier n’est plus ce qu’il était lorsque Sheila MacLeod Arnopoulos l’arpentait. À Sudbury une nouvelle classe moyenne franco-ontarienne sûre d’elle n’ayant plus peur de parler sa langue devant les Anglâs se créa. Cette transformation a joué sur la géographie linguistique de la ville. La population de langue française n’est plus cantonnée dans un ghetto ethnique ou linguistique. Elle est à peu près partout dans la zone urbaine. Elle occupe, à divers degrés, les hauteurs de la ville, les nouveaux quartiers du sud et de l’est et les beaux espaces reboisés et verdoyants autour du lac Ramsey près de l’ Université Laurentienne.
Il y a un quart de siècle environ, nous avons invité le grand poète originaire de Sudbury, Patrice Desbiens, à venir s’adresser à nos étudiants à l’Université Laval. Il a décrit son parcours personnel, des raisons qui l’avaient emmené à s’installer à Montréal, puis à Québec. Un étudiant lui a posé une question : « Monsieur, tant qu’à partir pour vivre en français, pourquoi n’êtes-vous pas allé jusqu’à Paris? »
Ce à quoi Patrice a répondu, « Mon jeune, quand tu viens de Sudbury, Québec, c’est Paris! »
Ce serait moins le cas aujourd’hui.