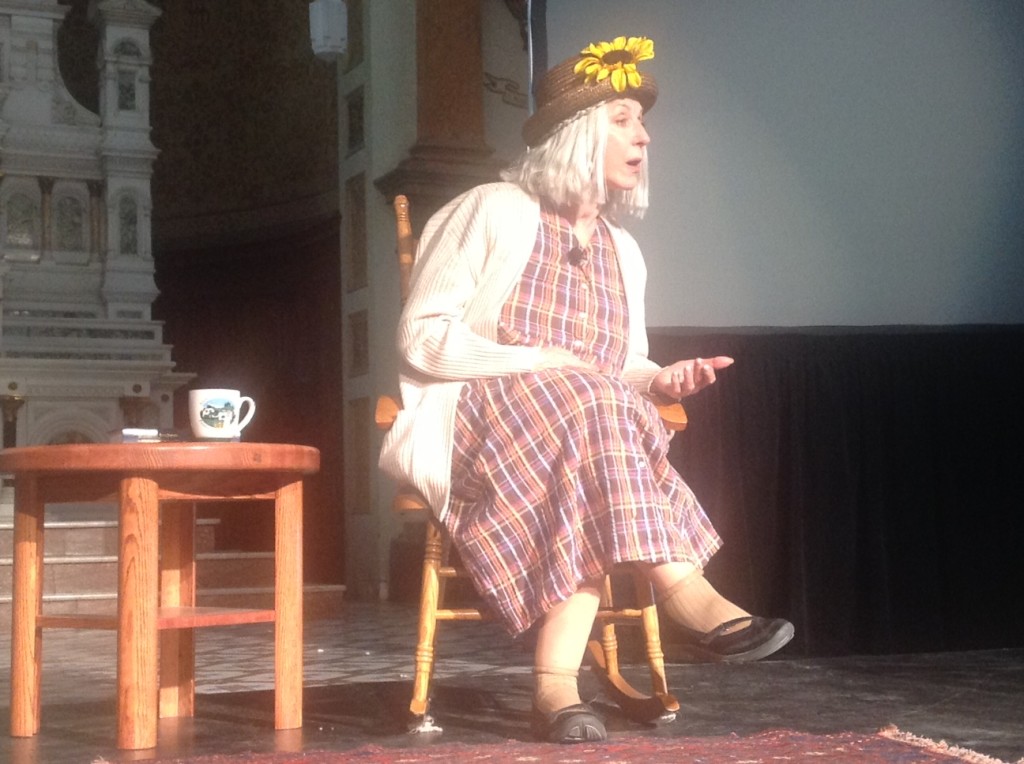Le dimanche 16 mars, j’ai eu l’occasion de visionner, en présence de son scénariste (Claude Godbout) et de son réalisateur (Bruno Boulianne), leur nouveau documentaire, « Un rêve américain » qui rappelle, pour ceux et celles qui l’auraient oubliée, la dimension continentale de la civilisation canadienne-française.

Je l’avais déjà vu, en octobre dernier, mais dans une petite salle stérile (Benoît-Pelletier) du Centre de la francophonie des Amériques, en compagnie d’un petit groupe de « spécialistes » de l’Amérique française—ou comme je préfère dire—de la Franco-Amérique. Il était bien meilleur la deuxième fois! J’ai demandé à Claude Godbout pourquoi et ce cinéaste de grande renommée (Les Ordres, Les Bons Débarras) m’a répondu en toute simplicité que c’était avant tout à cause de l’effet de la salle et du public, car nous étions dimanche 175 cinéphiles dans ce qui est peut-être la plus belle salle de spectacle de la ville de Québec, l’ancienne chapelle du Petit Séminaire.
« Un rêve américain » est un « road movie » mettant en vedette le musicien originaire de Lafontaine, en Ontario, Damien Robitaille, qui part de Montréal à la rencontre des Franco d’Amérique—un peu comme j’ai fait en 2003 pour entamer la production d’un petit livre intitulé Voyages et rencontres en Franco-Amérique, mais lui, appuyé par une modeste équipe cinématographique de haut calibre. Son chemin est pas mal différent du mien, mais il y a quand même des croisements importants, notamment au Missouri où celui qui figure sur la page couverture de notre livre Franco-Amérique, Kent Beaulne, occupe une place de choix dans le film.


Kent Bone/Beaulne chez lui à la Vieille Mine, au Missouri
Robitaille, assumant un air plutôt naïf, quitte Montréal par une belle journée d’automne. Après avoir traversé un plan d’eau important—j’ai dû mal à comprendre lequel car il n’y en a pas dans la direction qu’il emprunte—arrive à Waterville, dans le Maine, où il rencontre un groupe de Franco-Américains d’un certain âge réunis pour parler français. Ils lui racontent leurs histoires de famille. De là, il se rend à Lewiston, destination de prédilection pour des milliers et milliers de Beaucerons à l’époque de l’exode. Dans une usine de filature abandonnée, il jase avec Bob Roy qui représente la génération en perte de la langue française. Monsieur Roy, un homme d’affaires, relate, tantôt en anglais, tantôt en français, non pas autant la misère et les épreuves des Franco-Américains en sol américain que les défis auxquels ils ont eu à faire face et leurs réussites. À Boston, Damien raconte quelqu’un de son âge, Adèle Saint-Pierre, qui parle couramment français, mieux de son propre aveu que Damien qui, dans son adolescence, a failli abandonner sa langue maternelle et s’assimiler tout simplement!
Du nord-est des États-Unis, le voyageur dirige ses pas vers le Mid-west, vers le Michigan, où l’héritage canadien-français est partout inscrit au paysage. Ce patrimoine saute aux yeux! La rencontre à Détroit, avec Suzanne Boivin-Sommerville et Gail Moreau-Desharnais, toutes deux de la Detroit Historical Society, est particulièrement poignante. Elles ont la carte du Québec en tête et situent avec précision les lieux d’origine de leurs ancêtres. J’aurais donc aimé que ces deux-là assistent à ma conférence prononcée à Détroit le 4 octobre dernier, mais il paraît que le mot ne s’était pas donné!

Suzanne et Gail, avec Damien
C’est au Michigan, près de la rivière au Sable, parmi les « lumberjacks » que Damien entendra parler de Paul Bunyan et fera de lui son Saint-Christophe, installant son effigie sur le « dash » de son « char ». Pour les fins de ce documentaire, cette figure mythique prend son origine chez les bucherons canadiens-français de la région. C’est une théorie, Damien le dit bien. « Bunyan », il s’agirait là d’une vulgarisation réductrice des deux mots « bon Jean ». Notez bien que l’on m’a déjà dit que cela venait plutôt, à cause des mœurs de ce géant, de « bon à rien »! Peu importe, la légende de Paul Bunyan, que celui-ci soit Canadien français ou Suédois, comme le prétendent les bons citoyens d’origine suédoise à Bemidji, au Minnesota, où se trouve une autre énorme statue du bonhomme, s’est propagée partout aux États-Unis. Elle se prête bien à la quête de Damien Robitaille.
Le voyageur des temps modernes, accompagné de Philip Marchand, auteur de Ghost Empire : How the French Almost Conquered North America, fait une saucette à Chicago, fondée par Jean-Baptiste Pointe du Sable, et passe ensuite à travers le pays des Illinois, aboutissant à Sainte-Geneviève, sur le Mississippi, sans nous montrer les plus beaux exemples d’architecture coloniale française aux États-Unis qui s’y trouvent.
Au piedmont des montagnes aux Arcs (Ozarks), à une centaine de kilomètres au nord-ouest, à la Vieille Mine, c’est la fête, un « bouillon » chez la famille de Kent Beaulne qui montrera à Damien les fours à pain de sa propre fabrication. La construction est basée sur ses observations réalisées à l’Ange-Gardienne et à Château Richer, autrement dit sur le Chemin royal entre Québec et Sainte-Anne-de-Beaupré. En faisant écouter à son visiteur la guignolée chantée par Natalie Villmer et en lui montrant les pierres tombales au cimetière de la Vieille Mine, Kent répondra à la question tant de fois lui posée : « pourquoi parles-tu encore français?» Laconiquement: « Parce que je fais l’effort ». Il pourrait ajouter « parce qu’elle est mienne »!

Pierre tombales (Pashia=Pagé, Degonia=Desgagnés, Osia=Auger, Courtaway=Courtois)
Poussée vers l’Ouest. Le Wyoming : découverte des Robitaille dans le bottin téléphonique de Casper. Le Montana, gouverné tout récemment (1993 à 2001) par Marc Racicot : rencontre avec les Lozeau, couple métis, qui explique la présence de Canayens dans la région lors de la ruée vers l’or, et une autre au Palais de justice de Missoula avec le juge Robert « Dusty » Deschamps. Celui-ci dévoile son arbre généalogique bien garni de patronymes d’ici.
Après le Montana, je m’attendais à ce que Damien traverse les Cascades afin d’explorer l’Orégon si riche en patrimoine canadien-français, et de renouer avec les Pambrun, Jetté et Gervais, mais hélas le budget du film commençait à s’effriter. Il fallait bien le terminer et ils ont choisi pour le faire la Californie, qui, elle aussi, possède un passé marqué indélébilement par les Français et Canadiens français. Après s’être baigné dans les eaux du Pacifique à Santa Monica, c’est sur le sommet du Mont Rubidoux, près de Riverside, que Damien Robitaille rencontrera Art Robitaille et sa famille de motards. Originaires de Putnam, au Connecticut, ceux-ci ont, à leur façon, réalisé le « rêve américain ».

En philosophe…en parlant des racines communes des Robitaille d’Amérique, Art exprime la satisfaction d’avoir « created something to be proud of ».
De leur côté, Claude Godbout et Bruno Boulianne peuvent être fiers de ce film qu’ils ont créé. À mon avis, les Québécois qui l’auront vu ne pourront plus jamais voyager en Amérique du Nord de la même façon. Ils devront obligatoirement mieux saisir l’ampleur et l’importance des gens de la Vallée du Saint-Laurent dans l’histoire et le peuplement de ce continent!
Je l’ai souvent dit, le Québec est une mère patrie pour une population deux fois et demie plus grande que la sienne. Nous en rendons-nous compte? Comprenons-nous la portée d’une telle affirmation?
* * * * * * * * *
Petit velours personnel: dimanche après la projection, Martin Morneau et sa conjointe se sont présentés à moi en se disant fidèles lecteurs de ce blogue. Merci à vous deux! Merci à vous tous, où que vous soyez, qui me lisez