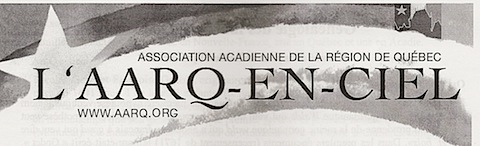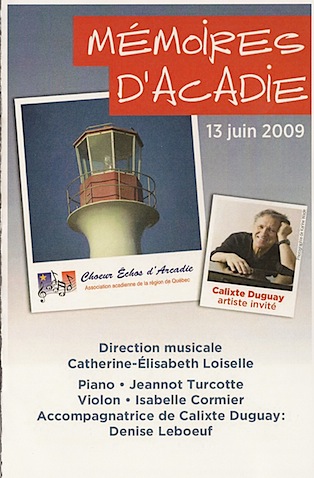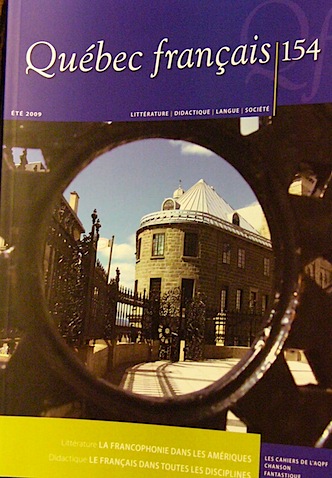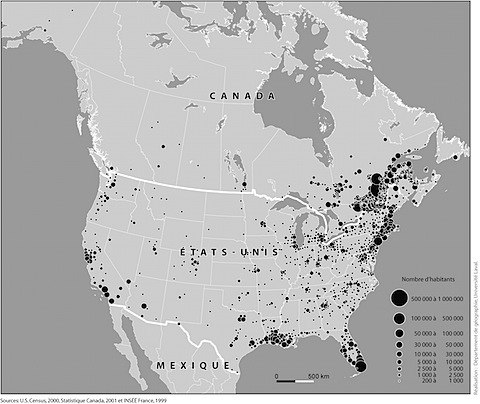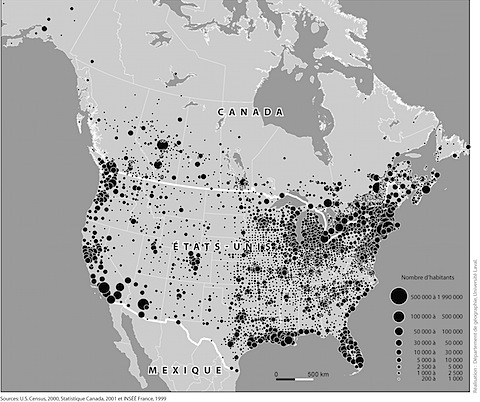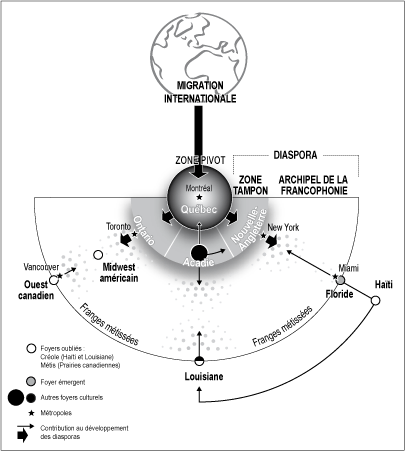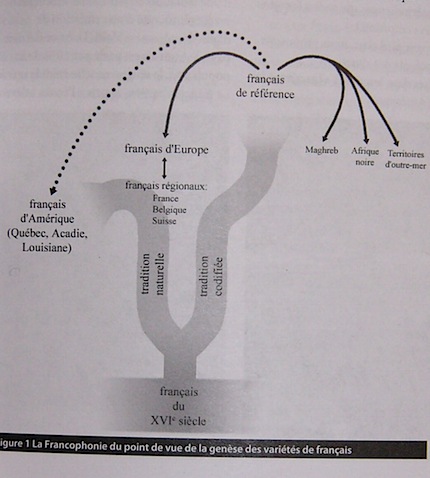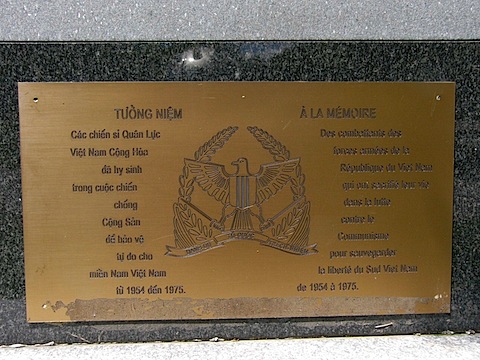La rivière au Lait, telle que baptisée par les éclaireurs canadiens-français faisant partie de l’expédition de Lewis & Clark à cause de sa couleur, prend son origine dans le coin nord-ouest de l’État du Montana, à quelques kilomètres de la petite ville de Browning, à proximité du Parc national Glacier : « the water of this river possesses a peculiar whiteness, being about the colour of a cup of tea with the admixture of a tablespoonfull of milk. from the colour of its water we called it Milk river ». (Journal de Meriwether Lewis)

Elle coule sur une distance de 1 173 km, le long de la frontière canado-américaine, tantôt en Alberta, tantôt au Montana, avant de se jeter dans le Missouri, faisant de la « Milk » le tributaire le plus septentrional du bassin versant du Mississippi. À 45 km à l’ouest du village albertain de Milk River, presque au pied des Collines à l’herbe douce (Sweetgrass Hills) se trouve le parc provincial Writing-on-Stone, domaine des hoodoo, ces étranges formations géologiques en champignon, créées par l’action érosive sur grès de l’eau, du vent et du givre.




L’endroit est au cœur du territoire traditionnel de la nation des Pieds-Noirs qui comprenait des Piegen, Kainai et Siksika. Il constitue pour eux un lieu sacré. Pendant au moins 3 000 ans, ces peuples nomades parcouraient cette vallée en laissant des traces. Des pétroglyphes rappellent leur vécu, leurs cérémonies et des événements saillants marquant leur culture.

Ici, grâce à l’abondance d’eau, de viande, de poisson et de petits fruits, le milieu naturel les soutenait physiquement. Les majestueux peupliers de la prairie, longeant la rivière les abritaient des vents qui y soufflent sans cesse. Spirituellement, ils tiraient force des puissances surnaturelles qu’ils croyaient habiter les falaises.

La signification et l’originalité du lieu sont telles que Parcs Canada, propose à l’UNESCO, sous le nom Áísínai’pi, qui veut dire en Niitsítapi « il est dessiné » ou « il est écrit » , sa candidature comme site du Patrimoine mondial.