Depuis 11 ans se tient à Blois, dans la vallée de la Loire, un Rendez-vous de l’histoire qui permet aux mondes savant et de l’édition, ainsi que qu’au grand public de se rassembler le temps d’une longue fin de semaine pour célébrer la discipline de l’histoire. À l’occasion du 40e anniversaire des
événements marquants de 1968, il est de mise que le Rendez-vous de cette année soit présidé par Daniel Cohn-Bendit—oui, le fameux « Danny le Rouge » d’une autre époque—qui fermera le Rendez-vous et ses quelques 360 tables rondes par une conférence intitulée « L’Europe, un fantasme, une nécessité ou une utopie? » prononcée à l’hémicycle de la Halle aux Grains, site de l’immense salon du livre et l’un des principaux points de repère du Rendez-vous.
Il est surprenant que dans le cadre de cette gigantesque manifestation culturelle française ayant pour thème « Les Européens » il y ait une place privilégiée pour le Québec. Québec 400 oblige! En fait, dans la programmation, on lit :
À l’occasion du 400e anniversaire de la ville de Québec, le Salon du livre met à l’honneur le Québec, ses éditeurs, écrivains, universitaires et autres médiateurs de l’histoire au travers d’une présentation multiforme.
Parmi les membres de la délégation québécoise, on compte :
Jean-Pierre Charland, historien de l’université de Montréal et écrivain.
Marcel Fournier, historien et généalogiste.
Martin Fournier, historien, Institut du patrimoine culturel de l’université Laval.
Nicole Fyfe-Martel, romancière.
Mylène Gilbert-Dumas, écrivaine.
Nadine Grelet, écrivaine.
Gilles Herman, directeur des Éditions du Septentrion.
Guy Lachappelle, politicologue de l’université Concordia.
Jacques Lacourcière, historien, journaliste, chroniqueur et animateur.
Raymonde Litalien, historienne et conservateur honoraire des Archive du Canada.
Dean Louder, géographe de l’université Laval.
Jacques Mathieu, historien de l’université Laval.
Christian Rioux, journaliste et chroniqueur au Devoir.
Jean-Philippe Warren, sociologue à l’université Concordia.
Nadine Grelet
A gauche, Raymonde Litalien; troisième et quatrième à droite, Guy Lachappelle et Christian Rioux
Leurs interventions au Rendez-vous se regroupent autour de huit tables rondes :
1) Le roman historique : son rôle, son utilité, ses lecteurs, la place de la fiction.
2) La Franco-Amérique : lieux d’histoire, de mémoire et de vie…
3) L’histoire de la Nouvelle-France : outil ou occultation en France
4) Le peuplement de la Nouvelle-France : émigration volontaire ou forcée?
5) Le Québec, terre d’accueil! Terre d’écueil! Quatre siècles dans l’histoire de la migration européenne vers l’Amérique
6) Les Québécois se sentent-ils plus européens qu’américains?
7) Les Français à la rencontre des Amérindiens : alliances et métissages
8) L’encyclopédie numérique du patrimoine culturel de l’Amérique française
Une neuvième table ronde « québécoise » sur le thème « Les femmes dans la société de la Nouvelle-France » fut l’œuvre de l’Association Loir et Cher-Québec qui, en plus d’offrir un cocktail fort couru, nous rappelle qu’un fils de Blois, Jean Ralluau, secrétaire de Pierre Dugua, sieur de Monts et compagnon de Samuel de Champlain, se retrouvait parmi les fondateurs de Québec.
L’achalandage aux séances à saveur québécoise et franco-amériquaine variait de moyen à bon. Évidemment, le vénérable Jacques Lacourcière attire partout où il passe (plus de 100 ici). Les géographes, moi-même et Christian Fleury, en parlant d’une idée méconnue—pour ne pas dire inconnue—en France, la Franco-Amérique, connûmes
Louder; Gilles Herman et Fleury
moins de succès, une trentaine de personnes, surtout des dames aux cheveux argentés! Parmi elles, se trouvait néanmoins une dame passionnée de la Franco-Amérique, Odile Rouet de Blois, qui, avec son mari, Roger, avait déjà visité la Louisiane et le Québec. Ils sont membres actifs de l’Association France-Louisiane-Franco-Américainie et lisent tout ce qui leur tombe entre les mains sur la Franco-Amérique. Heureuse comme Ulysse de pouvoir se procurer notre livre, Franco-Amérique, elle avait déjà, à ma grande surprise et satisfaction, un exemplaire de Vision et Visages de la Franco-Amérique. Par contre, elle a démontré beaucoup de mécontentement de pas avoir pu trouver en librairie en France, le troisième tome de la trilogie Ma chère Louisiane de l’écrivaine québécoise, Lili Maxime : Un dernier mardi gras. Je lui ai promis de faire en sorte qu’elle le reçoive!
Si nous avons mentionné ici, les intervenants québécois à la programmation au Salon du livre des Rendez-vous de Blois, il faut aussi faire connaître les maisons d’édition présentes : Boomerang Éditeur Jeunesse, Éditions d’art le Sabord, Éditions de l’homme, Éditions du Septentrion, Éditions Sylvain Harvey, Hurtubise HMH, Les Éditions du Boréal, Les Presses de l’université Laval, Presse de l’université du Québec, Triptyque et VLB Éditeur.
Le 14 octobre, journée d’élections au Canada! L’un des enjeux qui fera peut-être mal à M. Harper au Québec est celui des coupures dans le domaine de la culture. Je ne peux que reprendre ici quelques chiffres distribués par Québec Édition aux « coureurs de Blois », rassemblés à ce grand Rendez-vous littéraire et historique :
Le livre francophone au Québec, c’est :
-entre 4 000 et 5 000 titres édités annuellement;
-près de 2 000 entreprises entièrement vouées à l’édition;
-des ventes annuelles en librairies de près de 450 millions de dollars;
-une production diversifiée : des roman, des essais, des livres pour la jeunesse, des biographies, des ouvrages historiques, des livres savants, des dictionnaires, des ouvrages pratiques, des manuels scolaires, des bandes dessinées, et bien plus;
-une production florissante : même si l’on n’y compte que 7 millions d’habitants francophones, la production éditoriale au Québec se compare, toute proportion gardée, à celle de l’Allemagne, de la rance, de l’Italie ou des États-Unis.
Pas mal du tout!
Author Archives: Dean Louder
Hommage aux amis de Villedieu-les-Poêles
Dans le train à 6h45, en route vers Blois, via Paris bien sûr, car « tout » déplacement dans l’Hexagone passe nécessairement par la capitale. Dehors, il fait noir, le soleil ne se lève pas tôt ici. En arrière de moi, un groupe de jeunes jouent au Uno. En face de moi, une dame dans la trentaine dort. J’ai envie de faire de même.
J’avais besoin de ces deux jours passés à Villedieu pour me remettre du décalage horaire. Christian et Michèle m’ont mis rapidement à l’aise. J’ai eu l’impression de faire partie de la famille. Ce sont des gens chaleureux, des
gens très cultivés qui apprécient l’art, l’histoire, la littérature, le cinéma et surtout le voyage. Michèle, enseignante, a hâte de prendre sa retraite à la fin de cette année afin de poursuivre ces intérêts et d’en développer d’autres. Leur maison a été bâtie selon leur propre dessein. De son bureau, Christian peut regarder des moutons paître dans un
.
pré verdoyant et contempler l’horizon sans obstruction. Mon lit a été fort confortable et les repas délicieux. Hier soir, par exemple, nous avons mangé un confit de canard. Et les fromages!!! Les petits déjeuners comme je les aime : jus, fruits frais, crêpes légères à la confiture maison ou au sirop d’érable du Québec et thé fumant.
En prévision de notre participation aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, Christian et moi avons pris le temps d’agencer nos présentations de manière à faire ressortir la dimension continentale de la Franco-Amérique et à élucider dans ce contexte l’unique situation de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet archipel nord-américain où habitent 6 500 Européens! Demain, nous saurons si nous avons réussi.
Une randonnée le long de la Vire
En France depuis trois jours, je m’ennuyais de mon vélo. Une chance que Christian Fleury, un ami de Villedieu-les-Poêles, m’a proposé une randonnée le long de la « plus belle rivière de la Manche », selon lui. Entre nous, pour
un gars de Québec, la Vire, comparée à la Chaudière, à la Batiscan, voire à la Montmorency n’est pas si impressionnante que cela! Alors que le brouillard couvrait encore la surface de cette rivière aux eaux languissantes de teinte brunâtre, nous sommes partis d’un petit carrefour rural du nom de Condol, à quatre kilomètres au sud de Saint-Lô, pour nous rendre aux Claies de Vire, dix-sept kilomètres plus loin. Il s’agissait d’un bout appréciable du chemin de halage entre Pont-Farcy et Carentan aménagé il y a une dizaine d’années dans le cadre d’un projet de développement régional cofinancé par l’Union européenne.
En traversant Saint-Lô, ville de 20 000 habitants, complètement anéantie en 1944 par les bombardements américains, je ne pouvais que penser à mon cousin, Lee Louder, soldat dans l’armée du Général George C. Patton, qui passa par ici dans la foulée du débarquement du 6 juin 1944, et qui mourut trente ans plus tard sans avoir pu refouler le sol français et voir cette nouvelle Saint-Lô et cette Normandie contemporaine que j’aime tant et que je fréquente régulièrement depuis 1963.
Le temps resplendissant d’un matin d’octobre se prêtait à la détente, à la balade à deux roues et à l’observation des vallons verdoyants et des bocages bruissants où broutaient moutons, vaches et chevaux.
Nous déplaçant de Villedieu-les-Poêles à Condol en voiture, Christian m’avait fait remarquer un insigne au bord du chemin : « Chapelle de Jean de Brébeuf »—un des saints Martyrs canadiens. J’habite la paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens à Québec et j’ai visité en juillet dernier Sainte-Marie-aux-pays-des-Hurons, là où de Brébeuf et les autres avaient trouvé la mort en 1649. Quelle meilleure façon de terminer ma journée sur la Vire que de me recueillir à la chapelle érigée ici, selon la plaquette commémorative, en 1993 à l’occasion du quatrième Centenaire de
la naissance en ce lieu de Jean de Brébeuf, Saint et Martyr, Apôtre du Canada, et de faire le tour des vestiges de la maison familiale!
Il s’agit bel et bien d’un autre de ces nombreux lieux de mémoire qui relient le Canada, au sens original du terme, et la France. De par la qualité des aménagements et la beauté de son site, il mériterait une fréquentation plus soutenue, la chapelle n’étant ouverte que de juin en septembre de 15h à 19h.
Jubilé au CRCCF
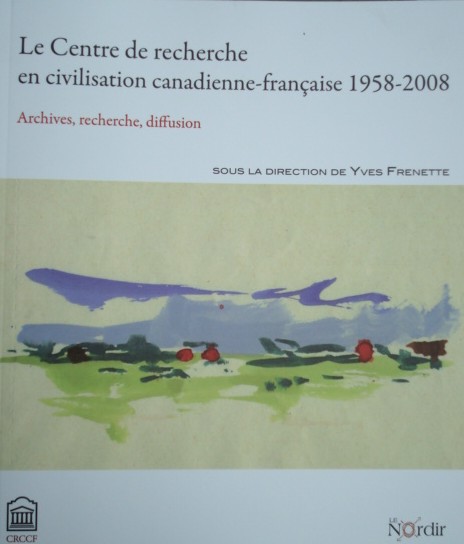
Selon son dépliant, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa s’intéresse à la société et à la culture des communautés francophones de l’Amérique du Nord d’hier et d’aujourd’hui. Le Centre mène des activités de recherche et de diffusion du savoir en plus de conserver et de mettre en valeur une riche collection de ressources documentaires. Le 2 octobre, il a eu 50 ans. Pour souligner l’occasion, le Centre, fondé en 1958 grâce aux efforts de Bernard Julien, Jean Ménard, Réjean Robidoux et Paul Wyczynski, et dirigé aujourd’hui par Yves Frenette organisa un colloque sur le thème : « La francophonie en terre d’Amérique : les
grandes questions ». Celles-ci étaient au nombre de quatre : (1) L’Amérique française : réalité historique ou construction de l’esprit? (2) Que reste-il de la littérature canadienne-française? (3) Le projet franco-canadien est-il compatible avec la diversité ethnoculturelle? (4) Quel a été et que devrait être le rôle des gouvernements dans le développement des communautés francophones?
À prime abord très simples, les questions se sont rapidement avérées très complexes sous l’œil critique des spécialistes appelés à en discuter et de l’auditoire fort nombreux qui en débattait avec ardeur et intelligence.
Assistance
Intervenants à la séance 1 : Martin Pâquet, Jean-Pierre Pichette, Michel Boch
Intervenants à la séance 2 : Marie-Frédérique Desbiens, Johanne Melançon, Pamela Sing
Intervenants à la séance 3 : Dominique Sarny, Monica Heller, Joseph-Yvon Thériault
Intervenants à la séance 4 : François Charbonneau, Daniel Bourgeois, Marcel Martel
Intervenants à la séance de synthèse : Olivier Dard, Gratien Allaire, Jean-Philippe Warren (derrière la tribune).
La veille, les membres du CRCCF et une multitude d’invités avaient rempli la salle de l’ancienne chapelle du Pavillon Tabaret pour écouter Monsieur Serge Bouchard, populaire animateur des émissions à la Première Chaîne de Radio-Canada Les Chemins de travers et Les Remarquables oubliés, les entretenir des grands pans d’histoire canadienne-française rélégués aux oubliettes à la faveur de l’histoire « officielle » émanant de la bouche et des écrits des élites
largement rivées sur les berges du Saint-Laurent, à Montréal et à Québec. Au banquet qui s’ensuivit, le prix du CRCCF 2008 fut attribué à Dean Louder et Eric Waddell. Autant par leur enseignement sur un quart de siècle (cours Le Québec et l’Amérique française offert à l’université Laval) que par leurs publications (Du Continent perdu à l’archipel retrouvé : le Québec et l’Amérique française [1983], repris en anglais en 1992 sous le titre French America : Mobility, Identity and Minority Experience Across the Continent, Vision et visages de la Franco-Amérique [2001] et Franco-Amérique [2008]), ces deux chercheurs auraient joué un rôle de pionnier dans l’étude de la francophonie nord-américaine.
Depuis l’arrivée, il y a trois ans, d’Yves Frenette à la direction du CRCCF, il y a une volonté d’élargir le champ d’études et d’intervention du Centre qui intégrera le mois prochain de nouveaux locaux, plus spacieux et plus harmonieux, au centre du campus. D’une vocation surtout franco-canadienne pour ne pas dire franco-ontarienne, un regard innovateur sur le continent est en train d’émerger, la nouvelle devise du Centre révélant un souci continental : « Comprendre les francophonies nord-américaines ».
Or, la transition du local au continental ne sera pas facile. Les séances et les débats du colloque anniversaire en ont été la preuve. Sur les quatre séances de discussion et de débat, seule la première, avec quelques petits clins d’œil sur les communautés franco de la Nouvelle-Angleterre, évoquait des espaces outre canadiens. Seul parmi les intervenants à ne pas avoir la citoyenneté canadienne, Olivier Dard, de passage à Ottawa de Metz, en France. L’auditoire aussi semblait être tout aussi homogène. Souvent, la discussion s’embourbait dans des questions traditionnelles, mais toujours passionnantes : identité culturelle, relation Québec/hors Québec, rôle du gouvernement dans le maintien des communautés minoritaires…
À plusieurs reprises au cours de la journée, référence fut faite à la politique du Québec à l’égard des Franco-Canadiens et, particulièrement, au nouveau Centre de la francophonie des Amériques (CFA) qui aura, à partir du 18 octobre, pignon sur rue, à Québec. Malgré le refus—ou l’oubli?— du personnel au Secrétariat des Affaires intergouvernementales canadiennes d’accuser réception d’un mémoire qui lui fut destiné le printemps dernier en provenance de MM. Yves Frenette, Gratien Allaire et Rodrigue Landry, directeurs, respectivement, du CRCCF, de l’Institut franco-ontarien (Sudbury) et de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (Moncton), le nouveau CFA à Québec et son directeur, Michel Robitaille, pourront compter sur ces partenaires potentiels. Le mémoire offrait des suggestions d’orientation et identifiait des pistes de collaboration éventuelle. Texte très étoffé, il aurait mérité une réponse!
Le Centre de la francophonie des Amériques…toujours un chantier
À 17 jours de l’ouverture, la fébrilité règne au nouveau Centre de la Francophonie des Amériques, situé au 2, côte de la Fabrique. Ce matin, après avoir validé le positionnement d’une carte géographique au plafond du hall d’entrée de cette magnifique bâtisse en pleine rénovation, grâce aux fonds fournis par le gouvernement français, en vue de son inauguration le 18 octobre à l’occasion du XIIe sommet de la Francophonie, j’ai eu droit à une visite guidée des lieux. Ouf! Que du travail à réaliser d’ici là : parachèvement des cloisons, peinture, emménagement de meubles, installation d’un parc d’ordinateurs, accrochage aux murs de grands écrans cathodiques, réfection des trottoirs en avant et autour… et j’en passe.
Pour le moment, il est impossible de dire autre chose que « ça va être beau! ». Est-ce que le Centre va répondre aux attentes des milliers de Franco d’Amérique en quête d’un pied à terre au Québec? Est-ce que ce sera un lieu convivial et accueillant pour eux? Va-t-il permettre au Québec de devenir la plaque tournante véritable de la Franco-Amérique et d’assumer enfin le rôle de mère patrie à une population deux fois et demie plus grande que la sienne. Deviendra-t-il autre chose qu’un centre d’interprétation froid et aseptisé destiné aux touristes circulant dans le Vieux-Québec qui pourront s’y amuser à « pitonner » et à se reposer quelques minutes après une folle course aux « t-shirts »?
Doté d’un Conseil d’administration visionnaire constitué de représentants de toutes les régions de la Franco-Amérique—autant des États-Unis que du Canada— d’une direction enthousiaste et énergique et d’un personnel hautement compétent, tous les espoirs sont permis!
