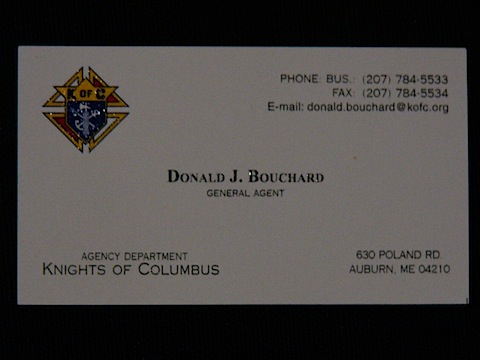Le 7 mai dernier se tint le service funéraire à la mémoire de Louis-Charles Bruniau. À cette occasion, sa veuve, Zina, m’a demandé de livrer quelques remarques à son sujet. Les voici:

Louis Bruniau et moi partagions un certain vécu, celui d’immigrant, lui de France, moi des États-Unis. Louis est arrivé au Québec en 1966, un an après son épouse, Zina. Quant à moi, je me suis installé à Québec en 1971. Dès mon arrivée, j’entendais souvent de la bouche des gens d’ici une expression dont je comprenais les mots, mais pas le sens de ces mots. Ce n’est qu’en 1973, lorsque j’ai rencontré Louis Bruniau pour la première fois que j’ai compris vraiment ce que voulait dire « maudit Français » !
Plus je fréquentais Louis, plus je me rendais compte qu’il y a du vrai dans tous les clichés du genre. Par contre, il y a encore plus de faux, car sous le carapace dur d’un être qui vivait une relation doux-amer avec son pays d’adoption battait le cœur d’un homme généreux, instruit, intelligent, un homme ayant aussi appris les leçons de la vie à la dure école, car Louis, membre de la tristement célèbre, mais glorieuse Légion étrangère avait connu des atrocités des nombreuses conflits de décolonisation que menaient son pays au cours des années 50 : au Vietnam, en Algérie et au Maroc.
« Légionnaire, tu es fait pour mourir et on t’envoie où l’on meurt. »
Voilà la devise qui a défini les contours de la vie de Louis Bruniau des années durant lorsqu’il faisait partie de ce Corps d’élite de l’armée de Terre française.
Après avoir découvert le Québec, Louis, Zina et Éric ont découvert le Canada. Cela s’est fait lors d’un voyage inoubliable qui les a emmenés jusqu’à l’île de Vancouver. Louis me racontait une fois, il y a si longtemps, ce voyage. Il parlait surtout des grands espaces, ces plaines à l’infini, ce grand vide qui sépare l’Ouest de l’Est. Je le traverse souvent ce vide pour me rendre chez mes enfants en Alberta et chaque fois je pense aux peuples autochtones, amérindiens et métis, qui parcouraient, en rois et maîtres, cette vaste région au cours du dix-neuvième siècle et qui gagnaient leur vie de la chasse au bison dont la population était innombrable. Sans doute que Louis y pensait aussi parce que c’était un homme cultivé qui s’intéressait à l’histoire et à la culture. C’est un peu ironique qu’au moment où j’ai appris son décès, je lisais le dernier roman de Jacques Poulin dont l’œuvre fait découvrir pour les uns, et sert de rappel pour les autres, l’importante contribution des Français aux fondements et au développement du continent nord-américain. À la page 86 de L’Anglais n’est pas une langue magique, Poulin cite le grand chef des Pieds-Noirs, Patte-de-corbeau, ami et allié dans l’Ouest des Français et Canadiens français, qui réfléchit sur le sens de la vie :
Qu’est-ce que la vie ? C’est l’éclat d’une luciole dans la nuit. C’est le souffle d’un bison en hiver. C’est la petite ombre qui court dans l’herbe et se perd au couchant.
Autrement dit, dans l’immensité de l’univers et à travers des vastes éternités, la vie est si brève, mais combien marquante.
J’aimerais terminer ces remarques par un poème de Baudelaire, ce poète qui ne fut compris que par quelques uns de ses pairs. En cela, il partageait avec notre défunt ami, Louis. J’ai trouvé trois poèmes de Baudelaire qui traitent de la mort : La mort des amants, La mort des artistes et La mort des pauvres. Je retiens le dernier.
C’est la Mort qui console, hélas ! et qui fait vivre ;
C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre,
Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir ;
À travers la tempête, et la neige, et le givre,
C’est la clarté vibrante à notre horizon noir ;
C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre,
Où l’on pourra manger, et dormir, et s’asseoir ;
C’est un Ange qui tient dans ses doigts magnétiques
Le sommeil et le don des rêves extatiques,
Et qui refait le lit des gens pauvres et nus ;
C’est la gloire des Dieux, c’est le grenier mystique,
C’est la bourse du pauvre et sa patrie antique,
C’est le portique ouvert sur les Cieux inconnus !