Hart Rouge, le géant Beaupré, Carmen Campagne? En avez-vous entendu parler? Que partagent-ils? Une seule et même provenance. Le village de Willow Bunch, en Saskatchewan, fondé en 1880 par Jean-Louis Légaré, originaire de Saint-Jacques de l’Achigan. Commerçant, charretier et aventurier, Légaré est passé par Saint-Paul, au Minnesota, et Pembina au Dakota avant de s’établir à Willow Bunch. De 1876 jusqu’à la date de fondation du village, il a joué un rôle de négociateur auprès des Métis et Amérindiens de la région. Parmi ces derniers se trouvait le grand chef des Sioux, Taureau Assis (Sitting Bull), qui, avec sa bande, s’était réfugié ici à la suite de leur victoire sur l’armée de George Custer à Little Big Horn afin de se protéger des attaques hargneuses de l’armée américaine. Légaré, en tant que « diplomate » et la gendarmerie à cheval du Nord-Ouest ont participé directement à ces événements marquants portés récemment au grand écran par Yves Simoneau dans son film Bury My Heart at Wounded Knee, basé sur le livre du même nom de Dee Brown.
Évidemment, Willow Bunch est un haut lieu de la Fransaskoisie et de la francophonie canadienne de l’Ouest. J’avais honte de n’y avoir jamais mis les pieds. L’occasion s’est enfin présentée le 1er mai 2008. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres sur les Prairies plutôt plates et relativement monotones—surtout à ce temps-là de l’année— quelle ne me fut pas surprise de me retrouver subitement devant une oasis semi verdoyante au fond d’une de ces coulées creusées profondément dans ce paysage autrement aride. Ce qui m’a surpris en tout premier lieu était la petitesse et la banalité de l’église, comparée à celles de Gravelbourg et de Ponteix où les institutions catholiques dominent visiblement. Par contre, l’ancien couvent, aujourd’hui musée, qui héberge aussi le Centre culturel de Talle de Saules, surveille l’entrée du village.
Dans le grand jardin du presbytère, encore gris et aux arbres dénudés, Mme Lorraine Bouvier, originaire de Sainte-Thérèse, à quelques kilomètres de là, travaillait à quatre pattes à nettoyer les dégâts du long hiver et à racler et à enlever les feuilles mortes en vue de la belle saison. Elle me présente son mari, Henri. Sur le coup, je ne les avais pas reconnus, pourtant…
Au fil de la conversation, j’apprends que ce couple fransaskois avait fait carrière dans l’enseignement au Manitoba et qu’à leur retraite ils avaient décidé de quitter le village de Saint-Léon, au Manitoba, et de réintégrer leur Saskatchewan natale. Willow Bunch n’ayant plus de curé résident, il se portèrent acquéreurs du presbytère.
Saint-Léon! J’y étais allé en 1982 accompagné d’une vingtaine d’étudiants de l’université Laval. En apprenant cela, Lorraine exclama, « Mais vous êtes le prof de Laval. Nous avons accueilli vos étudiants chez nous à Saint-Léon! Ils y étaient couchés ‘mur à mur’ ».
Et voilà, tout me revenait! Je les connaissais ces braves gens qui nous avaient rendus de si grands services 26 ans auparavant. Des retrouvailles amusantes et émouvantes! En nous quittant, une invitation à revenir plus tard…n’importe quand!
Donc, en route vers l’Ouest deux mois et demi plus tard, j’ai de nouveau dirigé mes pas vers Talle de Saules dans le but de revoir les Bouvier et d’évaluer la floraison de leur parterre. Frustré par l’absence de mes amis, mais conscient du fait que j’arrivasse quand même à leur insu, j’ai pu néanmoins me promener dans ce petit Éden et admirer les fruits du dur labeur dont j’avais été témoin quelques semaines auparavant.
Ces jours-ci, les Bouvier collaborent avec l’Institut français de l’université de Régina à l’organisation de la 2e Table ronde itinérante des Francophones et des Métis de l’Ouest canadien qui aura lieu à Talle de Saules du 19 au 21 septembre 2008. Cette rencontre communautaire, où se conjugueront partage, apprentissage et célébration, vise à rétablir un dialogue constructif entre deux groupes qui se sont éloignés l’un de l’autre au cours du dernier siècle. Ce beau logo intégrant des symboles des deux cultures, métisse et canadienne-française, en dit long sur la possibilité de projets d’avenir.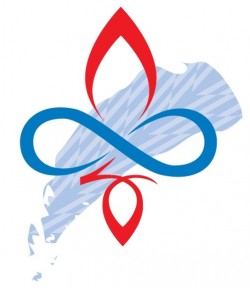
Author Archives: Dean Louder
Mario Dumont à l’école du « ouï-dire »
Voyons Mario! As-tu déjà étudié dans un « high school » américain? Es-tu déjà passé par les portes d’école affichées « Fire arms forbidden » (port d’armes à feu défendu)? As-tu vu le film du grand Michael Moore, Bowling for Columbine ? T’y es-tu déjà levé à tous les matins de l’année scolaire, main sur le cœur, pour prêter serment au drapeau des États-Unis d’Amérique? Sais-tu de quoi tu parles, Mario?
Moi, oui, Mario! J’ai été de ces jeunes hommes qui portaient fièrement le veston bleu de mon école, frappé de la lettre O en or (Orem High School), un vrai Tigre! Car sur mon O se trouvaient cousus de petits écussons, symboles de ma réussite au basket, au football et au baseball. Oui, j’avais un fort sentiment d’appartenance. Cependant, seuls les athlètes avaient le droit d’en porter. Les « bollés » devaient se contenter de certificats, de parchemins, d’un bon mot par ci par là de la part d’un enseignant ou d’une enseignante—rien de trop visible. Leur sentiment d’appartenance s’avérait moins solide.
Nos écoles au Québec sont-elles si mauvaises? En 1985, moi et ma famille avons passé un an en Arizona. Ma fille, Jolyn, venait de finir son Secondaire-IV à l’École de Rochebelle. C’est l’équivalent du « grade 10 » dans le système américain qui exige douze ans d’études pour obtenir le diplôme d’études secondaires. En cette fin du mois d’août 1985, à l’examen de ses relevés de notes des Secondaires III et IV, l’orienteur lui a annoncé qu’elle avait déjà obtenu un nombre suffisant de « crédits » pour se qualifier au diplôme et que ces « crédits » étaient correctement répartis entre sciences physiques, mathématiques, sciences sociales, « humanités » et cours facultatifs. De plus, elle parlait couramment deux langues, ce que la vaste majorité des jeunes de McClintock High School ne pouvaient faire.
Pour se qualifier au diplôme, il a fallu seulement que Jolyn suive trois cours : histoire des États-Unis, histoire de l’Arizona, institutions politiques locales et fédérales. Sourire en coin, j’ai dit à l’orienteur, « Vous devez lui faire suivre des cours de propagande afin d’en faire une bonne Américaine ». Ce à quoi il a répondu sur un ton narquois, « Ouais, c’est à peu près cela ».
Jolyn fit donc partie des finissants de 1986 de McClintock High School, à Tempe, en Arizona. Elle en a été contente et fière. La cérémonie de « graduation » eut lieu par une belle soirée du printemps dans le stade de football des Chargers de McClintock. Il s’agissait d’un diplôme qui lui a permis d’entrer l’année suivante dans un collège communautaire aux États-Unis et, éventuellement dans un cégep au Québec. Cette année-là, elle a beaucoup appris sur la culture du pays d’origine de ses parents, sur les mœurs des gens de la région de Phoenix et sur l’éducation qu’elle avait reçue au Québec…qui n’avait pas été si pire!
La Grand-messe de Céline vécue par un « infidèle »
Je ne peux que joindre ma voix à celle du chroniqueur du Soleil François Bourque qui commentait ce matin la grand-messe du vendredi soir. Lui, comme moi, « …a revu Québec, fébrile et fière d’être un soir encore le centre du monde. Sur la route des Plaines, la procession des fidèles marchait dans l’allégresse…en direction ouest sur Grande Allée, face au soleil couchant, le peuple élu, les appelés de Dieu, détenteurs des billets donnant accès aux meilleures places…dans l’autre direction, les pécheurs sans papiers. Un long pèlerinage vers les lieux saints ». Les fidèles prenaient ainsi place devant l’autel de la diva bien aimée.
Avec les pécheurs, je me suis retrouvé accroché à la clôture en fer forgé qui borde l’extrême nord des Plaines dans ce secteur, face à face à un « infidèle », un enseignant de la région de Toronto qui avait prolongé les vacances de son couple à Québec d’une journée afin d’assister à la grand-messe. Il se vantait des grandes célébrations auxquelles il avait déjà participé : AC-DC, Rolling Stones, New Orleans Jazz Festival (trois fois), etc. Tout cela, cependant, ne l’avait pas préparé à la spécificité de ce qu’il allait vivre vendredi soir. Jack, un nom de ma fabrication parce qu’il ne m’a pas donné le sien, a dû ressentir dans cette foule un peu ce que j’avais ressenti en 1977, en assistant à un match de football réunissant deux équipes d’universités louisianaises dont la population estudiantine est afro-américaine à plus de 90%, Southern et Grambling. La joute, tenue dans le Super Dome de la Nouvelle-Orléans, constitue possiblement le plus grand « happening » de l’année chez les Afro-Américains qui comptent quand même 32% de la population de l’État. Endimanchés au possible en ce samedi après-midi, ils remplissaient l’enceinte pour encourager leurs équipes respectives. Assise à ma gauche, ma conjointe, à ma droite, un ami, autour de nous 69 997 visages noirs.
Pauvre Jack! Au fur et à mesure que les fidèles arrivaient, il entendait de moins en moins sa langue. Il s’énervait visiblement. Une chance que j’étais là! Par contre, le fait de converser avec « un Américain de Seattle » qui avait choisi d’élire domicile à Québec en 1971 et qui semblait s’en tirer pas mal—car il est encore là—le déboussolait passablement. Dans sa tête de « bloke », un Anglo à Québec ne pouvait que se sentir persécuté, seul et malheureux.
-Quelle est la raison principale pour laquelle vous aimez vivre ici? demande Jack.
Rapidement, j’énumère trois raisons :
1. La qualité de vie ici est supérieure à toute autre ville que j’ai connue.
2. Le rythme de vie ici respecte l’être humain.
3. La ville permet à celui ou à celle qui aime la langue française et qui désire vivre en français de le faire pleinement. C’est la seule grande ville en Amérique du genre.
Les deux premières explications lui ont plu. La troisième était pour lui incompréhensible. À un moment donné, à la suite de mes révélations concernant l’identité des invités de Céline (Garou, Zachary, les Aiëux, Dan, Éric, Jean-Pierre, Ginette, etc.), tous des francophones dont il n’avait jamais entendu parler, Jack m’a chuchoté « mais elle va chanter en anglais, n’est-ce pas? »
« J’espère que non! » lui dis-je. Il me regarde de travers.
Mon nouvel ami a pu « tuffer » la première demi-heure du spectacle, mais c’était plus fort que lui. Il ne comprenait pas les paroles des chanteurs, ni la langue « étrangère » parlée par les gens autour de nous. De plus, il s’inquiétait de sa voiture stationnée à l’université Laval et de comment il ferait pour la retrouver et retourner à son motel à Sainte-Anne-de-Beaupré.
Vers 21h30, il en avait eu assez. « Quel autobus avez-vous dit? »
« Le 800 ou le 801 ».
Sur cela, Jack a empoigné le bras de son épouse et ils ont disparu dans la nuit.
Et les fidèles ont communié jusqu’aux petites heures!.
Jean-Marie Nadeau sur Québec, la magnifique
Jean-Marie Nadeau est chroniqueur à l’Acadie Nouvelle, seul quotidien de langue française des provinces Maritimes. Les textes de cet « autonomiste » acadien publiés tous les mardis matins sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Celui d’aujourd’hui, écrit à la suite de son passage à Québec la semaine dernière pour fêter l’Acadie, mérite l’attention des lecteurs québécois. Je vous l’offre donc sur mon blogue. Ceux et celles désirant communiquer directement avec Jean-Marie peuvent le faire à l’adresse suivante : jmacadie@nb.sympatico.ca

J’étais à Québec la semaine dernière pour fêter l’Acadie qui se présentait en ville avec ses plus beaux habits : un tintamarre retentissant, un spectacle acadien de haut calibre en toute modernité, et une réception fort sympathique organisée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Même s’il y a eu des démêlés inacceptables entourant le 400ième anniversaire de l’établissement permanent de cette ville et celui de notre 404ième comme peuple, Québec mérite la majesté de ses festivités. On ne peut que tomber sous le charme de cette ville, surtout le Vieux-Québec. Québec est en partant un bijou du patrimoine nord-américain et mondial…en français. Et dieu que ça fait du bien de passer quelques jours à entendre parler principalement français, tout en entendant autant d’allemand, d’espagnol, d’italien, de japonais que d’anglais!
Le tintamarre a été un grand succès, débordant d’émotion. Il y avait autant , sinon plus de Québécois tout au long du parcours que d’Acadiens dans le tintamarre. Ce fût donc une activité en dehors du commun, permettant aux deux peuples francophones d’Amérique de se côtoyer enfin dans l’harmonie, la solidarité, et la joie mutuelle de se rencontrer et de s’apprécier.

Ça donne envie de trouver des moyens, comme cette présence acadienne réussie à Québec cette année, pour faciliter des rapprochements plus conviviaux entre nos deux peuples. Pour briser les murs de la méconnaissance mutuelle. Pour extirper cette acrimonie et ces ressentiments qui existent entre nous depuis que le peuple québécois a entamé un processus pour s’assumer pleinement à part entière, pour ne pas dire souverainement.
Il faut donc célébrer les initiatives des deux gouvernements, qui par le biais d’un organisme communautaire comme le Conseil économique du Nouveau-Brunswick et son homologue québécois, ont organisé des sommets économiques entre les entrepreneurs de chaque province. De tels événements se sont déjà tenus à Edmundston et Rivière-du-loup ces dernières années. Régis Labeaume, maire actuel de Québec et coorganisateur québécois avec Paul Aucoin, son pendant acadien et ancien directeur général du Conseil économique chez-nous, ont été honorés en recevant chacun une médaille de reconnaissance Québec-Nouveau-Brunswick pour leur engagement.
Benoit Pelletier, ministre québécois responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, a également reçu la médaille Léger-Comeau de la Société nationale de l’Acadie pour sa contribution à l’avancement des relations québécoises avec les communautés francophones et acadiennes du Canada. Cet honneur est hautement mérité. Depuis Claude Ryan, le ministre Pelletier est probablement le politicien québécois à avoir la meilleure connaissance et sensibilité face aux réalités que nous vivons comme communautés acadiennes et francophones au pays.
Mais, il ne faut pas se faire d’illusion. Le projet de souveraineté québécoise est loin d’être mort. Il est plutôt en sommeil, et même las pour le moment. Il est fascinant de constater jusqu’à quel point le gouvernement canadien, qui a financé en grande partie les activités du 400ième de Québec, a tenté d’y occulter le drapeau québécois, par exemple. Si les fédéralistes canadiens et québécois continuent à manœuvrer en sourdine pour imposer le Canada aux Québécois de cette façon, plusieurs de ces gestes seront bientôt démasqués et se retourneront contre eux.
Mais, ils ne sont pas les seuls. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick semble avoir aussi tout fait pour occulter d’une certaine manière l’appellation acadienne dans l’organisation de ces activités à Québec. On « pushait » autant le drapeau « NB » que le drapeau acadien. Et il parait qu’on ne devait pas trop utiliser du « bonne fête l’Acadie » dans les activités officielles. Ce n’est pas la première fois qu’on est témoin de tels gestes inconvenants. Comment pense-t-il qu’on puisse troquer le label « acadien » pour celui de « NB », à prononcer à l’anglaise ou à la française, et prendre notre place hors Nouveau-Brunswick? Sans les Acadiens du Nouveau-Brunswick, notre province serait une province anglaise comme les autres, surtout au Québec…Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne devrait pas trop jouer sur ce terrain de cette façon.
Ces petites gamineries fédérales ne feront que nourrir à la longue la grogne souverainiste au Québec. Quant aux gamineries néo-brunswickoises, elles produiront là aussi un effet de ressac acadien. Ces mesquineries n’ont plus leur place.

Pour terminer sur une note plus positive, il parait évident que Québec la magnifique a tout de même bien réussi son 400ième , comme elle a réussi en grand son accueil de l’Acadie. Le maire Labeaume a déjà énoncé l’intérêt de Québec à recevoir le Congrès mondial acadien 2014. Le crû 2008 de l’accueil de l’Acadie sera un atout de plus dans son jeu. Merci Québec!
Raymond, Alberta… mon chalet lointain!
J’envie mes amis, mes collègues et mes voisins à Québec qui ont un chalet dans Charlevoix, sur la Côte-du-Sud ou à Lac-Saint-Joseph. Je n’ai pas cette chance-là. Le mien se trouve à 3 800 km du domicile principal situé sur l’avenue du Cardinal-Bégin! Évidemment, je n’y vais pas à toutes les fins de semaine, mais cela fait quand même une dizaine de fois que j’y vais en trois ans. À quoi bon avoir un chalet à l’autre bout du continent? Et bien, cela fait découvrir du pays et les quelques récits qui vont suivre en rendront témoignage, car ils relèveront des faits saillants de deux voyages en trois mois entre Raymond et Québec. De plus, avoir un chalet à Raymond permet à son épouse de passer cinq ou six mois par année en Alberta « tropicale », loin de la neige et de l’hiver québécois, et près des trois enfants et dix petits enfants qui l’habitent!
À vrai dire, ce n’est pas un chalet que j’ai, mais un tout petit appartement situé dans un demi sous-sol d’une belle grande maison, à la cour immense et luxuriante, sur Broadway, à Raymond dont la population vient de franchir,
<img alt="appartement.JPG" src="https://blogue.septentrion.qc.ca/wp-content/uploads/archives/deanlouder/appartement.JPG" width="480" height="360" /
après 105 années d’existence, le cap des 3 500 habitants. Les propriétaires, Sherrel et Maureen, un couple de mon âge, habitent au-dessus de ma tête. On ne les entend pas et ils ne nous entendent pas non plus.
Le maire, George Bohne, et les édiles municipaux sont en extase car le nombre de nouvelles constructions est passé de 10 par année, sur une très longue période, à 26 en 2006, à 69 en 2007 et à 33 pour les six premiers mois de 2008. Ils espèrent que la construction en cours d’une grande pharmacie—genre Jean-Coutu—sur une rue principale en déchéance depuis 40 ans, va ressusciter le commerce ici à l’ombre de Lethbridge (population 90 000) et ses multiples centres commerciaux dominés par les géants des industries de la consommation domestique.
Raymond trace ses origines à l’arrivée dans la région en 1887 d’immigrants en provenance de l’Utah qui ont apprivoisé ce terroir aride en lui apportant une technologie permettant l’irrigation. Ils ont participé activement à la construction du canal Galt, précurseur du système St. Mary’s et d’autres schémas d’irrigation rendant possible la production de plusieurs céréales et l’élevage. Or, ce qui a fait le succès de Raymond dans un premier temps, ce sur quoi l’économie locale était basée pendant un demi-siècle est la betterave à sucre. Un industrialiste mormon bien
nanti de l’Utah, Jesse Knight, vint ici au tournant du vingtième siècle construire une sucrerie, désaffectée depuis les années 60, et donna au village le nom de son fils Raymond qui deviendrait en quelque sorte le notable de la place. Aujourd’hui on lui attribue l’instauration du Stampede de Raymond, le plus vieux rodéo de tout le Canada. Le 1er juillet de chaque année, l’événement fait tripler la population du bourg.
Lorsque je suis ici, je m’ennuie au bout d’un certain temps. Je m’ennuie du Québec. Je m’ennuie de parler français. Mais j’ai découvert qu’en Amérique du Nord, quand on cherche le français, il est là, même dans le coin le plus conservateur de cette Alberta de William Aberhard. Ernest Manning, Peter Lougheed, Preston Manning, Ralph Klein et—yes—Stephen Harper! C’est pour cela qu’à l’été 2006, j’ai réussi à mettre sur pied, le temps d’un pique-nique, L’Amicale francophone de Raymond. Les membres sont très diversifiés : un menuisier originaire de Joly, au Québec, deux sœurs commerçantes et leurs vieux parents, originaires du sud de la France, un pompiste au poste d’essence, fils légèrement handicapé de l’une des commerçantes, des Québécois enseignant à l’école française de la Vérendrye à Lethbridge, un administrateur de Marseille ayant passé aussi par la Polynésie
française, un ancien pilote de ligne et sa femme parisienne, chanteuse d’opéra et écrivaine, un Franco-Albertain d’Edmonton, de jeunes francophiles issus des écoles d’immersion et des anciens missionnaires de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ayant séjourné au moins deux ans dans un pays de langue française. Ce qui soude ces gens ensemble et explique leur présence à Raymond, c’est leur foi religieuse et leur volonté de contribuer à la solidarité de cette petite ville généreuse et bonne.
