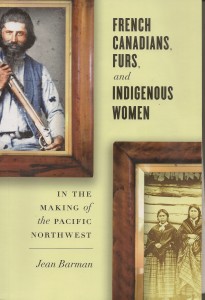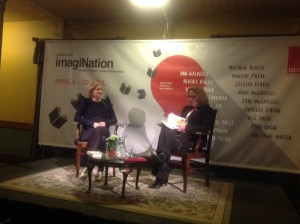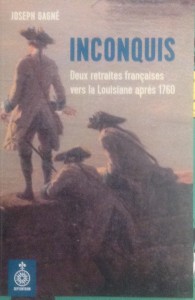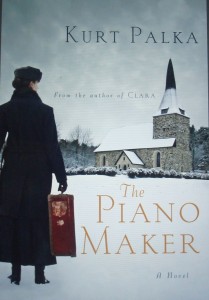Depuis sept ans déjà, en avril, au Centre Morrin, 44, Chaussée des Écossais à Québec, se tient une activité littéraire de premier plan, ImagiNation. Ce festival d’écrivains, qui réunit des auteurs de tout genre venus largement du Canada anglais pour faire connaître leurs œuvres et en discuter, s’est amorcé le jeudi soir 6 avril et se poursuivra jusqu’au dimanche 10. En tout, une vingtaine d’auteurs partageront généreusement leur temps, leur talent et leurs connaissances avec un petit public assoiffé d’en savoir davantage, car à Québec—il faut l’avouer—de tels contacts avec l’autre Solitude sont plutôt rares. L’activité cadre parfaitement bien avec la mission du Centre Morrin qui abrite la Literary and Historical Society of Québec, la première société savante fondée au Canada en 1824.

Je me trouverai chaque jour dans ce lieu magique à écouter et à prendre des notes. Peut-être poserai-je même une question de temps en temps. Avec les autres participants, j’aurai hâte de gagner l’un des prix de présence et, comme eux, je profiterai de l’occasion pour me payer une consommation afin de lubrifier le gosier et de faciliter la discussion. Dans la mesure du possible, je résumerai ici chaque jour l’essentiel de ce que j’y aurai entendu. Évidemment, compte tenu de mes autres obligations, je manquerai certaines séances. Commençons toutefois par les deux auteures qui ont parti le bal : Anne Walmsley et Heather O’Neill.

Madame Walmsley est une journaliste dont les articles sont publiés, entre autres, par le Globe & Mail et Maclean’s. Elle vient de publier The Prison Book Club qui est en lisse pour plusieurs prix. Le titre du livre cadre bien avec la première vocation de l’édifice dans lequel nous nous trouvons, une geôle. Victime d’une agression par deux hommes contre sa personne à Londres, elle a hésité momentanément à se joindre à son amie, Carole, qui venait de fonder un club de lecture à l’intérieur de la prison à sécurité moyenne/maximale de Collins Bay, près de Kingston. Son livre raconte cette expérience. Il s’agit presque d’une étude ethnographie, entrevues avec détenus à l’appui, qui suggère que la lecture est une activité « humanisante » qui pourrait très bien servir à la réhabilitation de prisonniers. En fait, selon l’auteur, il existe aujourd’hui au Canada 22 cercles de lecture dans 15 prisons fédérales, y compris celle de Joliette.
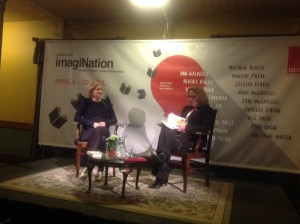
Madame O’Neill, âgée de 42 ans et écrivaine montréalaise, a très tôt décidé de sa vocation future. Abandonnée par sa mère et désabusée par un père insouciant, elle se faisait une vie à la bibliothèque et dans des livres. Son œuvre, tantôt fantaisiste tantôt réaliste, reflète ce qu’elle appelle « joy in loneliness ». (joie dans la solitude). Cette préoccupation est très évidente dans le titre de la collection de nouvelles qu’elle nous a présentée, Daydreams of Angels et dans un roman qui l’a précédée, The Girl Who Was Saturday Night. Elle aime dire que ses livres contiennent la sagesse d’un perdant (wisdom of a loser).

Contrairement aux séances de la veille peu peuplées, celle du 7 avril consacrée à l’œuvre de l’auteur albertaine, Will Ferguson, a fait salle comble au Centre Morrin. Cela s’expliquait certes par la renommée de l’invité qui semblait, dès le début, jouir de la reconnaissance de l’assistance, mais aussi par la séance qui l’avait précédée à laquelle je n’avais pu assister, celle-ci sur le thème de la viticulture (Tasty Books : A Book and Wine Pairing Event) animée par le sommelier, Yann Barrette-Bouchard. Évidemment, il y avait eu dégustation !
Né à Fort Vermillion, village cri et métis au nord de l’Alberta, Will Ferguson s’en est sauvé le plus tôt possible. Avant de commencer ses péripéties globales, il a eu néanmoins le temps de terminer un baccalauréat en études cinématographiques à l’Université York. Par la suite, basé au Japon, Ferguson sillonnait l’Asie, passant par la Chine, la Corée du Sud, la Malaisie, et l’Indonésie. Après un mariage traditionnel avec une Japonaise, dont la cérémonie l’avait beaucoup fait souffrir, le couple s’établit à Charlottetown où Will essaie de gagner sa vie au PEI Guardian. L’expérience lui vaut de nouveaux contacts avec des Japonais qui se ruent en troupeaux vers la Maison aux pignons verts. De l’île, il se rendra à Moose Jaw et à bien d’autres endroits au Canada, ce qui donnera lieu à un livre satirique and humoristique Why I Hate Canadians. Il écrira aussi dans cette lignée Bastards and Boneheads et Canadian History for Dummies. Malgré cette « haine imaginaire », il fond foyer dans la région de Calgary.
Ce soir, il fut davantage question de ses deux plus récents ouvrages, 419, un roman se déroulant au Nigeria, et Road Trip to Rwanda : A Journey into the Heart of Africa. Sachant mélanger humour et profondeur, Will Ferguson est un conférencier chevronné. Son propos d’une durée de 50 minutes paraissait davantage comme une petite intervention de cinq minutes tellement le temps a vite passé sous les rires et sourires suscités par son style. Ce qui m’avait le plus frappé, c’est que je me sentais ailleurs—au Canada anglais ou aux États-Unis. Les principaux référents de Will Ferguson, malgré des contacts passagers avec le monde franco-canadien (le Québec et l’Acadie) viennent du monde anglo. J’ai remarqué que pour les quelques Franco-Québécois dans la salle, ses histoires et son style n’avaient pas la même portée, le même « punch ». Faisant allusion aux petites histoires d’aventure racontées aux enfants en Amérique depuis des éons—des histoires qu’il lit encore à son fils—Ferguson citait « The Hardy Boys » pour les garçons et « Nancy Drew » pour les filles. Ce sont les mêmes histoires que ma mère lisait à moi et ma soeur dans les fins fonds de l’Utah lorsque nous avions l’âge du fils. Au final, après m’être régalé des propos, des aventures et de la sagesse de Will Ferguson, je suis néanmoins sorti de la salle avec le sentiment que son Canada avait beaucoup plus à faire avec mon ancien pays, les États-Unis, qu’avec mon Canada [français].

Le premier roman publié (il prétend en avoir écrit six autres qui ne l’ont pas encore été !) du jeune auteur ontarien, Clifford Jackman, The Winter Family, fut finaliste au concours du prestigieux Prix Giller d’une valeur de 50 000$ attribué chaque année, en novembre, à l’auteur d’un recueil de nouvelles ou d’un roman canadien anglais. Le vendredi soir, au Centre Morrin, il en a été question. De toute évidence, il s’agit d’un Western noir d’une violence inouïe. Je vais en savoir davantage plus tard, car c’est moi qui l’ai gagné en tant que prix de présence. Une fois que j’en aurai terminé la lecture, j’en ferai un compte rendu dans cette chronique. Suffit de dire tout de suite que l’action se passe dans le sud des États-Unis où, sur un quart de siècle, une bande de hors-la-loi, la famille Winter, qui n’est pas une famille soit dit en passant, mais un amalgame de bandits de diverses provenances, terrorise un vaste territoire centré sur l’Oklahoma. À deux reprises, lors de son allocution, l’auteur exprimait l’idée que la violence et la brutalité telles que manifestées dans son livre, sont issues de « nos racines » , ce à quoi l’auditoire ne semblait pas d’accord. Comment l’auteur, Canadian de souche, né à Deep River, en Ontario, a-t-il pu rompre avec la thèse qui veut que les mœurs et rapports sociétaux canadiens diffèrent largement de ceux du puissant pays au sud. Un peu déconcertant, mais qui vient confirmer ce que je disais plus haut, à savoir que quand il est question de distinguer entre les États-Unis et le Canada anglais, les différences peuvent être floues et la frontière mince.

Il y a un an, presque jour pour jour, Paul Almond est mort à 84 ans. Sans doute plus que tout autre artiste, ce Gaspésien de Shigawake, qui a fait carrière dans les arts de la scène et du livre, , a marqué, grâce à sa présence à répétition, l’histoire de ce festival littéraire (ImagiNation). Cela expliquerait pourquoi s’est tenu en fin de soirée un hommage à M. Almond en présence de Jay Iversen, un collaborateur de longue date dans le domaine du cinéma, et de Danielle Cyr, la traductrice attitrée de The Alford Saga, œuvre de fiction en huit volumes basée sur ses racines familiales en Gaspésie, écrite dans ses vieux jours. Mentionnons également la présence en salle de son frère, Ted, venu de Shigawake, lui qui avait été indispensable, comme personne ressource, tout au long de la rédaction de la Saga.
En concevant, en 1963, l’émission « 7 Up », Almond a investi l’industrie télévisuelle britannique. Par la suite, mettant en vedette sa seconde épouse, Geneviève Bujold, avec laquelle il a eu un fils, Matthew, il a tourné à Toronto et à Hollywood deux films : Isabel, en 1968, et Act of the Heart, en 1970. À la fin de la soirée, une fois la discussion de la vie et de l’œuvre de Paul Almond terminée, l’auditoire a pu visionner l’un de ses documentaires présentés en 1964 sur les ondes de la CBC. Tourné en noir et blanc, le court métrage rappelait la Gaspésie des années 1930, la Gaspésie bucolique et paisible de son enfance.
C’est Danielle Cyr qui, à la fin de la soirée, a le mieux résumé l’héritage littéraire de Paul Almond : « It was a long, long love letter ».

La très dynamique Jacqueline Guest, enseignante et écrivaine du piémont des Roches en Alberta a épaté les quelques enfants, parents et grands-parents venus l’écouter tôt le samedi matin. Auteure de 19 livres pour enfants sur des sujets aussi diversifiés que le hockey, les Métis et les dinosaures, Jacqueline nous a expliqués comment écrire une histoire par la technique des 5W : Who (qui), What (quoi), Where (où), When (quand), Why (pourquoi). Les enfants participaient vivement à la causerie.


Écouter Jack Hannan, c’est comme relire La Tournée d’automne de Jacques Poulin. On a affaire à un véritable « homme de livres », un gars qui ne vit que pour des bouquins. Il les conçoit, les écrit, les publie et les vend. Sous une réserve abasourdissante, ce libraire et ancien poète montréalais, qui a lâché la poésie en 1976 pour la reprendre 20 ans plus, nous lisait de son premier et seul roman, The Poet is a Radio. Puis, sortaient de sa bouche spontanément ces quatre gemmes de la sagesse reflétant sa philosophie personnelle:
- Ces gens [les personnages créés pour son roman] deviennent tes gens. Tu préfères passer du temps avec eux…[au lieu de le passer avec des êtres vivants].
- Je me trouve devant un dilemme. En même temps que je pense que nous devrions vivre de manière minimaliste en nous débarrassant des surplus que nous possédons, je viens ici vous inciter à consommer et à cumuler en achetant mon livre.
- Un livre n’est pas le meilleur endroit pour lire de la poésie. Qui veut lire poème après poème après poème consignés à un livre comptant 200 pages ? Le meilleur poème est celui que quelqu’un te donne.
- Il existe trois lieux dans le vie de chacun : (1) chez soi ; (2) lieu de travail ; (3) lieu où se tenir quand on n’est ni à la maison ni au travail. Un endroit où on aime être, où on se sent confortable. Pour les uns, c’est un bar, un gymnase ou un aréna. Pour les autres, comme moi, c’est une librairie.

Sonia Faruqi veut sauver la planète! Contrairement à bien des idéalistes qui ne font que rêver, cette jeune femme d’origine pakistanaise, ayant vécu à Dubaï et étudié à Dartmouth, a agi. Son livre Project Animal Farm : an Accidental Journey into the Secret World of Farming and the Truth about our Food suit une carrière—la sienne—qui, après de grandes études, commence sur Wall Street et bifurque vers des recherches engagées en agro alimentation qui visent à améliorer les conditions d’élevage et de santé publique. D’une naïveté certaine, il faut tout de même louanger la détermination, l’audace et l’optimisme de la jeune femme.

Rafraîchissant ! Dynamique ! Énergique ! Divertissant ! Provocateur ! Amusant ! Philosophe ! Voilà, à peu près tout ce que j’ai à dire sur Monique Polak et sa prestation sur Alice aux pays des merveilles dont on fête cette année le 150e anniversaire de publication. Cette journaliste, animatrice et professeure se dit « possédée par Alice depuis toujours », ayant lu le livre « au moins 600 fois » ! Avant de creuser dans les profondeurs de ce conte tant aimé, Monique nous a entretenus de la personnalité et du génie de son auteur, Lewis Carroll—Charles Lutwidge Dodgson de son vrai nom. Puis, l’histoire est décortiquée et analysée sous cinq angles : (1) identité ; (2) changement ou transformation ; (3) historicité ; (4) conventions sociales ; (5) justice. Monique Polak insiste sur le fait que Alice’s Adventures in Wonderland ait changé la littérature jeunesse à jamais et qu’il continue à enchanter des lecteurs et lectrices de tous âges. À la fin de la présentation, SURPRISE ! Monique a invité ceux et celles qui le connaissaient à se lever et à venir en avant réciter avec elle le poème « Jabberwocky » de Lewis Carroll. Une seule personne a relevé le défi et elle a réussi le coup : Kathryn Burgess, pasteure de l’église St. Andrew’s… mon église préférée dans le Vieux-Québec soit dit en passant.

Jeffery Deaver est de ces auteurs qui publient un roman par année. Pas besoin d’aller dans une bibliothèque ou une librairie pour se procurer ses livres. Aux États-Unis, ils sont en vente chez Walmart, Costco, Target. You name it ! Ils se classent parmi les livres populaires des auteurs tels que Nora Roberts, Danielle Steele, Ken Follet et John Grisham. Il en est de même probablement à Montréal et au Canada anglais. Je ne sais pas trop. Ce que je sais cependant, c’est que ce prolifique auteur nous a offert samedi soir la recette pour publier un roman. Simple comme bonjour ce travail solitaire! Cela se passe en huit temps : (1) Répondre à la question « pourquoi écrire » ; (2) Trouver un sujet ; (3) Planifier ou organiser le roman ; (4) Écrire-le ; (5) Éditer et réviser ; (6) Éviter le syndrome de la page blanche ; (7) Critique et réjection ; (8) Promotion. Pour chacun des ingrédients de cette recette, Deaver « plagiait » (il l’a dit lui-même) plusieurs grands auteurs de la littérature de langue anglaise. J’en ai conclu qu’il y a autant de points de vue et de méthodes de travail qu’il y a d’auteurs. Deaver lui-même préconise l’utilisation du « plan » (outline). Avant d’écrire le premier mot de son roman, Deaver aura passé huit mois à en faire l’architecture. Une fois cette structure en place, il passera deux mois à écrire. Pendant ce temps-là, il ne lira aucun ouvrage d’un autre auteur afin de ne point se laisser influencer! Pour terminer, il nous a expliqué sa motivation : a passionate desire to relate with the hearts and minds of readers. Il a une peur bleue de les decevoir. Curieusement, Deaver n’a fait qu’affleurer son nouveau « thriller », Steel Kiss.

Grâce à la musique, la famille McGarrigle jouit d’une notoriété singulière dans le milieu Anglo Québécois. Bien que moins connues des Québécois francophones, Anna et Kate McGarrigle se produisaient presque autant en français qu’en anglais. La farce courait à un moment donné, qu’elles chantaient trop en français pour être invitées aux festivités de Canada Day, et trop en anglais pour participer aux spectacles de la Saint-Jean-Baptiste. Les deux sœurs survivantes, Anna et Jane, l’aînée, Kate s’étant éteinte en 2010, se sont concertées pour publier, en 2015, chez Random House, un livre, Mountain City Girls :The McGarrigle Family Album. Il ne s’agit surtout pas d’un récit consacré à la brève, mais glorieuse, carrière de Kate et Anna qui ont côtoyé des icones de la musique folk/rock des années 70 et 80. Parmi leurs amis et collaborateurs de l’époque : Bob Dylan, Linda Ronstadt et Emily Lou Harris. Au contraire, le livre qui s’arrête en 1975 environ, rappelle des souvenirs d’une enfance heureuse et d’une adolescence mouvementée. Les auteures rendent hommage à leurs parents , mais aussi à des oncles, tantes et cousins. Frank, né au Nouveau-Brunwick, a choisi de vivre au Québec qu’il adorait. « Il ne pouvait pas parler français, mais le parlait quand même », a dit Anna (He couldn’t speak French, but did so anyway !). Lui et sa femme, Gaby Latrémouille ont élevé leurs filles à Saint-Sauveur, dans les Laurentides. Samedi soir, nous avions droit non seulement à la lecture de quelques extraits de Mountain Girls, mais aussi à quelques chansons de ces femmes qui ne chantent plus, pour ainsi dire, en public.

La traduction est un art. Pour clore les activités du Festival des écvrivans, trois personnes chargées par leur métier de faire le pont entre les Deux Solitudes (anglo/franco) étaient réunies pour en parler : Paul Gagné, Lori Saint-Martin et Neil Smith. Il a été un peu question du colossal travail de traduire l’œuvre de Mordecai Richler avec tous les pièges que cela comportait, à la fois ici, et outre Atlantique, car il faut se rappeler que les traducteurs d’ici travaillent pour deux lectorats, l’un français et l’autre québécois. Le traducteur doit trouver le mot juste, oui, mais il doit aussi adapter et parfois contextualiser. Il faut travailler de près avec l’auteur et les éditeurs qui, souvent, ne comprennent pas l’autre langue. Pour illustrer leurs propos, les traducteurs ont pris le fameux example des jurons et des sacres. Comment traduire pour les Français, Américains ou Canadians les « câlice, tabernak, baptême… » ? Que faire des « putains de merde » des Français? Et le fameux F-word qui parsème en abondance les écrits de certains auteurs anglophones ?
Observation fort intéressante et révélatrice de la part de Neil Smith qui explique la facilité avec laquelle les écrits de la Québécoise, Kim Thuy, voyagent du français à l’anglais, du Québec au ROC–beaucoup plus facilement que pour la vaste majorité des auteurs québécois–de la manière suivante: au Canada, Kim Thuy n’est pas perçue comme étant Québécoise!!
Neil Smith et Lori Saint-Martin sont également écrivains. Smith a profité de la scène pour lire des extraits de son long roman Boo. À eux, j’ai posé la question : Un traducteur/écrivain ou un écrivain/traducteur a-t-il, quand il se met à écrire, la capacité de le faire dans l’une ou l’autre des langues ? Soit que ma question ait été mal comprise, soit qu’ils ne voulussent pas y répondre, je n’ai pas eu satisfaction. Après la séance, j’ai poursuivi en privé avec M. Smith qui a confirmé, je crois, ce que je pensais, qu’à compétence égale, dans une langue ou l’autre, l’écrivain aura néanmoins un penchant pour l’une sur l’autre. Il n’écrira pas dans les deux. Nancy Huston fait exception!!