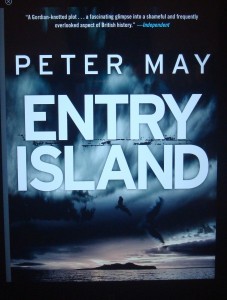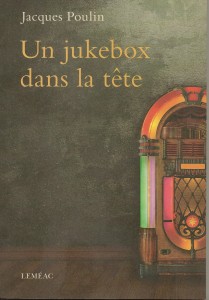Film :
Hôtel La Louisiane n’est pas en Louisiane. Non, il est à Paris, là où la rue de Buci et la rue de Seine se croisent, au cœur de Saint-Germain-des-Près. C’est ici, depuis 75 ans, que règne un esprit de créativité et de liberté devenu légendaire. C’est ici aux années 50 que Jean-Paul Sarte et Simone de Beauvoir se tenaient lorsqu’ils n’écrivaient pas au Café Flore, à côté. Les Américains, Ernest Hemingway and Miles Davis, entre autres, sont passés par là. Davis et Juliette Gréco y furent photographiés ensemble en 1949.
Michel La Veaux, directeur de la photographie d’une quarantaine de films tournés au Québec depuis 1982, dont les plus récents Pour l’amour de Dieu (2012) et Le démantèlement (2013), adore cet hôtel où il descend à chacun de ses séjours parisiens. Son nouveau documentaire est un hommage à ce lieu dont la simplicité et la sobriété se maintiennent de nos jours et à des artistes, littéraires et philosophes qui y sont passés et qui y sont encore.
L’hôtel se laisse difficilement filmer. Les passages sont étroits, les chambres petites, le décor laid, la peinture défraîchie. Les jeunes écrivains et artistes qui y demeurent l’avouent sans ambages, mais reconnaissent d’emblée la nature quasi sacrée des lieux qui incitent à la réflexion et facilitent l’écriture jour et nuit.
J’ai particulièrement apprécié les brides de conversation avec Juliette Gréco et les « flashbacks » d’elle à l’autre époque. Peut-on parler de « vedette » quand il s’agit d’un film documentaire ? Si oui, la véritable « star » est Albert Cossery que je ne connaissais point. D’ailleurs, c’est à lui, décédé en 2008, que La Veaux dédie son film. Cossery, surnommé « le Voltaire du Nil », car né au Caire en 1913, vécut 63 ans à l’Hôtel La Louisiane, sortant chaque jour à 14h30 faire son tour en dandy. Pendant ses six siècles à l’Hôtel, Albert n’a écrit que huit romans, ce qui correspondait parfaitement à sa philosophie personnelle, à savoir que la paresse n’est pas un vice, mais plutôt une forme de contemplation et de méditation.
L’heure passée au Clap à visionner Hôtel La Louisiane, en pleine période de la cohue entourant les fêtes de Noël fut, pour moi, un pur délice. Je m’y sentais un véritable disciple d’Albert Cossery.
Livre :
Quel lien existe entre l’Île d’Entrée, cet ilot peuplé de 800 anglophones faisant partie de l’archipel des Îles-de-la-Madeleine, et le canton de Lingwick en Estrie ? Pour le savoir ou pour l’approfondir, je suggère fortement la lecture du nouveau roman, Entry Island de Peter May, auteur écossais habitant la France.
Sime Mackenzie travaille à la Sureté du Québec, rue Parthenais, Montréal. Faisant partie de la Division des enquêtes sur les crimes contre la personne, il est affecté, en raison de sa langue maternelle, à l’investigation d’un meurtre ayant été perpétré à Entry Island. En fait, Sime est de cette génération de jeunes Anglo-Québécois ayant maîtrisé sa langue seconde au point de bien se placer dans la fonction publique québécoise. Il vient de Bury, près de Scotstown et de Gould, dans le Canton de Lingwick, mais se considère néanmoins Québécois pure laine. Jeune, aux genoux de sa grand-mère, il écoutait les histoires de ses ancêtres chassés de leurs terres en Écosse à l’époque des fameux « clearings », ce processus brutal ayant conduit des milliers de paysans à quitter la patrie pour essayer de se tailler une place sur les marges de l’Amérique du Nord. Ces histoires, la grand-mère les avait pigées dans un journal intime comptant plusieurs chapitres, écrit par l’ancêtre et préservé de génération en génération.
À cause de son divorce d’avec Marie-Ange, agente elle aussi à la Sûreté, qui l’avait trompé à la faveur de son patron, Sime souffre de l’insomnie. Il est hanté par des rêves, sinon des cauchemars, concernant l’histoire de sa famille, mais il ne réussit jamais à ramasser tous les morceaux. C’est parcellaire son affaire ! Une fois rendu aux Îles-de-la-Madeleine, en interrogeant Kirsty Cowell, celle qui est soupçonnée d’avoir tué son mari mal aimé, la chose se complique. Sime est convaincu d’avoir déjà vu cette dame quelque part, sauf qu’elle n’a jamais quitté, à toute fin utile, l’Ile d’Entrée. Le hasard veut que pendant les interrogatoires les deux, le policier et le suspect, découvrent qu’ils possèdent des bijoux arborant des symboles identiques. Lui une bague, elle un pendentif qui font évidemment partie du même ensemble. Comment résoudre les deux mystères, celui du meurtre et celui de la familiarité et de la similarité ?
Ce n’est qu’après avoir été mis en disponibilité par son supérieur à la suite d’une altercation au sujet de Marie-Ange et après être retourné en Estrie, auprès de sa seule sœur avec laquelle il avait entretenu peu de contact depuis des années et en plongeant dans les récits de son ancêtre que possède la soeur qu’il arrivera à résoudre les deux mystères, à mettre Marie-Ange derrière lui, à développer une relation affective avec Kirsty…et à dormir enfin.
Entry Island est une histoire remarquable. Son genre est certes celui de crime-fiction, mais bien plus encore, car grâce aux « flashbacks » il lève le voile sur les abominations du capitalisme britannique telles que pratiquées à l’endroit des paysans écossais. Le lecteur ou la lectrice est plongé dans l’histoire tragique de ce pays. Le roman est d’autant plus poignant pour nous au Québec par le clin d’œil qu’il fait sur les questions identitaire et linguistique. Non seulement sur les rapports entre l’anglais et le français, mais aussi par rapport au gaélique, car à leur arrivée ici, comme les Irlandais, les Écossais parlaient cette langue.