
En juin 1928, la romancière américaine bien connue, Willa Cather (1873-1947), est arrivée à Québec avec sa compagne, Édith Lewis. De leur domicile à New York, elles se rendaient à leur chalet à l’île de Grand Manan, au Nouveau-Brunswick. Malade, Mme Lewis a dû être hospitalisée plusieurs jours à Québec. Cette halte permit à Willa, francophile depuis toujours, de découvrir cette ville perchée sur un rocher, le Cap Diamant, et de s’imaginer la vie d’autrefois. Trois ans, plus tard, parut aux États-Unis Shadows on the Rock, inspiré de ce séjour et de
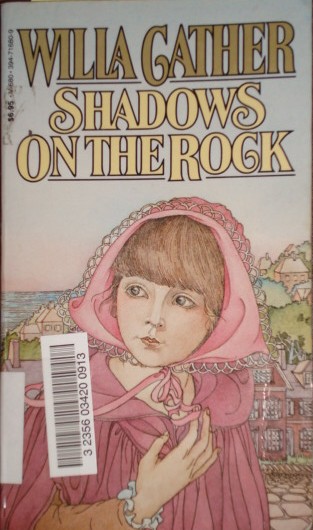
ses recherches subséquentes. En 1932, celui-ci y devint le livre le plus vendu. Traduit des années plus tard en France sous le titre Des ombres sur le rocher, Shadows demeure néanmoins très peu connu au Québec, pourtant, il raconte peut-être mieux que toute autre œuvre de fiction la vie en Nouvelle-France, à Québec, au tournant du dix-huitième siècle. D’ailleurs, l’histoire commence par le départ des derniers bateaux pour la France à l’automne de1697 et se termine en 1713, l’année du Traité d’Utrecht qui redéfinissait les frontières franco-britanniques en Amérique du Nord.
Pour palier à ce manque de connaissance et pour contribuer à sa façon aux célébrations du 400e à Québec, la Quebec Literary and Historical Society dont la magnifique bibliothèque se trouve au Collège Morrin, situé sur la Chaussée des Écossais, au cœur du Vieux-Québec, a organisé le samedi 27 septembre une colloque
consacré à ce livre remarquable qui, par sa préoccupation des rythmes de la vie et de la pérennité de la culture canadienne [française], fait penser, à bien des égards, à cet autre classique « québécois » écrit par un étranger, Louis Hémon, Maria Chapelaine.
Quatre « cathériens » (experts sur l’œuvre de Willa Cather) nous entretenaient de la femme et de son œuvre. John Murphy de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, (extrême droite dans la photo) faisait ressortir la dimension continentale de l’ensemble de l’œuvre de Cather, son souci des « petites cultures » et son désir de faire contre poids à la culture anglo dominante. Selon Murphy, Shadows « celebrates the blossoming of French colonisation and the curious endurance of a narrow culture ». Après avoir publié plusieurs romans sur les cultures immigrantes, scandinaves surtout, situées aux limites de la frontière agricole américaine, au Nebraska et au Kansas ( My Antonia), et sur las Hispaniques du Sud-Ouest ( Death Comes to the Archbishop), elle complète le portrait en rappelant la présence française sur les rives du Saint-Laurent.
Lors de sa conférence, Robert Thacker de Canton, au New York, (extrême gauche), tenta de trouver dans l’œuvre de Cather les racines de la culture québécoise contemporaine. Certains dans l’assistance lui ont fait remarquer que Cather serait probablement surprise de constater aujourd’hui ce Québec séculaire, matérialiste et avant-gardiste. Ce à quoi Thacker a répondu qu’elle en serait probablement fort aise.
Ann Romines (seule femme), a tracé la biographie de cette jeune fille, née en Virginie huit ans après la fin de la guerre de sécession qui, jeune, s’est déplacée à Red Cloud, au Nebraska, où elle a passé sa jeunesse avant de s’inscrire à l’université du Nebraska. Pour gagner sa vie, Cather est retournée dans l’Est, à Pittsburgh, d’abord, puis à New York où elle a élu domicile pendant 40 ans. Romines a révélé l’influence sur Cather et son œuvre de chacun de ces lieux, ainsi que la nature de sa relation avec son éditrice et amie, Édith Lewis.
Enfin, Guy Reynolds, directeur du Projet Cather à l’université du Nebraska chanta les louanges de celle qu’il considère comme la plus importante « écrivaine ethnographique » de son époque. Par le contenu de son œuvre, elle dépasse les bornes du simple régionaliste, faisant preuve d’un engagement vif envers le continent. Par la portée géographique de son œuvre, Cather crée des liens innovateurs entre plusieurs régions du continent. Dans les années qui suivirent la première Guerre mondiale, l’auteure déplorait les tentatives officielles d’éradiquer la diversité linguistique dans son pays et pleurait les « apparently vanished Americas ». Selon Reynolds, Cather était un parangon de cosmopolitisme.
Avant et après chaque intervention savante, l’auditoire eut droit à la lecture en anglais et en français par de jeunes bénévoles de la Société littéraire et historique de Québec d’extraits du livre à l’étude.
Notons enfin que cette société fondée en 1824 fut la première société savante au Canada. Son histoire témoigne du développement de la vie intellectuelle du pays. Elle est maintenant le principal promoteur d’un projet de centre culture, le Morrin Centre, qui offre au public une grande variété d’activités : service de bibliothèque et d’archives, visites guidées, conférences sur l’histoire et la littérature, groupes de discussion, ateliers d’écriture et cours de poésie…
Author Archives: Dean Louder
Park City Remembrances…(for English, see below)

Un récit en anglais? Une aberration sur ce blogue! Mais qui peut me reprocher de « publier » un texte dans ma langue maternelle, d’autant plus qu’il s’agit d’une vérification de l’hypothèse émise précédemment (Wallace Stegner et l’Ouest américain) et reprise ici :
Peu importe où nous voyageons, peu importe le nombre et la distance des déplacements, peu importe les tentatives d’enracinement ailleurs et peu importe notre longévité, les lieux dont nous nous souvenons le mieux sont ceux de notre enfance.
En 1952, à l’âge de neuf ans, j’ai quitté Park City, Utah, une petite ville minière de 3 500 habitants, située au cœur des montagnes Wasatch, à 7 000 pieds d’altitude et à 35 milles de Salt Lake City. Elle était en faillite. Les mines fermaient les unes après les autres. La population chutait. Son destin semblait être celui de tant d’autres petites localités du genre dans l’Ouest : devenir ville fantôme. Une douzaine d’années plus tard, la crise s’était résorbée, le vent avait changé. La ville a découvert une nouvelle vocation, le ski. Les centres de ski foisonnèrent : Treasure Mountain, Deer Valley, Canyons, Westgate… Aujourd’hui, Park City est connue mondialement. Site de compétitions internationales, y compris certains concours des jeux Olympiques d’hiver de 2002, havre de paix pour les riches et célèbres qui y élisent domicile secondaire ou tertiaire, terrain de jeu pour les gens en quête d’émotions fortes et lieu de prédilection pour l’après-ski.
La Park City racontée ici est celle de mon enfance, celle dont je me souvenais encore si limpidement à la fin de l’année 1987. C’était en cherchant un cadeau de Noël pour mes parents que j’ai eu l’idée de leur offrir ces 20 historiettes. Le cadeau a connu un franc succès. Jamais, je ne leur avais offert quelque chose d’aussi personnel. Jamais, un cadeau ne leur avait fait autant plaisir!
Évidemment, le document a connu une diffusion restreinte. C’est pour cela que je le reprends 20 ans plus tard en espérant qu’en le lisant ici, d’autres anciens de Park City s’y retrouveront et des résidents actuels pourront plus facilement se remémorer et commémorer ce milieu de mon enfance. Je dédie ce qui suit à ma sœur, Larna, et sa famille. Je souhaite également que d’autres de ma parenté—oncles, tantes, cousins—ainsi que mes quelques petits enfants qui n’ont pas le bonheur de connaître le français puissent enfin me lire sur internet et ressentir l’affection qui est encore dans mon coeur à l’endroit de mon lieu de naissance.
Photo de tous les bébés nés en 1943 devant le Park City Miners’ Hospital. Deuxième rangée, au milieu de la photo, gros bonnet sur la tête, regardant vers l’arrière, Dean, dans les bras de sa mère, Bernice.
Download file Foreword
Download file « A few »
Download file Boots
Download file Bottling Works
Download file Cold Drinks
Download file Dean Hansen
Download file Easter Rock & Rocky Point
Download file Egyptian Theater
Download file Gossip
Download file Haircuts
Download file Hoops
Download file Jims
Download file Keeping Warm
Download file Lent
Download file Life of Riley
Download file McCuskers
Download file Monkey Bite
Download file Names
Download file Radio
Download file Tulips
Download file Woodside
Wallace Stegner et l’Ouest américain
Tout de suite en entrant au City Lights Books, j’ai vu un nom et un visage qui m’étaient autrefois familiers, ceux de Wallace Stegner. Oui, à l’époque où j’habitais l’Utah et, par la suite, l’État de Washington, les écrits de
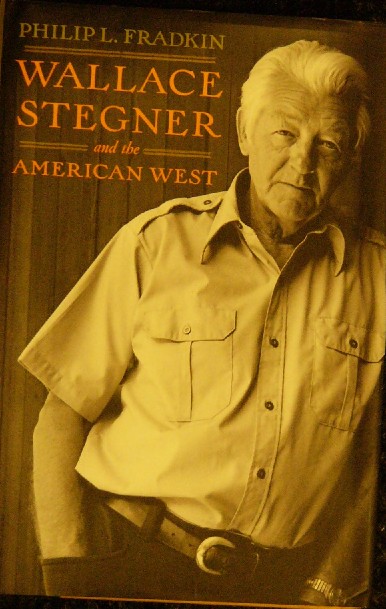
Stegner faisaient partie de mon quotidien. Il était le premier, au vingtième siècle, à chroniquer le vécu de cette région la plus neuve des États-Unis (l’Ouest). Son roman Angle of Repose (1971) a gagné un prix Pulitzer. The Spectator Bird (1976) a suscité un intérêt national et international envers la vie et les paysages de l’Ouest. Mormon Country (1942) analyse de manière objective, du point de vue de l’ « outsider », l’extraordinaire paysage ciselé sur une période de cent ans par ces réfugiés religieux de l’Est. Wolf Willow : A History, a Story, and a Memory of the Last Plain Frontier (1962) raconte la vie au sud-ouest d’une province nouvellement créée, la Saskatchewan, car Stegner, né en 1909 au Dakota du nord, y passe un grand pan de son enfance avant de suivre son père nomade en 1920 à Great Falls, au Montana, puis à Salt Lake City peu de temps après. Ce ne sont là que quatre des plus de quarante ouvrages de fiction et de non fiction témoignant du statut de Stegner comme l’un des plus grands défenseurs de l’environnement de son époque.
Évidemment, je ne pouvais ne pas acheter cette biographie que j’ai lue rapidement, savourant chaque paragraphe, découvrant l’homme derrière le rideau, emphatisant avec le professeur d’université (Stanford) pris dans les engrenages d’une grosse université de recherche et dans les querelles intestines de son département et partageant sa rage devant le viol des paysages de l’Ouest, viol que je qualifie de « californication ».
Deux semaines après avoir terminé ma lecture de Wallace Stegner and the American West, je traversais de nouveau la « dernière frontière de plaine » dont il est question dans Wolf Willow. À l’extrémité est
des Montagnes aux cyprès, ces petites collines qui se démarquent clairement de la plaine, se trouve le village de Eastend (population 560) où Stegner a vécu jusqu’à l’âge de 11 ans. Il n’est retourné à Eastend qu’une fois dans sa vie, en juin 1953 pour recueillir des informations en vue de la rédaction et de la publication de Wolf Willow. Selon Fradkin, son biographe, il se comportait « comme un espion revisitant son passé ». Quatre ans plus tard, alors que la recherche sur ce livre tirait à sa fin, Stegner écrivait à un ami que tous ceux qu’ils avaient rencontrés au cours de la préparation de son livre étaient : « …full of homesickness for the place. And this is a strange thing, isn’t it? I remember it [Eastend] better than any place I ever lived ».
Sans nécessairement le vouloir, cet homme de l’Ouest, mort en 1993, dont les cendres ont été répandus loin de son Ouest bien-aimé, près de sa résidence d’été au Vermont (quel paradoxe!) évoque une vérité : peu importe où nous voyageons, peu importe le nombre et la distance des déplacements, peu importe les tentatives d’enracinement ailleurs et peu importe notre longévité, les lieux dont nous nous souvenons le plus sont ceux de notre enfance.
La librairie City Lights et l’Allée Jack-Kerouac
Le 4 septembre dernier paraissait dans les pages du Devoir un article signé Gabriel Anctil (fils de l’un de mes étudiants à Laval en 1971 et aujourd’hui professeur d’histoire et d’études canadiennes à l’université d’Ottawa) et intitulé « Sur le chemin ». Anctil y décrit un roman, rédigé en français par Jack Kerouac en 1952. Inédit et insoupçonné, selon l’auteur, le manuscrit dormait depuis plus d’un demi-siècle dans la noirceur des archives à New York. Sa découverte aujourd’hui jette une lumière tout à fait nouvelle sur l’oeuvre de ce fils de Canadiens français, considéré comme l’un des écrivains les plus importants du XXe siècle.
Cet article m’a rappelé un séjour à San Francisco au début du mois d’avril 2008 lorsque j’ai eu l’occasion de faire connaître notre nouvel ouvrage, Franco-Amérique, aux étudiants et professeurs en études canadiennes à l’Université de la Californie à Berkeley et aux membres de l’Alliance française de San Francisco. Kerouac est l’une des figures emblématiques les plus importantes de la Franco-Amérique et nous faisons souvent allusion à lui dans le livre. Par exemple, à la page 13, Jack nous dit :
I cannot write my native language and I have no native home anymore, and am amazed by the horrible homelessness that all French-Canadians in America have.
Cette préoccupation chez Kerouac de l’errance se reflète dans le titre du manuscrit récemment déterré, Sur le chemin ainsi que dans son roman le plus connu, On the Road, qui n’est pas, malgré le titre, une traduction de l’autre. Aux années 50, son sentiment de déracinement l’a conduit d’un bout à l’autre du continent, jusqu’en Californie, à San Francisco, où il ne pouvait aller plus loin. Ici, il a connu M. Lawrence Ferlinghetti qui fonda en 1955 la librairie City Lights qui devint un lieu de rencontre de Kerouac et d’autres de la « génération des beats ».
Aujourd’hui, en plus d’offrir un vaste éventail de livres de toutes sortes, la City Lights, toujours dirigé par Ferlinghetti et encore située aux limites de North Beach, quartier italien, et de Chinatown, continue à être un phare pour la contre-culture et pour ceux et celles qui s’opposent au Pouvoir et aux idées reçues.
Faisant l’angle avec l’avenue Columbus et rejoignant l’avenue Grant, l’allée Jack Kerouac, pavée en pierres dans
lesquelles sont encastrées une douzaine de « plaquettes poétiques » dont l’une du fondateur de City Lights sur laquelle sont gravés les mots suivants : » La poésie est l’ombre projetée par nos imaginations illuminées »
Un échantillon des autres inscriptions qui s’y trouvent :
The free exploring mind of the individual human is the most valuable thing in the world (John Steinbeck)
Love lights more fires than hate extinguishes (Ella Wheeler Wilcox).
Without courage we cannot practice any other virtue with consistency (Maya Angelou).
In the company of best friends, there is never enough wine (en caractères chinois).
Brotherhood in all corners of the world (en caractères chinois).
Et, pour terminer sur une note écologique et sur un sujet près du cœur des Québécois, l’eau: une autre « plaquette poétique », elle aussi en caractères chinois :
Quand tu bois de l’eau, pense à sa source.
À la recherche de Victor Charigot, beau-père de Pierre Auguste Renoir
Il existe encore des gens qui se servent des postes pour envoyer des lettres d’amitié, d’amour et de reconnaissance et qui les écrivent à l’aide d’instruments périmés. J’en ai eu la preuve récemment en recevant deux courtes lettres tapées à la machine sur une vieille Smith-Corona ou une vétuste Underwood, je ne le sais. Ces lettres me sont parvenues de Monsieur Alain Renoir, 87 ans, d’Esparto, en Californie, petit-fils du grand peintre français Pierre Auguste Renoir, fils du cinéaste bien connu, Jean Renoir, et arrière petit-fils de Victor Charigot!
Victor Charigot? Qui était-il et pourquoi son arrière-petit-fils m’écrit-il à son sujet? L’histoire mérite une grande diffusion. Je commence par citer l’avant-propos d’un petit bouquin intitulé Victor Charigot, son grand-père de Pierre Chartrand et Bernard Pharisien :
Père d’Aline Charigot (épouse de l’illustre peintre impressionniste Pierre Auguste Renoir) Claude (dit Victor) Charigot finit ses jours en 1898 à Bathgate, un minuscule village au Dakota du nord. Champenois d’origine, il transite par le Canada avant de s’installer aux États-Unis. On dit volontiers des marins qu’ils ont une femme dans chaque port. Victor a une épouse légitime dans chacun des pays où il séjourne. Trois prêtres bénissent ses unions successives : la première en France, la seconde au Manitoba, la troisième dans le Dakota du nord. La situation ne semble pas originale à une remarque près : les seconde et troisième cérémonies sont célébrées alors qu’il est encore uni à sa première épouse « devant Dieu, par les liens sacrés du mariage ».
Au début de l’occupation de la France par l’Allemagne nazie, le cinéaste Jean Renoir, petit-fils de Victor, émigre aux États-Unis. En 1943, il y fait la connaissance de Victoria Charigot-Quesnel, demi-sœur de sa mère qui lui révèle la fin de l’existence de son grand-père. En publiant, vingt ans plus tard, un livre de souvenirs intitulé Pierre Auguste Renoir, mon père, Jean lève le voile sur une partie de la vie de ce grand-père pour lequel il éprouve une sympathie non dissimulée. Doué d’une imagination fertile, Jean mêle la réalité à la fiction et livre en abrégé, une version romancée des tribulations de son ancêtre.
En 1998, Bernard Pharisien, arrière-petit-neveu de la mère d’Aline Charigot, publie une histoire de Victor qui se rapproche davantage de la réalité. Cependant, il ne peut alors accéder à toutes les sources. C’est loin l’Amérique! Six ans plus tard, il croise Pierre Chartrand sur l’une des routes de l’information. Internet leur permet de communiquer, d’échanger des documents et des idées. C’est ainsi que reprennent les recherches. Aujourd’hui, ces deux passionnés vivant de chaque côté de l’Atlantique (Pharisien à Paris, Chartrand à Hemmingford, au Québec) et qui ne se sont jamais rencontrés livrent cet itinéraire aussi original que mouvementé d’un Champenois, natif de la même région que Paul Chomedey de Maisonneuve et Marguerite Bourgeoys : Victor Charigot, un obscur pionnier… Mais dont le gendre (Pierre Auguste) et le petit-fils (Jean) jouissent d’une notoriété internationale qui ajoute sans doute une légère pointe de piment au récit.
Au cours de ses recherches sur Charigot, l’internaute québécois, Pierre Chartrand, a pris connaissance des travaux du professeur Virgil Benoît de l’Université du Dakota du nord sur les Canadiens français de sa région et de mon propre intérêt, à moi, envers la Franco-Amérique et de mon amitié avec Virgil. Chartrand prend donc contact avec moi et nous nous faisons inviter, par la suite, tous deux, à participer au deuxième rassemblement annuel d’IfMidwest (Initiatives en français dans le Midwest) qui aura lieu à Belcourt, au Dakota du nord, du 1er au 3 mai 2008. Malheureusement, Pierre n’a pu accepter l’invitation, tandis que j’ai réussi à intégrer ce rassemblement à l’une de mes nombreuses traversées du Canada. Je lui ai promis de rapporter des photos.
Le passage de la Grande fourche (Grand Forks), site de l’université, à Belcourt nous a conduits par plusieurs villages dont Oakwood où les pierres tombales témoignent de la présence canadienne-française et de la vivacité de
la langue française autrefois. Entre Oakwood et Grafton, notre hôte nous a raconté l’histoire rocambolesque de
Victor Charigot et nous a priés de sortir de l’autobus, par temps très venteux, afin de rendre hommage à cette figure insolite de la Franco-Amérique dont le parcours inusité suscite tant de questions.
En lisant l’article de Virgil Benoît publié dans Franco-Amérique (Éditions du Septentrion, 2008), « De Minomin à Wild Rice en passant par la Folle Avoine : une histoire du Midwest », le lecteur prend connaissance du Père Jean-Baptiste Genin (1839-1900), prêtre missionnaire qui a consacré sa vie aux Métis et Canadiens de cette région, tout en souffrant du dédain de ses supérieurs. Or, aujourd’hui, grâce à Monsieur Bob Vaudrin, le père Genin revit. Dans le cadre des activités de reconstitution historique organisées par IfMidwest, Vaudrin le réhabilite.
Charigot et Genin avaient le même âge, parlaient la même langue, habitaient le même territoire, voire le même village, Bathgate, à la fin de leur vie. Se connaissaient-ils? Sûrement. L’un y était commerçant, l’autre curé. Est-il possible que ce soit Genin qui ait présidé aux obsèques de Charigot, qu’il y ait chanté la messe? On ne saura probablement jamais, mais l’hypothèse semble plausible.
Au retour du Dakota, j’ai transmis, tel que promis, des photos à MM. Pharisien et Chartrand qui les ont sûrement acheminées rapidement à l’arrière-petit-fils de Victor Charigot, Alain Renoir d’Esparto, en Californie, qui, très ému devant sa Smith-Corona (ou Underwood) ne pouvait assez me remercier de ces doux souvenirs d’un être à la fois mystérieux et familial !
