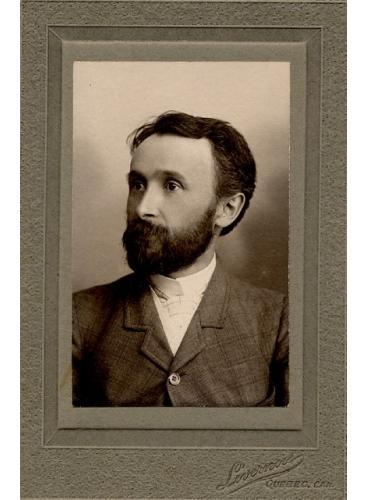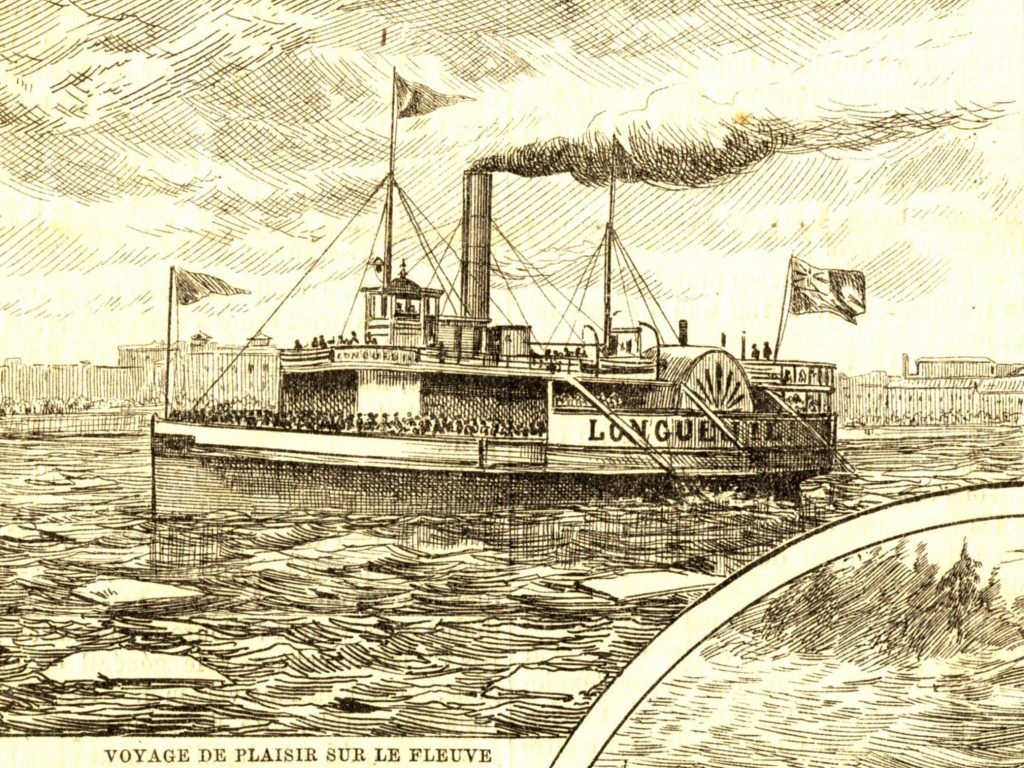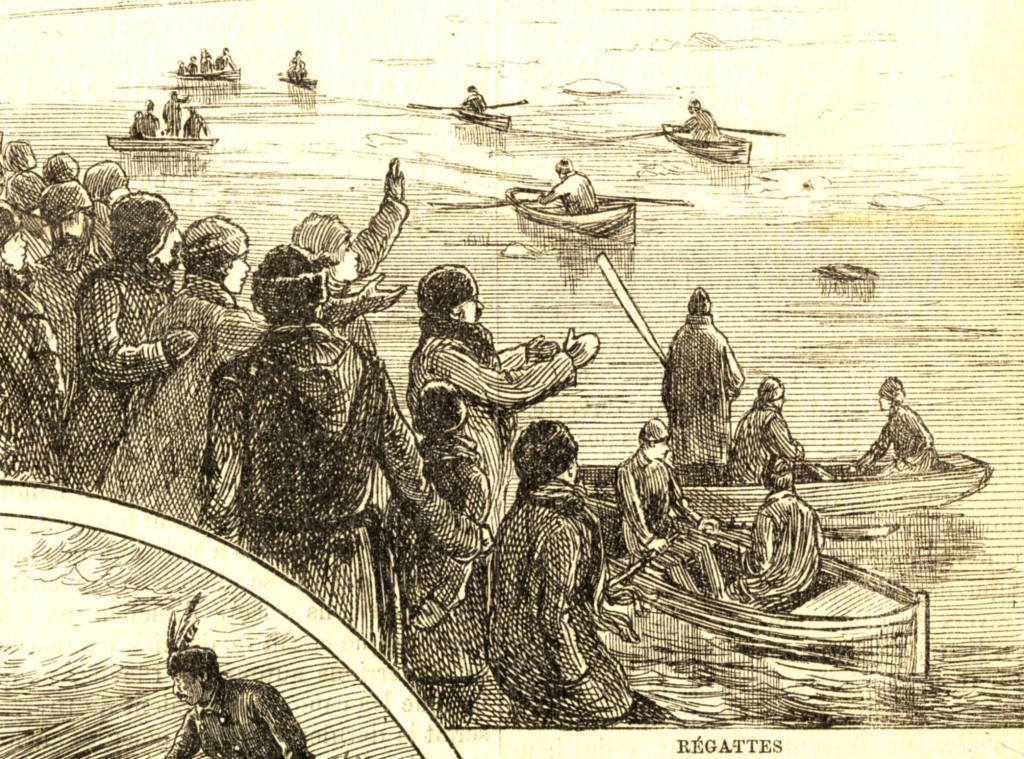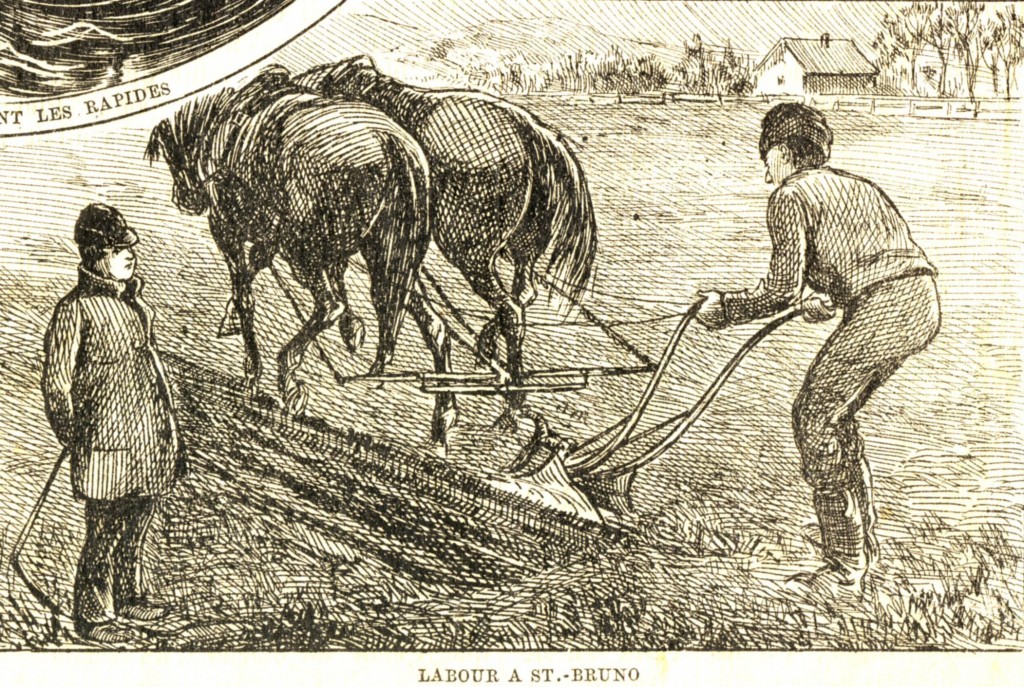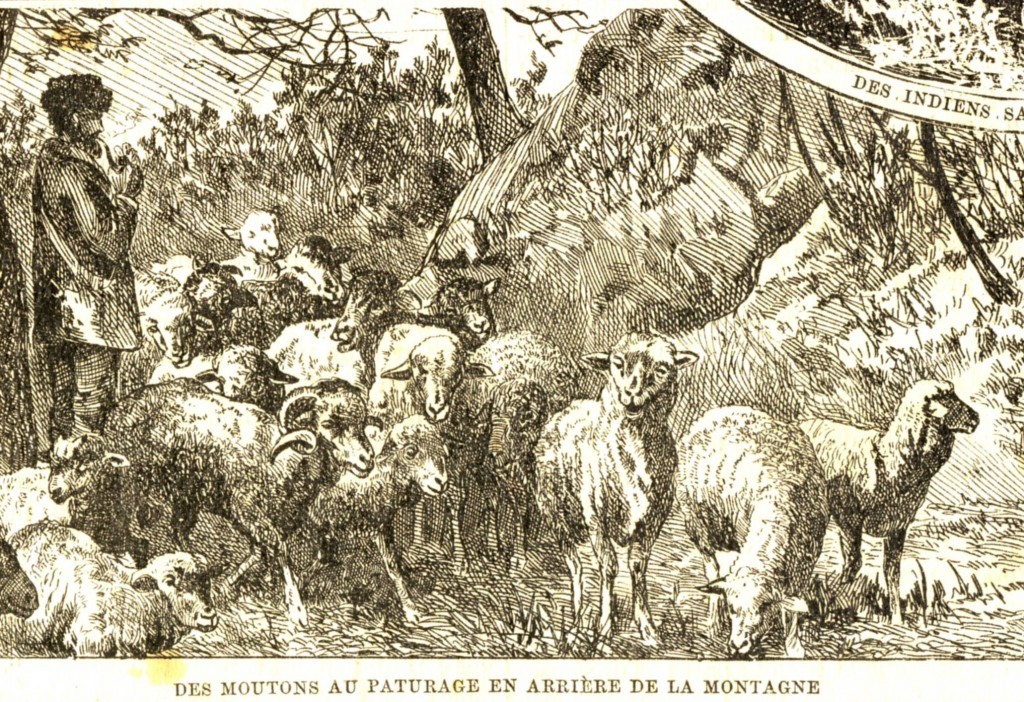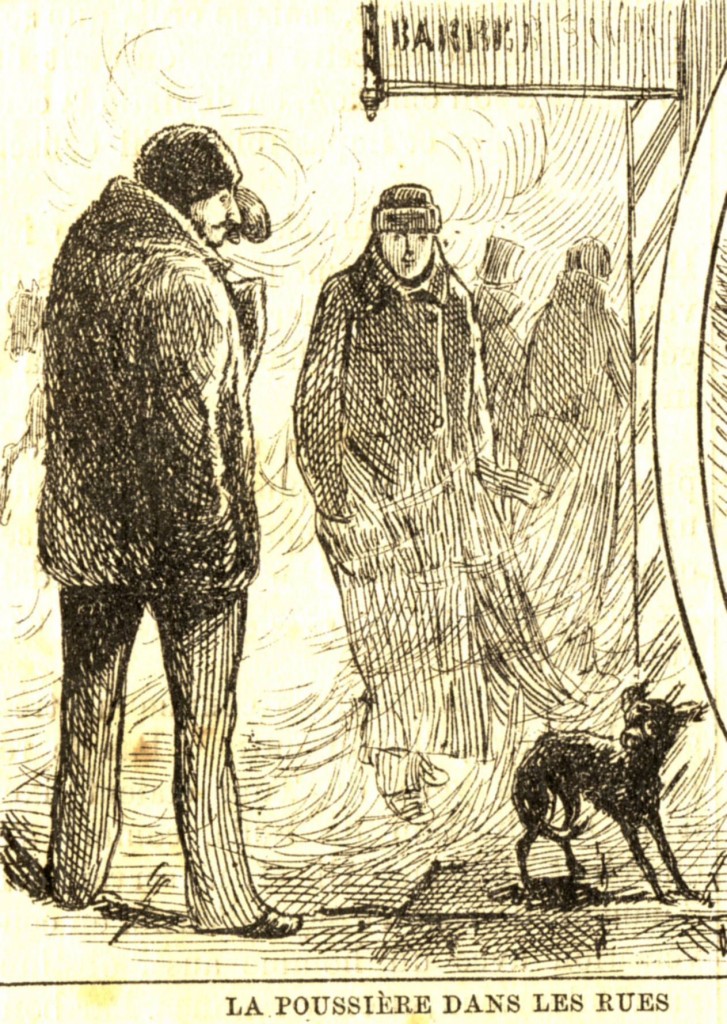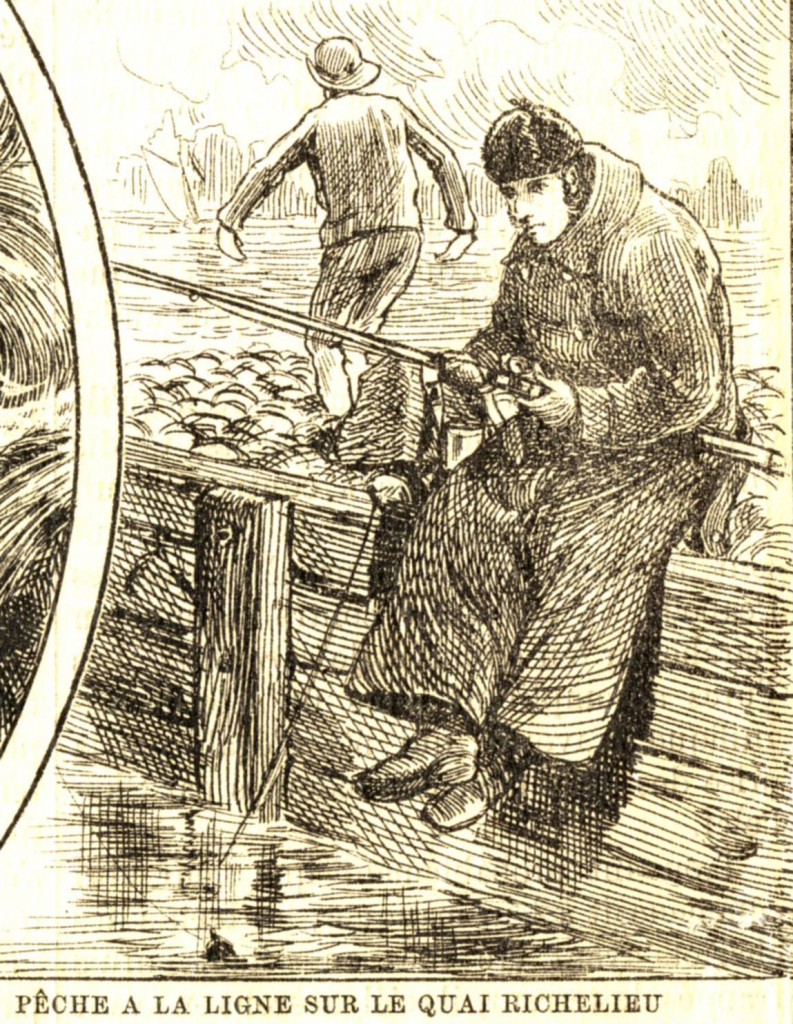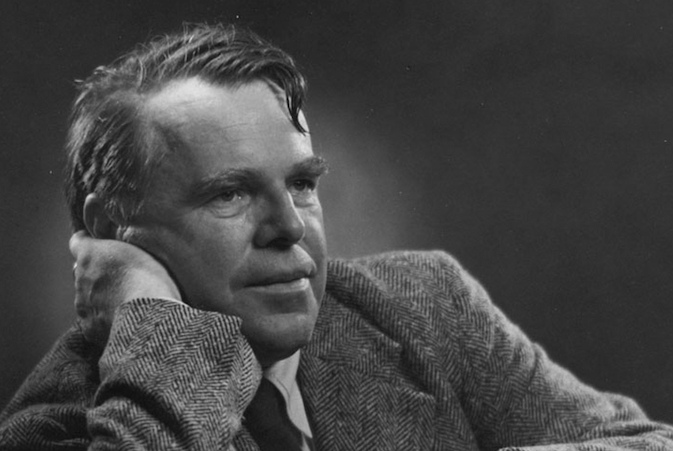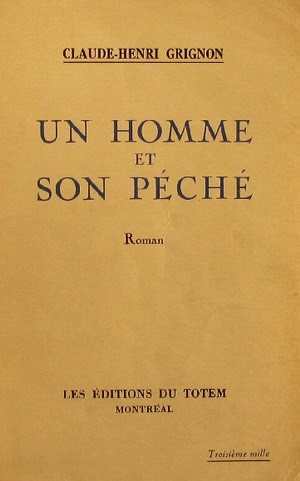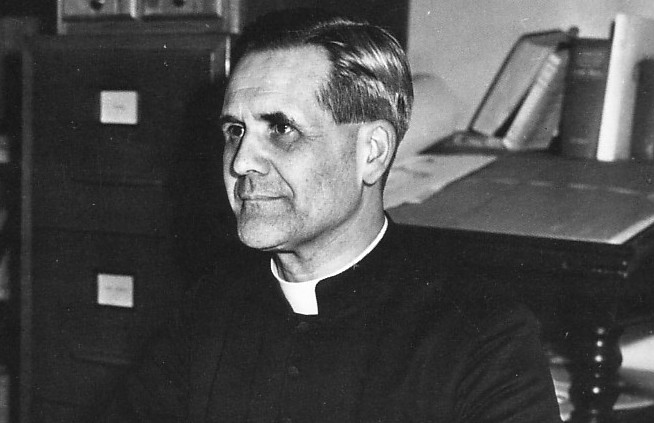Le 12 novembre dernier, dans le point de presse qui a suivi la présentation des projets de loi no 78 (encadrant l’octroi des allocations de transition) et no 79 (donnant suite au rapport du comité indépendant L’Heureux-Dubé), le leader du gouvernement a déclaré que
« l’ensemble des propositions du rapport L’Heureux-Dubé nous amène donc à une rémunération globale des députés à la baisse et des économies pour l’État de 400 000 $ par année » (http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/ConferencePointPresse-26011.html).
Les points de presse ne permettent pas toujours de vider le sujet (celui-ci encore moins que les autres…), mais il aurait été intéressant de demander au ministre comment concilier son évaluation avec ce passage de la page 92 du rapport qu’il invoque :
« Pour les députés, l’application des recommandations entraîne une augmentation de la rémunération globale de 2,3 millions$, soit une hausse de 11,3%.
En ce qui concerne le gouvernement, ce montant de 2,3 millions$ sera compensé par des recettes fiscales additionnelles réalisées par l’impôt sur le revenu du Québec. Cette somme est estimée à environ 1,5 million$ annuellement. En conséquence, l’effet net des recommandations du Comité pour le gouvernement serait donc plutôt de l’ordre de 4%, soit environ 800 000$ » (http://www.assnat.qc.ca/fr/publications/fiche-depute-remuneration-juste.html).
Une rémunération globale diminuée de 400 000$ ou haussée de 800 000$ ? C’est la question à 1,2M$ !
L’évaluation du Rapport L’Heureux-Dubé : une hausse
La section 4.12 du rapport L’Heureux-Dubé est consacrée aux « impacts financiers des recommandations ». Le tableau 12 (page 92) compare la rémunération directe et le coût du régime de retraite assumé annuellement par le gouvernement avant et après l’application de ses recommandations. En bref :
Situation actuelle
- Indemnités 13,9M$
- Allocations de dépenses non imposables 2,0M$
- Sous total 15,9M$
- Coût du régime de retraite pour le gouvernement 4,6M$
Total 20,5$M
Situation projetée
- Indemnités proposées (avec allocation intégrée) 20,3$
- Coût du régime de retraite pour le gouvernement 2,5$
Total 22,8$M
D’où l’augmentation de 2,3 millions $. Le rapport réduit ensuite ce montant à 800 000 $ par le calcul suivant :
« Si les recommandations du Comité étaient appliquées, l’Assemblée nationale ne verserait plus d’allocation annuelle de dépenses non imposable, mais accorderait 6,4 millions $ de plus en indemnités imposables (équivalent imposable de l’allocation de dépenses + augmentation de l’indemnité de base et des indemnités additionnelles). En faisant l’hypothèse que le taux d’imposition sur le revenu du Québec est de 25,75%, soit le taux applicable à la tranche la plus élevée des revenus, l’impôt total additionnel perçu serait de 1,5 million$ ».
Le Comité reste évasif au sujet de l’impact de ses recommandations sur les allocations de transition (qui ont fait l’objet du projet de loi 78). Il y aura, soutient-il, une économie « appréciable » dans le cas des allocations versées aux députés qui quittent avant terme mais « pour les autres cas où un député quitte la vie politique, le relèvement de l’indemnité de base aura pour effet de hausser le montant moyen de l’allocation de transition ».
Il aurait été utile de préciser que ceux qui abandonnent prématurément, et pourraient être privés de d’allocation, sont beaucoup moins nombreux que ceux qui quittent en fin de mandat (retraite ou défaite), mais le Comité se limite à conclure « que le montant total des allocations de transition versées sera inférieur à ce qu’il serait si les indemnités et les règles actuelles étaient maintenues ». Assez pour annuler la hausse de 800 000$ ?
Quant au reste (abolition des allocations de présence aux commissions qui siègent hors session et modification de l’allocation pour les frais de logement à Québec), le Comité conclut que « les économies réalisées seraient de quelques dizaines de milliers de dollars annuellement ».
Du coût nul aux économies
Ce n’est donc pas dans le rapport du Comité consultatif indépendant qu’apparaît la notion de « coût nul » mais bien lors de la conférence de presse tenue le vendredi 29 novembre 2013 pour présenter le rapport aux journalistes. Alors que le Comité était évasif sur l’impact des recommandations portant sur les allocations de transition, la présidente ouvre la conférence avec une présentation générale qui contient de nouvelles données :
« […] le comité croit qu’avec les règles qu’il propose concernant l’allocation de transition et les recommandations à l’égard du régime d’assurance collective, il y aura, pour le gouvernement, des économies additionnelles de près de 900 000 $ par année. Par conséquent, les modifications proposées par le comité représentent un coût nul pour les contribuables québécois ».
Devant un auditoire qui n’avait pas le recul nécessaire pour en juger, les membres du Comité reprennent ensuite ce refrain :
« Mme L’Heureux-Dubé (Claire) : […] Puis c’est tellement facile à accepter parce que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien.
M. Bisson (Claude) : C’est ça, justement, le coût est nul. Le coût est nul pour le Trésor public.
M. Côté (François) : [...] ce que mes deux collègues disent, c’est le plus important, c’est que ça ne coûte rien de plus aux contribuables et c’est un réaménagement. »
Que s’est-il passé entre la signature du rapport le 26 novembre et sa présentation le 29 pour changer l’évaluation du Comité ? Une évaluation comptable tardive ? Des données de dernière minute ? La correction d’un « oubli » ? Quoi qu’il en soit, le « coût nul » a été ressassé par les médias puis remis sur la table par le nouveau premier ministre (en juillet 2014 et en mars 2015) pour finalement se transformer en économie annuelle de 400 000$ lors de la présentation des deux projets de loi dont il a été question ci-dessus.
Selon le tableau du leader du gouvernement, il y aurait donc des économies de 3,34 millions $ par année, soit
- moins d’argent dans le régime de retraite (2 240 000$)
- et dans le régime d’assurances collectives (230 000$),
- moins d’indemnités de départ (830 000$),
- abolition des allocations de présence aux commissions (50 000 $).
D’autre part, des déboursés supplémentaires de 2,94 millions $, soit
- une augmentation de la « rémunération nette » (2 810 000$)
- une augmentation des allocations pour frais de logement (80 000$),
- et le coût d’un comité indépendant permanent qui se penchera à l’avenir sur les conditions de travail des députés (50 000$).
Conclusion : économie nette pour l’État de 400 000$ par année « et donc de 4 millions sur 10 ans » (ce qui est évidemment plus impressionnant…).
L’astuce
Les données du leader sont légèrement différentes de celles du Comité L’Heureux-Dubé. Ce dernier estimait des économies similaires pour le régime de retraite (2,1M$ sur la base de l’indemnité de 2013), mais ne donnait pas de chiffres pour les autres éléments; même chose, côté déboursés, pour les allocations pour frais de logement (que le Comité rangeait dans les économies) et les frais d’un futur « comité indépendant permanent ».
La clef de la démonstration est la « rémunération nette » qui représente la quasi totalité des déboursés supplémentaires. Impossible de trouver ce déboursé de 2,81M$ dans le Rapport L’Heureux-Dubé; tel que mentionné ci-dessus, le comité estimait que son projet exigerait « 6,4 millions$ de plus en indemnités imposables » et qu’il pourrait en revenir 25,75% au Trésor public, soit 1,5M$, ce qui se solderait par un 4,9M$ en indemnités supplémentaires.
À la conférence de presse, les questions ont surtout porté sur le jeu politique (« timing », positions des partis, possibilité de bâillon, etc.). Le journaliste du Devoir a essayé sans succès d’avoir des précisions : à combien se chiffre la perte pour un député, certains auront-ils une hausse ? La « ligne » était invariable : « Certains ont une baisse plus grande que l’autre [sic], mais tout le monde est en baisse. La rémunération globale est à la baisse. »
La représentante du Journal de Québec est alors arrivée avec une question plus pointue :
« Mme Lajoie (Geneviève) : Le 400 000$ d’économies — soyons clairs, là — il comprend également, donc, de l’impôt de plus payé par les députés qui vont avoir un plus haut salaire, moins de primes qui n’étaient pas imposables. On s’entend bien là-dessus?
M. Fournier : Oui, oui.
Mme Lajoie (Geneviève) : O.K. Si on exclut l’impôt de plus, c’est quoi, là?
M. Fournier : Ah! bien là, si on exclut… Bien là, justement, l’objectif, c’était de les imposer parce qu’ils avaient déjà des primes non… il y avait une partie de salaire non imposable, et le rapport nous dit : Il faut l’imposer. Alors, c’est ce qu’on fait.
Mme Lajoie (Geneviève) : Oui, mais, si on enlevait… parce que, quand on calcule, on ne calcule pas souvent ça, là, l’impôt de plus que vont payer les députés.
M. Fournier : Bien, je ne sais pas… Quand on regarde la rémunération globale, on voit : Est-ce qu’il y a plus d’argent dans la poche des députés? La démonstration, c’est : il y en a moins. Mais, pour le reste, je vous laisse chacun faire vos choix, là. Vous souhaitez peut-être qu’on en ait plus, mais ce n’est pas le rapport indépendant qui… ne nous proposait pas cela. Il demandait que la rémunération soit à la baisse ».
Ceux qui ont compris peuvent lever la main… La « piste » indiquée par la journaliste était prometteuse, mais la « meute » s’est ensuite dispersée dans d’autres directions. Il aurait pourtant été utile de demander des précisions sur la « rémunération nette » et surtout comment on pouvait défendre ce concept, disons « novateur » (qu’on ne voit « pas souvent », comme le soulignait la journaliste), dans le cadre des relations de travail et des négociations salariales (même le négociateur des médecins spécialistes n’a pas invoqué les milliers de dollars qui reviennent au Trésor public sous forme d’impôts pour faire passer l’augmentation de salaire de ses collègues). S’il faut tenir compte des recettes fiscales accrues qui accompagnent l’augmentation des indemnités, faut-il aussi calculer les pertes fiscales qui découlent des prestations de retraite diminuées ? Et pourquoi pas les retombées économiques de la présence de députés mieux payés dans la capitale…
Pour les simples contribuables, il reste à espérer que la lumière se fasse d’ici l’étude du projet de loi en commission. Pour le moment, il est difficile de comprendre qu’on veuille donner aux députés des conditions de travail à la hauteur de leurs fonctions et leur accorder le traitement du niveau 4 de la catégorie des dirigeants et des membres d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, tout en prétendant aussi faire des économies. S’ils méritent un changement de catégorie, du député de la base jusqu’au premier ministre, comme le propose le rapport L’Heureux-Dubé, il faut assumer les conséquences sur le Trésor public sans trop abuser de la « comptabilité créatrice ».