Dans une fort intéressante entrevue donnée à Guy Fournier et publiée sous le titre « L’odyssée de Yann Martel » dans les journaux de Québécor le 23 février dernier, l’écrivain explique pourquoi il a choisi de vivre à Saskatoon, une ville « à sa mesure » située néanmoins dans des « espaces illimités ».
Né en Espagne, de parents québécois de souche, éduqué en anglais, Yann Martel se dit maintenant Fransaskois mais « d’abord Canadien français » et se sent « à l’aise partout dans ce pays ». Comme il considère la langue comme un simple « véhicule » et non comme un critère d’identité déterminant, l’auteur de Life of Pi ne s’inquiète pas trop de vivre dans une province où la population de langue française est tombée sous le 1% et où le français est carrément combattu notamment par la Saskatchewan Association of Rural Municipalities qui adopte annuellement une résolution contre la Loi sur les langues officielles du Canada.
« Martel est conscient, écrit Guy Fournier, que certains îlots francophones hors Québec sont en grave danger d’assimilation. Malgré son université, où peut s’exprimer une certaine culture française, il n’y a pas assez de francophones à Saskatoon pour qu’on puisse parier sur leur survie à moyen terme ».
« You bet », comme on dit là-bas ! » Entre 1971 et 2006, le taux d’assimilation des Fransaskois est passé de 50% à 75% !
« Parce que sa compagne d’origine britannique ne parle pas encore français, que les petits compagnons de ses enfants sont anglophones, Yann s’adresse à Lola et Théo presque toujours en anglais. Les deux sont encore très jeunes et papa a bon espoir de trouver d’ici peu le moyen de les mettre à l’apprentissage du français ».
Espérons donc que monsieur Martel aura plus de succès avec ses enfants qu’avec son épouse, mais on peut parier sur le terme de l’odyssée de cette branche de la famille Martel. Ce ne sera pas la première famille de ma région partie vers l’Ouest qui sera assimilée après deux ou trois générations. Les enfants de monsieur Martel seront encore bien plus « à l’aise » que lui.
Tous les articles par Gaston Deschênes
Ringuet, Arcand et le spectre de la disparition
À sa deuxième année d’existence, Septentrion publiait Ringuet en mémoire, 50 ans après Trente arpents, les actes d’un colloque organisé par l’UQTR à l’occasion du cinquantième anniversaire de ce classique de la littérature québécoise. L’ouvrage est naturellement passé « sous le radar », ce qui a eu « l’avantage » de ne pas attirer l’attention sur une bourde originale, une erreur dans le titre même du livre qui est devenu Ringuet en mémoire, 50 ans après Trente après! Le métier d’éditeur n’a-t-il pas pour intérêt marginal de nous apprendre à faire de nouvelles formes d’erreur?
Cette bêtise m’est revenue à la mémoire quand est sorti dernièrement le livre de Denys Arcand, Euchariste Moisan (Leméac) qui constitue en quelque sorte un résumé du Trente Arpents de Ringuet. Moisan est le « héros » du roman, un agriculteur fier et prospère qui, de malchance en faux pas, se retrouve veilleur de nuit dans un entrepôt en Nouvelle-Angleterre, ruiné, déshonoré et menacé d’assimilation comme des milliers d’autres compatriotes exilés. C’est là que le cinéaste le « retrouve » et lui fait raconter sa vie dans un long monologue de 79 pages.
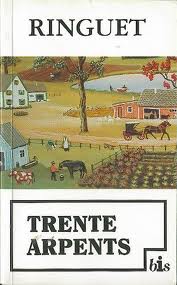
Si les médias ont évidemment ignoré les actes du colloque de 1988, l’opuscule de Denys Arcand a bénéficié d’une large couverture de presse : une page dans Le Soleil, plus d’une dans La Presse, deux dans le Journal de Québec, pour ne parler que des médias écrits. C’est l’effet de « la vedette qui publie ». La Presse a même titré « Pourquoi Ringuet n’est pas ringard ». Le texte de Chantal Guy rappelait que les étudiants de son époque n’avaient retenu qu’une « grosse déprime » de ce roman, et de la littérature québécois en général, alors qu’ils n’avaient aucun problème avec la noirceur des romans russes, américains ou français :
« On ne peut pas lire ce roman, écrivait-elle, sans ressentir de la pitié pour cet homme et un profond désespoir. Voilà sûrement pourquoi on ne le lit pas. Ça fait trop mal. Mais si ça fait mal, c’est bien parce que ça nous parle, parce que c’est une douleur et une peur qu’on ressent encore. En ce sens, dans son esprit même, Trente arpents est toujours d’actualité. Ce qui est encore plus désespérant… » (http://www.lapresse.ca/arts/livres/chroniques/201301/25/01-4615138-pourquoi-ringuet-nest-pas-ringard.php)
Cinéaste, mais historien de formation, Arcand n’avait pas encore lu ce roman qui évoque « la menace constante d’une disparition du peuple canadien-français ». Au-delà des grandes qualités littéraires de l’ouvrage, il a ressenti un choc :
« C’est terrifiant. Mais le destin du Québec a toujours été très étonnant. Normalement, en 1763, si on regardait ça, on se disait que dans une génération, les Canadiens français auraient disparu. Même chose pendant l’exode aux États-Unis. Eh bien non, ils sont encore là, ça continue. Il y a comme une sorte de miracle québécois, mais qui est toujours horriblement menacé. C’est toujours d’actualité et c’est ça qui est absolument affolant. […]. Un peuple conquis, c’est ça, le grand problème. Nous étions faits pour être français. Mais nous ne le sommes pas. Nous n’avons pas pu l’être. Dans une mer anglophone, ça va toujours être là. Peut-être qu’on n’en sortira jamais » (http://www.lapresse.ca/arts/livres/entrevues/201301/25/01-4615129-denys-arcand-le-spectre-de-la-disparition.php).
Le patrimoine de Québec menacé : une « légende urbaine »?
La conseillère municipale du district de la Chute-Montmorency et responsable de la culture et du patrimoine a réagi à une chronique de Jean-Simon Gagné (http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201301/15/01-4611675-ceci-nest-pas-un-texte-sur-le-patrimoine.php) en dressant une liste de sept « sauvetages du patrimoine signés Équipe Labeaume » (Le Soleil, 26 janvier 2013). Cette nomenclature se termine par la phrase classique (« Je pourrais poursuivre cette énumération longtemps ») qui ne cache jamais le fait que le meilleur est derrière.
La liste des « sauvetages » doit être entendue avec les bémols appropriés et une distribution correcte des mérites. Les Nouvelle Casernes apparaissent en tête, mais on se rappellera que leur sauvetage relèvera d’abord du gouvernement du Québec… s’il trouve les crédits que les libéraux avaient oubliés quand ils ont fait leur annonce électorale surprise en juillet dernier. Le mérite du sauvetage de la maison Loyola revient d’abord à la fondation Jules-Dallaire qui a permis d’acquérir le bâtiment historique ainsi qu’aux grandes corporations et au ministère de la Culture qui ont fourni le financement. Le monastère des Augustines était-il en danger? Si son avenir est assuré, c’est essentiellement grâce à la Fiducie du patrimoine culturel mise sur pied par cette communauté. Le temple Wesley, qui deviendra la maison de la littérature? Bon point : la ville a restauré et réaménagé son propre bâtiment. Quant à l’église « éreintée » de Saint-Denys-du-Plateau, dont le caractère patrimonial en fera sourire plusieurs, qu’en restera-t-il de vraiment d’authentique une fois le recyclage terminé?
La liste comprend aussi deux « sauvetages » dans l’arrondissement de la conseillère, soit le Couvent de Beauport (une « perle du patrimoine » achetée par la ville) et le quartier Everell (désormais sous le contrôle de la Commission d’urbanisme), mais peut-on convenir que ces deux dossiers, si importants soient-ils pour les Beauportois, ne sont pas de grands enjeux pour le patrimoine de la capitale?
Les vrais enjeux sont ailleurs, particulièrement là où il y a des conflits avec des promoteurs, ce qui n’a pas été le cas dans la plupart des « sauvetages » évoqués ci-dessus. L’avenir du patrimoine de Québec ne se jouera pas dans les anciennes banlieues mais au cœur de la ville, dans le Vieux-Québec, le secteur de la Grande Allée, le Vieux-Sillery.
Parmi les dossiers déterminants figure celui de l’agrandissement de l’Hôtel-Dieu dont les plans finiront bien un jour par apparaître : jusqu’où la ville acceptera-t-elle de voir aggravé ce qui constituait déjà une erreur dans les années cinquante? Autre dossier d’envergure (et bien plus corsé que la protection des résidences de villégiature du quartier Everell) : le développement de terrains patrimoniaux dans l’arrondissement historique de Sillery. Le maire de Québec « se désengage complètement de la planification du développement des domaines patrimoniaux de Sillery [et] renvoie la balle aux représentants du ministère de la Culture », pouvait-on lire dans Le Soleil le 14 septembre dernier. La ville (en conséquence?) n’était pas représentée, le 22 janvier dernier, à l’annonce de la consultation, une initiative pour laquelle on semble « peu emballé » à Québec, selon Le Devoir.
Ce désintérêt cadre mal avec l’acte de foi qui nous est proposé par madame la conseillère. Sa lettre nous laisse aussi sur notre appétit quand elle évoque « la vingtaine de démolitions qui ont été évitées sur Grande Allée grâce à l’intervention de la Commission d’urbanisme ». Une vingtaine de démolitions demandées par « des promoteurs gourmands »? Sur Grande Allée seulement? Récemment? On voudrait bien en savoir davantage, mais on sait déjà qu’il faut continuer de s’inquiéter : les dangers qui menacent le patrimoine de Québec sont peut-être encore pires qu’on le pense.
Me priver de mes droits d’auteur au nom du droit à l’information?
La mort du jeune gourou de l’informatique, Aaron Swartz, qui devait passer devant la justice pour avoir détourné des milliers de documents académiques du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), est certes une tragédie sur le plan humain, mais avant de le « monter sur les autels », comme disait ma mère, ou de l’inscrire au martyrologue, il faudrait prendre une grande respiration.
« Il ne s’agissait pas de piratage proprement dit, écrit Francine Pelletier (http://www.ledevoir.com/societe/medias/368426/mort-subite-d-un-jeune-revolutionnaire), seulement de détournement de compte, lui permettant ainsi de «voler» la quasi-totalité des documents du serveur ». Bien oui, tout est dans l’utilisation des guillemets… Mettons que je détourne votre compte de banque ? ou votre entrée électrique ?
Personnellement, je n’avais pas confié à monsieur Swartz le mandat de me donner « l’accès à l’information avec un grand A », surtout que ce « Robin des bois des temps modernes » ne reconnait pas cette horrible chose qu’est ma propriété intellectuelle. De son point de vue, le droit d’auteur serait très mal adapté au principe de l’Internet.
Mais n’est-ce pas plutôt l’inverse ?
Réduire les primes de départ ? Une fois parti…
Le ministre responsable des Institutions démocratiques a annoncé qu’il proposera d’abolir les primes de départ pour les députés qui démissionnent en cours de mandat. C’est une belle intention. La CAQ est d’accord sur le principe mais se questionne sur les détails. Faudrait d’abord voir ce qu’il propose, note avec raison le candidat Couillard.
Dire qu’un député démissionnaire ne mérite absolument pas d’allocation de transition est un peu simpliste. Il peut y avoir de bonnes raisons pour quitter avant la fin. La maladie en est une mais encore faut-il déterminer quelle maladie justifie la démission. Des députés se sont montrés « durs pour leur corps », d’autres, moins. Des raisons « familiales » peuvent être invoquées. On verra ce que le législateur mettra sur la table.
Par ailleurs, qualifier la démission d’un député de « bris de contrat avec l’électeur » (comme le fait Gérard Deltell) n’est pas nécessairement la bonne façon d’aborder la question. Dans notre droit, le député est théoriquement parfaitement libre de ses « mouvements » et de ses opinions. Une fois élu, il devient représentant de l’ensemble de la population et s’exprime en fonction de sa conception de l’intérêt commun.
Ce qui me frappe dans la nouvelle qui est sortie ces derniers jours et dans les réactions qu’elle a suscitées, c’est le silence des intervenants parlementaires sur le problème le plus scandaleux des allocations de transition, soit le cumul possible d’une allocation de transition et d’une pension de parlementaire.
Faut-il encore le rappeler ? La « prime de départ » des parlementaires du Québec est une « allocation de transition ». Elle est apparue au début des années 1980 lors d’une réforme importante de la Loi sur les conditions de travail des députés. Pour faire digérer une augmentation substantielle de leurs indemnités, au moment où ils coupaient les salaires des fonctionnaires, les députés ont restreint leur généreux « régime de pension » (ce qui devait laisser la « rémunération globale » inchangée, disait-on…) : les députés admissibles au régime ne pourraient plus toucher leurs prestations avant d’avoir 55 ans ; en échange, pour permettre aux moins de 55 ans « de se virer de bord », le temps de se dénicher un « emploi-difficile-à-trouver-quand-on-a-fait-de-la-politique-et-que-les-portes-se-ferment », les députés sortants, volontaires ou non, bénéficiaient d’une « allocation de transition » représentant au maximum une année de salaire.
En principe, l’allocation compensait l’absence de pension (chez les moins de 55 ans) ; en pratique, la loi a permis le cumul et ça dure depuis 30 ans, probablement parce qu’on en profite dans toutes les nuances de l’arc-en-ciel politique. Une ex-ministre des Finances pourtant zélatrice de la bonne gestion des fonds publics est ainsi partie, quatre mois après son élection, avec une sacoche rentière comprenant le RRQ, la pension fédérale, une retraite de parlementaire et une allocation de transition. « Transition » vers quoi, puisqu’elle déclarait quitter le marché du travail ?
L’interdiction de ce cumul devrait faire partie du « plan » dont le ministre responsable des Institutions démocratiques se fait à juste titre le héraut « afin de rétablir la confiance des citoyens envers la politique ». Et, parti sur cet élan, pourquoi s’arrêter ? Tant qu’à revoir la Loi sur les conditions de travail des parlementaires, pourquoi ne pas faire un ménage dans l’accumulation semi-séculaire de primes et d’indemnités de fonctions ? Le gouvernement actuel n’a heureusement pas abusé avec seulement 12 adjoints parlementaires (peut-être par manque de main-d’œuvre !) mais ne faudrait-il pas en limiter le nombre de ces postes souvent perçus comme sinécures pour éviter qu’il ne remonte à 18-20 ? De plus, a-t-on besoin de 15 personnes payées 13 000 $ pour présider les séances de commission quand les présidents et vice-présidents ne peuvent officier ? Les présidents de séance se sont partagé une trentaine de ces séances « orphelines », en moyenne, ces dernières années : ça ne fait pas beaucoup de séances par président, ni d’heures de travail, au rythme de trois heures en moyenne par séances.
Pour rétablir la confiance, ne faudrait-il pas, de façon plus générale, pratiquer la transparence sur tout ce qui touche les conditions de travail des parlementaires (indemnités, allocations, pensions, etc.), comme c’était le cas autrefois, bien avant la loi dite « d’accès à l’information », ainsi que les décisions du Bureau de l’Assemblée nationale en cette matière? Dans Le Devoir du 3 décembre dernier, l’un des rédacteurs de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Me Jules Brière, exprimait d’intéressantes observations sur ce qu’il est advenu de son « œuvre » (http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/365450/trente-ans-et-deja-vieille) : « La loi, disait-il, semble avoir perdu son sens originel en s’affichant davantage comme un outil de contrôle et d’obstruction […]. Actuellement, elle laisse un peu trop de latitude au gouvernement, ce qui va à l’encontre de ce qui avait été prévu en 1982. Plusieurs aspects doivent être remodelés, et ce, afin de remettre l’intérêt public et la transparence au centre de cette loi ».
Une transparence, ajoutait Le Devoir, « que la commission Charbonneau a certainement confortée dans les derniers mois et qu’invoquent également de plus en plus les tenants d’une nouvelle gouvernance et défenseurs de l’intérêt public qui, comme M. Brière, estiment qu’elle est un des préalables pour redonner confiance aux citoyens dans leurs institutions démocratiques ».