Une nouvelle pièce s’est ajoutée au dossier du Je me souviens en mai dernier lorsqu’un groupe de descendants d’Eugène-Étienne Taché, architecte de l’Hôtel du Parlement et auteur de la devise, a remis au président de l’Assemblée nationale une lettre collective exposant par écrit, pour la première fois à ma connaissance, la thèse selon laquelle la devise Je me souviens est « un abrégé de l’intégral Je me souviens que né sous le lys je croîs sous la rose, ce texte ayant évidemment dû être abrégé pour être inscrit sur la façade du Parlement ». Les signataires soutenaient aussi que Taché aurait « souvent expliqué » son intention à sa famille; cette « mise au point fut à maintes reprises faite par madame Taché, décédée en 1931, à ses trois filles » et ces dernières « ont transmis cette information à leurs propres enfants ».
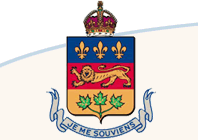
Le premier problème avec cette tradition familiale est qu’aucune autre source ne la corrobore.
Aucune des personnes qui ont écrit sur le sujet à l’époque de Taché n’a évoqué l’existence de cet « intégral ». Pourquoi Taché n’en aurait-il pas informé Thomas Chapais, alors président du Conseil législatif et ministre sans portefeuille, ou Ernest Gagnon, secrétaire des Travaux publics, deux hommes qu’il connaissait très bien et qui s’ingéniaient, en 1895 et 1896, à expliquer le sens de la devise? Il leur aurait évité bien des soucis, ainsi qu’à tous les autres qui en ont cherché la source pendant des décennies. Il y a quelque chose qui heurte l’intelligence dans cette idée que seuls les proches de Taché connaissaient ce prétendu « intégral » et en ont préservé le secret pendant presque un siècle. En effet, de la création du Je me souviens, vers 1883, jusqu’à son apparition sur les plaques d’immatriculation, en 1978, on ne trouve aucune source, texte, dictionnaire ou recueil de citations expliquant l’origine et la signification de la devise par cet « intégral » ni d’ailleurs aucune trace écrite de cet « intégral », entre 1908 et 1978, date où une petite-fille de Taché intervient dans The Montreal Star pour dire que Je me souviens est « just part of it ».
Le second problème est que cette croyance est explicitement contredite par des auteurs très crédibles contemporains de Taché.
Dans Le fort et le château Saint-Louis (Montréal, Beauchemin, 1908), après avoir rappelé que Taché a donné au Québec son Je me souviens, Ernest Gagnon écrit qu’on pourrait peut-être lire bientôt « sur un de ses monuments cette autre devise si poétique et si vraie : Née dans les lis, je grandis dans les roses ». Dans un article publié la même année, Gagnon précisait son information : « On a parlé, il y a quelque temps, d’une œuvre d’art représentant une femme, une adolescente gracieuse et belle, symbole de la Nation Canadienne. Cette allégorie de circonstance, qui est encore inédite, devrait être accompagnée de la devise: Née dans les lis, je grandis dans les roses / Born in the lilies, I grow in the roses. »
Le projet de monument ne s’est pas concrétisé, mais Taché a « recyclé » son idée sur la médaille commémorative qu’il a conçue pour le troisième centenaire de la ville de Québec en 1908. On peut en effet y lire : « Née sous les lis, Dieu aidant, l’œuvre de Champlain a grandi sous les roses ».
La citation la plus convaincante est toutefois celle de David Ross McCord (fondateur du Musée McCord), qui écrivait ceci dans un cahier de notes, vers 1900, sous le titre « French sentiment in Canada » :
[Traduction] « … personne ne peut nier la beauté et la simplicité du Je me souviens d’Eugène Taché. Siméon Lesage et lui ont fait plus que quiconque au Canada pour une architecture de qualité dans la province. D’ailleurs, Taché n’est-il pas aussi l’auteur de l’autre devise, Née dans les lis, je croîs dans les roses, à laquelle nous lèverons tous nos verres. Il n’y a rien là pour favoriser la désunion ».
Ce commentaire établit, sans l’ombre d’un doute, que Je me souviens et Née dans les lis, je croîs (ou grandis) dans les roses étaient deux devises distinctes et ne constituaient pas un « poème » comme plusieurs le prétendent. Mieux encore, les deux devises ont un sens différent et McCord préfère nettement la seconde.
Taché s’est peu exprimé par écrit, mais c’était un homme de goût, instruit et cultivé. Ses deux devises sont bien frappées et il est difficile d’imaginer qu’il soit l’auteur d’une phrase aussi maladroite que « Je me souviens que né sous le lys je croîs sous la rose ». On y trouve notamment une évidente faute de concordance des temps (le verbe croître doit être au passé, je crûs ou j’ai crû) et l’ensemble porte à croire qu’il s’agit d’un collage des deux devises réalisé après la mort de leur auteur (1912).
Par qui et pour quoi? Mystère, mais la note de McCord et l’inconfort qu’elle exprime face à la devise révèlent que cette dernière dérangeait ceux qui la considéraient trop exclusivement francophile; on aurait donc utilisé l’autre devise comme complément, contrepartie ou réplique, ce qui a eu pour effet de donner au Je me souviens un sens très particulier : en effet, la proposition principale du prétendu « intégral » serait « Je me souviens que … je croîs [sic] sous la rose ». Dans ce bricolage, la référence aux origines françaises du Québec (« né sous le lys ») devient une proposition secondaire et la devise ainsi « remaniée » évoque les bienfaits de la Conquête, un détournement de sens qui n’est pas innocent.
Archives pour la catégorie Histoire
Sur la prétendue « excommunication » des patriotes
On retrouve à plusieurs endroits sur Internet l’idée que Chénier, certains patriotes et même les patriotes en général ont été excommuniés par Mgr Lartigue. Sur le site le mieux documenté sur les patriotes, et généralement bien informé, on trouve ce passage d’une notice biographique de Chénier, témoin parmi tant d’autres de la légende largement répandue :
« Le clergé refusa aux familles que leurs morts soient enterrés en terre bénie, en raison de l’excommunication lancée par Mgr Lartigue à l’encontre des rebelles. Cette excommunication a été levée par le synode des évêques québécois en 1987 à l’occasion du cent cinquantenaire de la rébellion et les restes de J.-O. Chénier ont été transférés dans le cimetière catholique de Saint-Eustache. Une statue à Montréal, au carré Viger, et une autre à Saint-Eustache honorent la mémoire d’un homme qui fait figure de héros incontesté » (http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/1837.pl?out=article&pno=biographie97).
Or, comme l’ont précisé les évêques du Québec en 1987 dans un texte intitulé « Cent cinquantième anniversaire de la révolte de 1837 », et publié notamment dans L’Action nationale, (vol. 77, no 2, oct. 1987, p. 148-150, texte qu’on peut retrouver dans les archives de la revue, http://www.action-nationale.qc.ca/index.php?option=com_wrapper&Itemid=186), les patriotes « n’ont été ni excommuniés ni frappés de quelque censure ecclésiastique que ce soit », mais certains d’entre eux ont été néanmoins sanctionnés:
« À des curés qui demandèrent à leur évêque s’ils pouvaient enterrer dans le cimetière bénit les corps de ceux qui étaient morts les armes à la main, la réponse fut négative. On ne déterra cependant pas ceux qui s’y trouvaient déjà, quoique à un endroit leurs lots furent considérés comme profanes, et non plus bénits ».
Aux descendants de ces patriotes qui demandaient « depuis déjà de nombreuses années que l’on permette l’inhumation des restes des victimes avec leurs proches parents décédés depuis longtemps », les autorités de l’Église de 1987 ont voulu « que cette prière puisse être entendue et exaucée ».
C’est ainsi que les restes de Chénier ont pu être inhumés selon le rite de l’église catholique le 26 juillet 1987. La « levée des sanctions religieuses à l’endroit des patriotes morts au combat », comme l’écrit avec justesse une autre page du site précité (http://cgi2.cvm.qc.ca/glaporte/1837.pl?out=article&pno=monument04) était le fruit des démarches conjuguées des Patriotes du Pays et de la Corporation des fêtes du 150e anniversaire des Patriotes de Saint-Eustache. .
« L’Année des Anglais » chez les talibans
(Un soldat du contingent canadien en Afghanistan a reçu L’Année des Anglais en cadeau…)
Bonsoir, M. Deschênes,
Je vous écrit un petit mot rapide du fin fond du fond de l’Afghanistan où votre livre a su trouver son chemin pour me parvenir, avec l’aide de Simon Gilbert, bien sûr! ![]() Merci beaucoup pour la dédicace, ce genre de détail me tient beaucoup à coeur étant un passionné de livres.
Merci beaucoup pour la dédicace, ce genre de détail me tient beaucoup à coeur étant un passionné de livres.
C’est le cas de le dire, votre livre n’a pas fait long feu, je l’ai dévoré en seulement quatre jours, avant d’aller au lit histoire de me changer les idées de mes traditionnels talibans qui font les cents coups contre les Forces de la Coalition. D’une façon très personnelle, vous contribuez donc au support des troupes! Le livre est magnifique, bien fait avec de belles photos… rien pour freiner mon avis de me trouver une jolie petite maison du Régime français!!
Je ne sais pas si Simon vous a parlé un peu de moi?! Nous nous sommes connus dans l’armée, à l’époque où je lui disais de cesser de vivre dans le passé avec ses Français et ses Anglais… J’ai fait mon arbre généalogique après qu’il m’ait montré le sien et me voilà aussi accro que lui! Je suis le descendant d’un soldat des Compagnies franches de la Marine, arrivé à Québec en 1750 à bord du navire marchand l’Infante Victoire. Il joignit la Compagnie de Saint-Ours, se maria à Québec en 1758 avec le grade de caporal et, ensuite, il obtint une concession dans le fief Dutord en 1778. Il me reste encore beaucoup de recherches à faire pour tenter de retrouver un maximum d’information sur lui. Selon la généalogie des Saint-Ours, son capitaine devait être Pierre-Roch de Saint-Ours; hélas, il est le seul dans la famille avec très peu de détails sur ses états de service. Il est seulement mentionné qu’il a participé à la majorité des batailles de son époque…
Enfin, votre livre est un très bel ouvrage.
Merci encore.
Martin Dauphinais
Le 9 septembre: 250e anniversaire de l’incendie de la Côte-du-Sud
Le 9 septembre 1759, des troupes dirigées par George Scott et Joseph Goreham débarquent simultanément à Kamouraska et à la rivière du Sud (Montmagny) dans le but de ravager les fermes de la Côte-du-Sud qui, depuis juin, avaient été laissées à la charge des femmes, des enfants et des vieillards, les hommes en état de porter les armes ayant été rassemblés à Québec pour défendre la capitale.
L’armée britannique assiégeait alors Québec depuis plus de deux mois. De Pointe-Lévy, Monckton bombardait inlassablement la ville. Campé sur la rive est de la rivière Montmorency, Wolfe avait cherché tout l’été le moyen de faire bouger Montcalm, résolument retranché à Beauport. Le 31 juillet, il avait vainement tenté de traverser la rivière. Indécis, malade, contesté par ses adjoints, il voyait le temps passer et appréhendait le moment où il faudrait lever le siège.
En juin, sachant que les postes qu’il installerait autour de Québec seraient vulnérables, Wolfe avait fait afficher un placard invitant les civils à demeurer à l’écart du conflit, mais cet avertissement n’avait pas eu l’effet souhaité. Comme il l’écrivait lui-même, « des vieillards de soixante-dix ans et des garçons de quinze ans postés à la lisière de la forêt font feu sur nos détachements, et tuent ou blessent nos hommes ». À la mi-juillet, il avait sommé les habitants de rentrer tranquillement chez eux avant le 10 août, sinon, « s’ils persistent à prendre les armes », il fera ravager leurs propriétés. C’est d’ailleurs ce qu’il avait prévu, dès le mois de mars, en cas d’échec de son expédition : détruire les fermes, les récoltes et le bétail, « expédier en Europe le plus grand nombre possible de Canadiens en ne laissant derrière [lui] que famine et désolation », comme en Acadie.
Sans attendre cette date-butoir, dès le début d’août, Wolfe fait incendier Baie-Saint-Paul et La Malbaie par Goreham qui mène aussi un raid du côté de la Grande-Anse (Sainte-Anne et Saint-Roch). Quelques paroisses de Lotbinière et toute la côte de Beaupré, de la rivière Montmorency jusqu’au cap Tourmente, subissent le même sort. Au début de septembre, dans la région sous contrôle britannique, il ne reste que la Côte-du-Sud à brûler.
Scott est donc chargé de ravager des paroisses qui se trouvent à plus de 100 kilomètres du théâtre des opérations et ne menacent pas directement l’armée britannique : Kamouraska, Rivière-Ouelle, Sainte-Anne, Saint-Roch, Saint-Jean, L’Islet et une partie de Cap-Saint-Ignace où il se rembarque pour retourner à Québec le 17 septembre. Sur ce territoire, qui comptait environ 600 foyers, Scott déclare avoir brûlé « 998 bons bâtiments, deux sloops, deux goélettes, dix chaloupes, plusieurs bateaux et petites embarcations ». De son côté, du 9 au 15 septembre, Goreham s’occupe de la région de la rivière du Sud, probablement jusqu’à Berthier, sans négliger l’île aux Grues.
Pendant cette semaine tragique, les Sud-côtois ont résisté dans la mesure de leurs moyens, multipliant les embuscades sur le chemin des incendiaires. L’Histoire retiendra le nom de Charlotte Ouellet qui a pris les armes avec d’autres femmes à Sainte-Anne. Dans la région de L’Islet, les hommes de Scott ont fait six prisonnières qui sont probablement aussi des résistantes. À Montmagny, le 13 septembre prochain, on dévoilera un monument à la mémoire du seigneur Jean-Baptiste Couillard qui a été tué par les Anglais le 14 septembre avec trois autres combattants.
(pour plus de détails, voir L’Année des Anglais ; la Côte-du-Sud à l’heure de la Conquête, Septentrion, 2009, http://www.septentrion.qc.ca/)
Un conte amérindien
Le Anglais et les Français ne se sont pas affrontés dans la guerre de la Conquête pour une question de territoire mais bien pour avoir l’exclusivité du commerce avec les Sept nations qui contrôlaient alors les routes maritimes entre Gaspé et le lac Érié. En septembre 1759, le général Amherst est allé à Kahnawake pour obtenir de l’aide afin de se rendre à Québec en sécurité et appuyer Wolfe dans sa bataille contre les Français. En route vers Québec, le convoi rassembla d’autres Amérindiens et, arrivés à destination, les Mohawks conseillèrent à Amherst de mener un raid nocturne pour surprendre l’ennemi. Ce qui fut fait, avec succès, et les Français se rendirent au grand dam de Montcalm, furieux de voir Wolfe triompher sous la direction des Mohawks et avec des tactiques déshonorantes pour l’armée britannique. Montcalm défia alors Wolfe et ils moururent tous deux au terme d’un duel. Le conflit se régla finalement par le traité d’Oswegatchie.
Voilà comment les événements de 1759 étaient racontés par les anciens de Kahnawake dans le jeune temps de Billy Two Rivers qui les a relatés à son tour au journal communautaire mohawk Eastern Door (« The Plains of Abraham story », 27 février 2009, p. 1 et 4).
Le duel entre Wolfe et Montcalm sera sûrement l’élément le plus insolite de cette nouvelle version de la bataille des plaines d’Abraham… mais ce n’est pas le seul qui détonne.
Avec plusieurs références sûres à l’appui, Peter Macleod rapporte qu’un millier d’Amérindiens ont effectivement participé à la campagne de Québec dont quelques centaines de guerriers des Sept nations : Mohawks de Kahnawake et d’Akwesasne, Mohawks, Algonquins et Nipissings de Kanesatake, Onontagés d’Oswegatchie, Abénaquis d’Odanak, et de Bécancour, Hurons de Lorette… Mais ils étaient du côté des Français! Quelques années plutôt, lors d’une réunion à New York, des représentants de Kahnawake avaient refusé de rester neutres dans le conflit : « Les Français et nous sommes un seul et même sang, ont-ils répondu, et où ils mourront, nous mourrons aussi. Nous sommes comme les deux doigts de la main; là où iront les Français, nous irons aussi » (La vérité sur les Plaines d’Abraham, Montréal, l’Homme, 2008, p. 106-108).
Pour sa part, le général Amherst n’est jamais venu à Québec en 1759; il est resté dans le haut Saint-Laurent et n’aurait pu atteindre Québec sans prendre d’abord Montréal qui n’a capitulé qu’en septembre 1760, un mois après le présumé « traité » d’Oswegatchie dont il ne reste aucune trace écrite… Le « contrôle » de la voie maritime par les Amérindiens en 1759 tient aussi de la légende.
Le chef Billy Two Rivers a senti le besoin de partager cette tradition orale pour le bénéfice de sa communauté et « to correct some misinformation he read about the 1759 battle in Québec City »…
L’année sera longue.