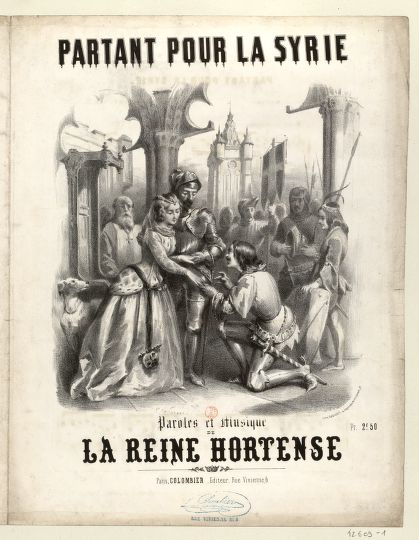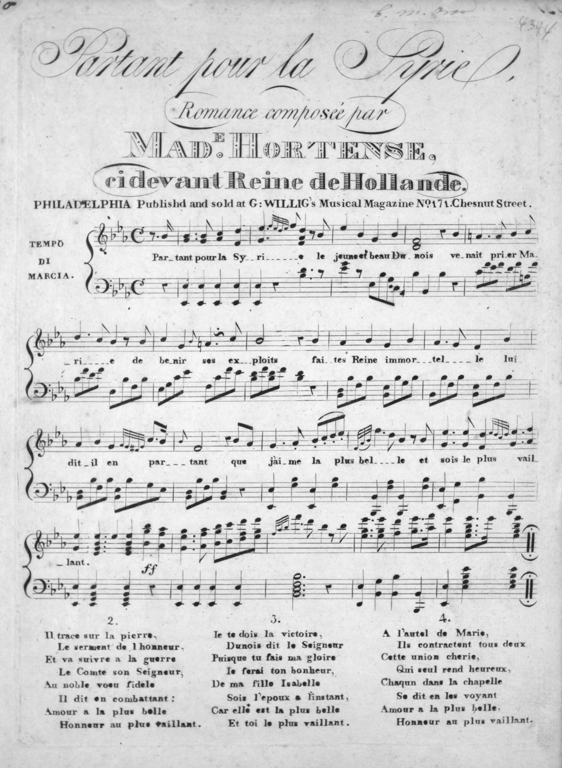Dans Le Devoir de ce matin, sous le titre « Québec, notre grand frère nous abandonne », le président de l’ACFA, porte-parole de la francophonie albertaine, écrit entre autres choses que le Québec « dit non à l’enseignement du français dans l’Ouest canadien » (http://www.ledevoir.com/politique/canada/430330/francophones-hors-quebec-le-quebec-notre-grand-frere-nous-abandonne). Jean Johnson réagit à un article de Philippe Orfali qui s’intitulait « Québec s’oppose aux minorités francophones » (Le Devoir du 22 janvier).
Les Québécois peu familiers avec la cause actuellement débattue en Cour suprême le resteront malheureusement si leur information se limite à ces deux textes (et particulièrement aux titres simplificateurs), d’autant plus qu’il règne un silence à peu près total sur ce sujet dans les médias québécois, mis à part Le Devoir, justement, qui a consacré plusieurs textes de fond sur cette cause et l’interprétation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits.
Michel David a cerné la question dans sa chronique du 27 janvier (« La famille éclatée » – http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430050/la-famille-eclatee).
« L’article 23 de la Charte canadienne des droits stipule que les citoyens canadiens qui ont reçu leur instruction primaire en français ou en anglais au Canada, et qui résident dans une province où cette langue est celle de la minorité, ont le droit de faire instruire leur enfant dans cette langue au primaire et secondaire.
Le bassin d’élèves francophones étant limité, la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY) voudrait pouvoir accueillir des descendants de francophones, des immigrants ou simplement des francophiles qui ne répondent pas aux critères de l’article 23, mais le gouvernement du territoire s’y oppose pour des raisons financières ».
La question est de savoir s’il revient à la minorité francophone d’une province de déterminer qui peut avoir accès à l’instruction en français. On imagine avec quel intérêt la minorité anglo-québécoise attend cette décision qui pourrait lui permettre de contourner les dispositions de la loi 101. David précise qu’« aucun gouvernement, libéral ou péquiste, n’a voulu envisager cette possibilité » et, comme l’avait fait le gouvernement Bourassa en 1989, dans une cause concernant les Franco-Albertains, le gouvernement du Québec se range de l’avis du Yukon.
Dans un point de vue publié mercredi, toujours dans Le Devoir (« Québec ne joue pas franc jeu »), le professeur André Braën « imagine facilement ce qu’il adviendrait si l’admissibilité à l’école anglaise au Québec était laissée entre les mains de la minorité elle-même. Bref, ce serait la situation du libre choix d’avant la loi 101 ». Mais le juriste se demande si l’interprétation de l’article 23 « doit être uniforme partout au Canada ou si l’asymétrie est possible ». (http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430095/francophones-au-yukon-quebec-ne-joue-pas-franc-jeu)
Un autre juriste, Guillaume Rousseau, reprend cette idée d’asymétrie dans un texte qu’il signe le même jour, et dans le même journal, avec Éric Poirier (« Sortir du piège de l’article 23 » - http://www.ledevoir.com/politique/quebec/430094/sortir-du-piege-de-l-article-23).
« Le Québec pourrait inciter la Cour suprême à davantage tenir compte du contexte et donc à interpréter strictement le droit à l’école anglaise au Québec, tout en interprétant largement les droits scolaires des minorités francophones du reste du Canada.
Théoriquement, cette position se tiendrait, entre autres parce que la Cour a elle-même souvent répété que, lorsqu’on interprète une loi, il faut tenir compte du contexte. Les conséquences politiques d’un tel raisonnement pourraient toutefois freiner une évolution de la jurisprudence dans ce sens. Les Canadiens anglais accepteraient mal une interprétation moins favorable à l’anglais au Québec qu’au français dans le reste du Canada. »
On voit ça d’ici : le Québec traité différemment… Pour Rousseau et Poirier, c’est risqué : la jurisprudence interprétant largement le droit à l’école française au Canada anglais servirait d’argument en faveur d’un droit toujours plus large à l’école anglaise au Québec.
La position du Québec pourrait cependant évoluer afin d’échapper au piège de l’article 23 : « Québec pourrait cesser ses interventions devant les tribunaux contre les droits des francophones du reste du Canada et les associations franco-canadiennes pourraient cesser d’intervenir contre la loi 101 et ses objectifs ».
Dans les familles en chicane, il faut peut-être espacer les réunions ou éviter certains sujets de discussion.