Chansonnier à la belle époque de ce genre musical, professeur de philosophie (il m’a enseigné la logique en 1966…), parolier pour nos meilleurs interprètes (prix Luc-Plamondon 2007), auteur de jingles (Mon bikini, ma brosse à dents, Sico, les puddings Laura Secord, etc.), scénariste, réalisateur, producteur, metteur en scène et maintenant peintre, Marcel Lefebvre vient d’ajouter une nouvelle section à son c.v. en publiant Les amants de 1837 chez Libre Expression.
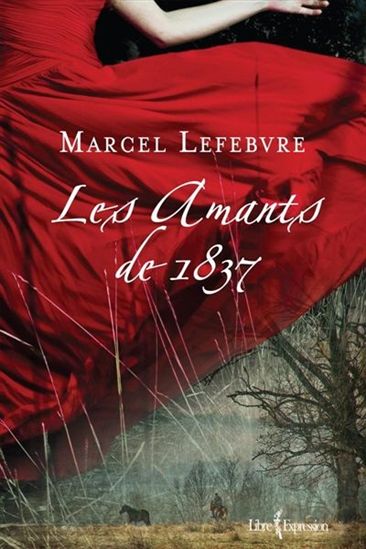
L’action se situe pendant la première rébellion. L’auteur met en scène un jeune patriote du Bas-Canada qui tombe amoureux de la fille d’un officier britannique de haut niveau. Jean Noland est rejeté par sa famille à cause de son engagement politique tandis que la belle Mary Patinson provoque la fureur de son père en s’amourachant d’un rebelle. Cette situation déjà délicate est compliquée par la présence d’une jeune Amérindienne qui s’éprend à la fois de la cause et du patriote. Les deux femmes ont un autre point commun : Noland leur a toutes les deux sauvé la vie. L’auteur ne manque pas d’imagination.
Cet ouvrage est un roman, et non une monographie historique déguisée en œuvre littéraire. L’auteur a imaginé une histoire plutôt étonnante qu’il situe dans un contexte historique. Auy sujet de la rébellion, il distille l’essentiel, au fil des pages, sans insister sur les arcanes de la politique. Pas de longs débats entre les protagonistes, assez peu de dialogues. Mis à part Wolfred Nelson, on y voit à peu près aucun des chefs patriotes, mais on comprend très bien ce qui se passe.
L’objectif de l’auteur était ailleurs et il atteint son but en créant de l’émotion et de l’intérêt chez le lecteur. Il a fait de sérieuses recherches pour que son contexte historique soit réaliste et ses descriptions, plausibles. Le parcours de son Noland est celui du militant patriote classique : engagement, bataille, fuite, capture, prison. Avec à peine quelques feuillets entre les doigts de la main droite, le lecteur sent que l’« affaire » est sans issue quand, soudainement, l’auteur dénoue l’intrigue de façon peu banale. « La fin de l’histoire surprendra le lecteur » disait l’éditeur. Avec raison.
Bouilli du mois d’août
Un petit ménage dans la boîte des coupures de presse.
Souverain mépris
Quel progrès! Nous aurons une marine royale. Personne ne l’avait prévue, celle-là, même si le ministre de la Défense prétend corriger une erreur « historique » et répondre à des revendications, dont personne n’a entendu parler. Un de ses prédécesseurs ajoute que le retour du mot « royal » dans l’appellation des forces armées n’aurait « rien à faire avec la royauté »… Et un autre ministre « de la Couronne » (allons-y donc avec les vraies appellations!) d’affirmer : « On est fiers d’être une monarchie constitutionnelle. C’est ce que nous sommes, c’est ce qui nous définit comme Canadiens. C’est dans notre identité…», tout en ajoutant « que l’indépendance du Canada est plus forte que jamais »!
Peut-on convenir qu’ils disent n’importe quoi? Serions-nous de retour à la case départ, forcés de reprendre le combat de 1899, quand Bourassa (Henri, le vrai, comme disait Jacques Normand) prônait l’indépendance… du Canada face à l’Angleterre?
On s’attend maintenant à ce que les producteurs du papier hygiénique Royale, le plus épais sur le marché, devienne le fournisseur officiel de l’armée du même nom et bénéficie de l’appellation « By Royal Appointment ».
En garde, Ottawa?
Toujours sur le front outaouais, le Bureau du Québec vient de changer de chef. Le nouveau titulaire était jusqu’à récemment chef de cabinet du ministre canadien des Affaires étrangères. Il a été précédemment rédacteur de discours pour le premier ministre conservateur Brian Mulroney à la fin des années 1980 et au début des années 1990. C’est donc un vétéran des coulisses du Parti conservateur et du gouvernement fédéral. On devine qu’il y a connu l’actuel chef du gouvernement du Québec quand ce dernier jouait sous d’autres couleurs.
Le chef du Bureau du Québec représente « les yeux et les oreilles de la province » à Ottawa. Comme dans toute autre « ambassade », on y pratique certaines formes d’ « espionnage » mais il serait étonnant qu’on y fasse du zèle sous cette nouvelle administration.
Tailor Made Fable, Dance Laury Dance et autres Picard Bands
Tandis que Sylvain Cossette et Roch Voisine exhument les classiques américains, Grégory Charles annonce la parution d’un disque de ses compositions en français et Kim Richardson, anglophone née en Ontario, lance une compilation de classiques francophones. Faut croire qu’il y a encore un marché dans cette langue.
Pendant ce temps, Pascale Picard Band fait des petits dans la région de Québec où des groupes de musiciens francophones tentent fortune aux USA en interprétant des chansons en anglais, naturellement, ce qui est bien légitime, mais en se présentant de plus sous des étiquettes anglaises. Pathétique.
Jack Saloon
Pour rester dans le même registre…
La ville de Québec s’est enrichie d’un nouveau restaurant la semaine dernière. Dans un secteur où on trouve le Louis-Hébert, le Dagobert, le Saint-Hubert, les Vieux Canons, le Rivoli, la Maison du spaghetti, le Grand Café, Maurice et Charlotte, les promoteurs ont préféré se coller aux McDo, Voodoo et autres Starbucks en désignant leur établissement sous le nom de « Jack Saloon ». Par quel orifice l’Office de la langue française peut-il absorber ça? On se le demande.
« S’enrichir » n’est cependant pas le terme approprié. Le Jack Saloon a fait parler de lui lors de son ouverture en mettant à la disposition de sa distinguée clientèle la nouvelle star de la gastronomie étatsunienne, le Krispy Kreme Burger, ce « sandwich » dont le pain est remplacé par un beigne qui contient une boulette de viande « gigantesque », du bacon fumé maison, de la laitue, des tomates et, moyennant un léger supplément, un œuf.
Le Krispy Kreme Burger contient 1550 calories, soit trois fois plus qu’un Big Mac. Disons donc plutôt que la capitale s’est « engraissée » d’un restaurant.
Je me souviens : une nouvelle pièce au dossier
Une nouvelle pièce s’est ajoutée au dossier du Je me souviens en mai dernier lorsqu’un groupe de descendants d’Eugène-Étienne Taché, architecte de l’Hôtel du Parlement et auteur de la devise, a remis au président de l’Assemblée nationale une lettre collective exposant par écrit, pour la première fois à ma connaissance, la thèse selon laquelle la devise Je me souviens est « un abrégé de l’intégral Je me souviens que né sous le lys je croîs sous la rose, ce texte ayant évidemment dû être abrégé pour être inscrit sur la façade du Parlement ». Les signataires soutenaient aussi que Taché aurait « souvent expliqué » son intention à sa famille; cette « mise au point fut à maintes reprises faite par madame Taché, décédée en 1931, à ses trois filles » et ces dernières « ont transmis cette information à leurs propres enfants ».
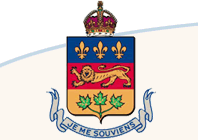
Le premier problème avec cette tradition familiale est qu’aucune autre source ne la corrobore.
Aucune des personnes qui ont écrit sur le sujet à l’époque de Taché n’a évoqué l’existence de cet « intégral ». Pourquoi Taché n’en aurait-il pas informé Thomas Chapais, alors président du Conseil législatif et ministre sans portefeuille, ou Ernest Gagnon, secrétaire des Travaux publics, deux hommes qu’il connaissait très bien et qui s’ingéniaient, en 1895 et 1896, à expliquer le sens de la devise? Il leur aurait évité bien des soucis, ainsi qu’à tous les autres qui en ont cherché la source pendant des décennies. Il y a quelque chose qui heurte l’intelligence dans cette idée que seuls les proches de Taché connaissaient ce prétendu « intégral » et en ont préservé le secret pendant presque un siècle. En effet, de la création du Je me souviens, vers 1883, jusqu’à son apparition sur les plaques d’immatriculation, en 1978, on ne trouve aucune source, texte, dictionnaire ou recueil de citations expliquant l’origine et la signification de la devise par cet « intégral » ni d’ailleurs aucune trace écrite de cet « intégral », entre 1908 et 1978, date où une petite-fille de Taché intervient dans The Montreal Star pour dire que Je me souviens est « just part of it ».
Le second problème est que cette croyance est explicitement contredite par des auteurs très crédibles contemporains de Taché.
Dans Le fort et le château Saint-Louis (Montréal, Beauchemin, 1908), après avoir rappelé que Taché a donné au Québec son Je me souviens, Ernest Gagnon écrit qu’on pourrait peut-être lire bientôt « sur un de ses monuments cette autre devise si poétique et si vraie : Née dans les lis, je grandis dans les roses ». Dans un article publié la même année, Gagnon précisait son information : « On a parlé, il y a quelque temps, d’une œuvre d’art représentant une femme, une adolescente gracieuse et belle, symbole de la Nation Canadienne. Cette allégorie de circonstance, qui est encore inédite, devrait être accompagnée de la devise: Née dans les lis, je grandis dans les roses / Born in the lilies, I grow in the roses. »
Le projet de monument ne s’est pas concrétisé, mais Taché a « recyclé » son idée sur la médaille commémorative qu’il a conçue pour le troisième centenaire de la ville de Québec en 1908. On peut en effet y lire : « Née sous les lis, Dieu aidant, l’œuvre de Champlain a grandi sous les roses ».
La citation la plus convaincante est toutefois celle de David Ross McCord (fondateur du Musée McCord), qui écrivait ceci dans un cahier de notes, vers 1900, sous le titre « French sentiment in Canada » :
[Traduction] « … personne ne peut nier la beauté et la simplicité du Je me souviens d’Eugène Taché. Siméon Lesage et lui ont fait plus que quiconque au Canada pour une architecture de qualité dans la province. D’ailleurs, Taché n’est-il pas aussi l’auteur de l’autre devise, Née dans les lis, je croîs dans les roses, à laquelle nous lèverons tous nos verres. Il n’y a rien là pour favoriser la désunion ».
Ce commentaire établit, sans l’ombre d’un doute, que Je me souviens et Née dans les lis, je croîs (ou grandis) dans les roses étaient deux devises distinctes et ne constituaient pas un « poème » comme plusieurs le prétendent. Mieux encore, les deux devises ont un sens différent et McCord préfère nettement la seconde.
Taché s’est peu exprimé par écrit, mais c’était un homme de goût, instruit et cultivé. Ses deux devises sont bien frappées et il est difficile d’imaginer qu’il soit l’auteur d’une phrase aussi maladroite que « Je me souviens que né sous le lys je croîs sous la rose ». On y trouve notamment une évidente faute de concordance des temps (le verbe croître doit être au passé, je crûs ou j’ai crû) et l’ensemble porte à croire qu’il s’agit d’un collage des deux devises réalisé après la mort de leur auteur (1912).
Par qui et pour quoi? Mystère, mais la note de McCord et l’inconfort qu’elle exprime face à la devise révèlent que cette dernière dérangeait ceux qui la considéraient trop exclusivement francophile; on aurait donc utilisé l’autre devise comme complément, contrepartie ou réplique, ce qui a eu pour effet de donner au Je me souviens un sens très particulier : en effet, la proposition principale du prétendu « intégral » serait « Je me souviens que … je croîs [sic] sous la rose ». Dans ce bricolage, la référence aux origines françaises du Québec (« né sous le lys ») devient une proposition secondaire et la devise ainsi « remaniée » évoque les bienfaits de la Conquête, un détournement de sens qui n’est pas innocent.
Les Acadiens et leur hymne national
Les Acadiens célèbrent aujourd’hui leur fête nationale. Ils ont la chance, eux, de pouvoir entonner un hymne officiel. Pas de pays, pas de territoire aux frontières précises? Peu importe. Ils n’ont que faire de l’objection formulée ici lorsque Raoul Duguay a proposé un hymne québécois récemment : « Québec n’est pas un pays », donc il ne pourrait avoir d’hymne national… C’est pourtant une nation reconnue par Ottawa.
Le chant national acadien a été choisi en 1884 lors de la deuxième convention nationale des Acadiens dans les instants qui ont suivi le dévoilement de leur drapeau, un tricolore orné d’une étoile dorée. Quelqu’un entonne alors le chant religieux bien connu Ave Maris Stella (Salut, astre des mers) et l’assemblée décide sur le champ qu’il s’agira désormais de l’hymne national.

La première strophe se lit comme suit :
Ave maris stella (Salut, Astre des mers)
Dei mater alma (Auguste mère de Dieu)
Atque semper virgo (qui toujours demeuras vierge)
Felix coeli porta (heureuse porte du ciel) (bis)
Amen (Amen)
À partir des années 1960, plusieurs contestent l’Ave Maris Stella, un hymne religieux, mais une majorité d’Acadiens souhaite le conserver. En 1994, à la suite d’un concours pour créer une version française, le texte de Jacinthe Laforest, journaliste à La Voix acadienne est choisi et l’hymne est chanté en français (avec une première strophe latine) à la clôture du premier Congrès mondial acadien.
Ave maris stella
Dei mater alma
Atque semper virgo
Felix coeli porta (bis)
Acadie, ma patrie
À ton nom je me lie
Ma vie, ma foi sont à toi
Tu me protégeras (bis)
Acadie, ma patrie
Ma terre et mon défi
De près, de loin tu me tiens
Mon cœur est acadien (bis)
Acadie, ma patrie
Ton histoire, je la vis
La fierté, je te la dois
En l’avenir je crois (bis)
L’enregistrement ci-joint comprend deux strophes en latin (http://www.youtube.com/watch?v=Xy73pY1LiLY).
« Fantastique »
Dans le Devoir du 29 juillet, Christian Rioux a publié une analyse acide du comportement de nos médias lors du passage des Metallica, U2 et autres Sir Paul au Québec (http://www.ledevoir.com/politique/quebec/328349/comme-les-americains).
Quelques extraits :
« À Paris, à Rome ou à Berlin, ces grandes productions passent plusieurs fois par année. Mais elles font rarement la une des médias généralistes. On en parle évidemment dans les pages culturelles et les médias spécialisés.
Ici, dès qu’une grande vedette anglo-saxonne débarque, le grand chœur des colonisés se répand en courbettes. C’est comme si Metallica nous faisait une faveur inestimable. Comme si les nouveaux dieux nommés Bono ou Lady Gaga nous avaient désignés comme le nouveau peuple élu. Que Sir Paul prononce quelques mots en français sur scène et c’est le délire. Voilà qu’une armée de chroniqueurs et d’animateurs le remercient d’avoir daigné parler la langue de l’autochtone […].
Partout où il va, Paul McCartney prononce quelques mots en allemand, en chinois ou en slovène, et cela n’étonne personne. Sauf ici, où nous avons poussé le mépris de nous-mêmes jusqu’à ne plus juger de notre réussite culturelle qu’à l’aune du regard des autres ».
Les observations de Rioux auraient pu s’appliquer aussi au « Kate and William Tour » qui a suscité le même genre de réactions. Quelques jours plus tard et il aurait pu ajouter le cas Rod Stewart. Sept pages dans le Journal de Québec ce matin, onze dans Le Soleil ! « Full front pages » incluses, comme ils disent. On sait tout : ce qu’il portait, ce qu’il a mangé et bu, la marque et la couleur de la voiture, et ce que son groupe a visité, soit les chutes et un magasin Super C. ! Et dire que le spectacle semble avoir été moyen, selon la critique du Soleil . Daniel Gélinas aurait commenté brièvement : « C’est un bon artiste »… Et nous n’avons pas de réaction du maire. ..
Stewart n’a pas parlé de Lévis mais aurait dit en français « fantastique », une fois, mais c’était peut-être plutôt … « fantastic ». Peut-être connaît-il les Denis Drolet (http://www.youtube.com/watch?v=nliLWKaH0lQ). N’est-ce pas réconfortant?