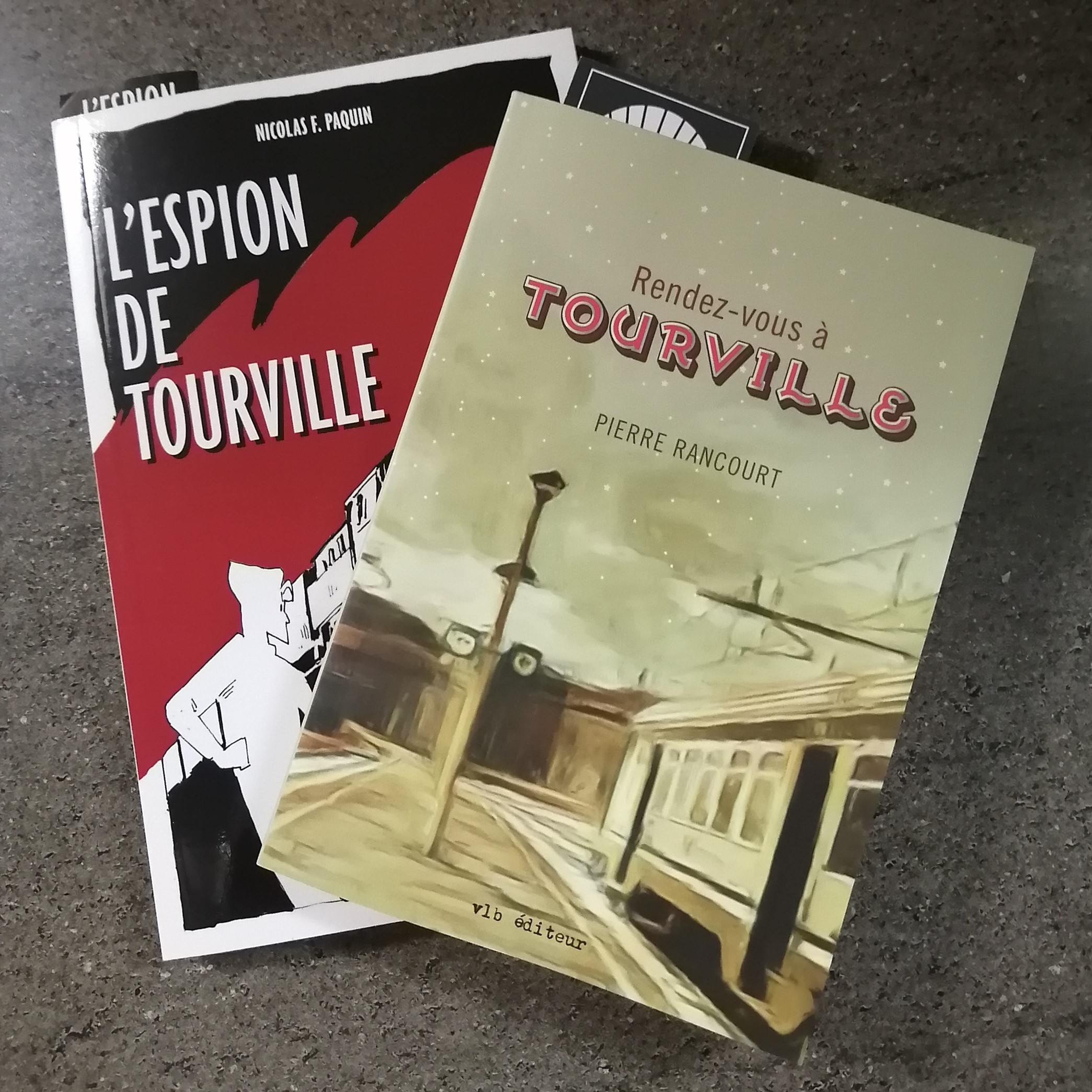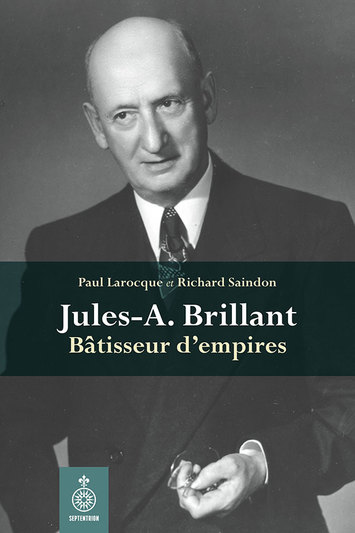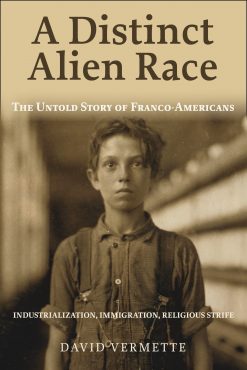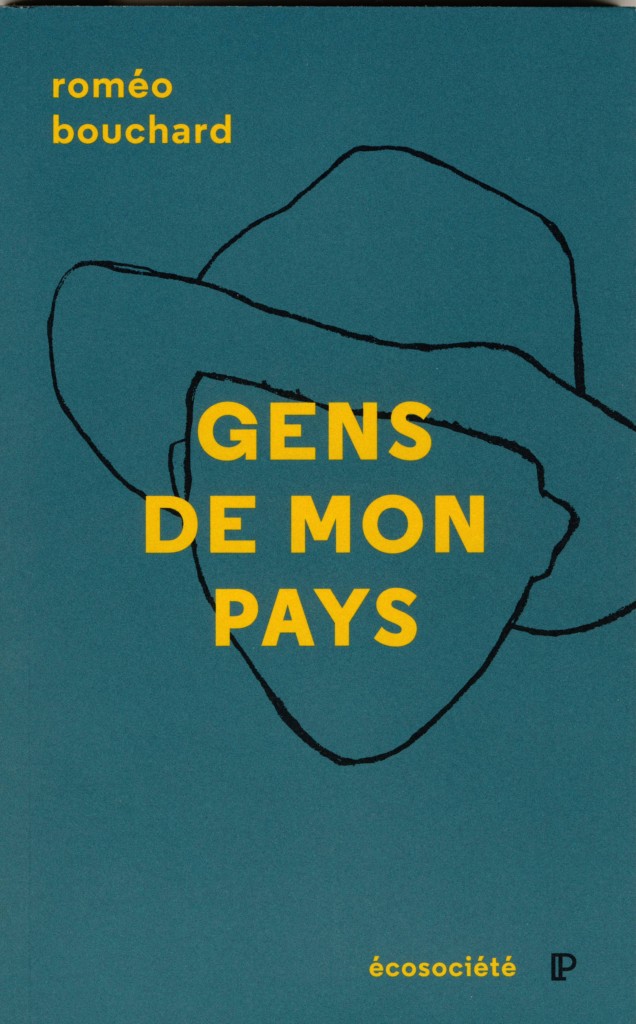En moins d’un an, deux romanciers ont mis en scène une petite municipalité située au sud de Saint-Jean-Port-joli, à mi-chemin entre le fleuve et la frontière américaine, qui vient d’avoir cent ans et s’accroche à la vie.
Les premiers habitants sur le territoire actuel de Tourville sont arrivés plus d’un demi-siècle avant la création de la paroisse en 1919. Construite entre 1854 à 1859, la route Elgin a donné accès à ce territoire où on exploitait déjà le bois. Un premier agriculteur s’est établi au lac Noir aussi nommé « lac à Pitoune », d’après le surnom, dit-on, de la gouvernante d’un gite de l’endroit…
C’est toutefois la construction du Transcontinental, de 1905 à 1913, qui assure le développement de Tourville à partir d’une station de chemin de fer nommée en l’honneur de l’ancien gouverneur général Monk. On bâtit ensuite une usine de réparation de locomotives, une chute à charbon, un réservoir d’eau et une gare. Apparaissent aussi des hôtels et divers services dont un cinéma, le premier de la région. Tourville est une sorte de « boom town » moderne.
Le chemin de fer est évidemment au cœur des deux romans.
L’espion de Tourville
Installé depuis quelques années à Saint-Roch-des-Aulnaies, Nicolas Paquin a situé L’espion de Tourville (Éditions du Phoenix, 2019) pendant la Seconde guerre mondiale, son sujet de prédilection.
« Fraîchement descendu à la gare d’un village isolé des Appalaches, un mystérieux étranger pique la curiosité sur son passage. Un chargement d’armes disparaît lors de l’arrêt d’un train de marchandises. Un groupe de jeunes embrigadés menacent la paix publique. Un étudiant, traqué par la police militaire, se cache dans les bois. Et si ces événements étaient tous reliés à la guerre qui sévit en Europe en cet été 1943? Il n’en faut pas plus pour aiguiser le flair de Samuel Pion et bouleverser son premier été à Tourville, PQ. »
Samuel Pion, S. Pion, l’espion… C’était facile, mais l’auteur a fait des recherches historiques minutieuses, et marie habilement les faits réels avec ceux qu’il imagine, en évitant le ton didactique.
Rendez-vous à Tourville
Pour écrire Rendez-vous à Tourville (VLB, 2020), Pierre Rancourt a puisé dans ses souvenirs d’enfance. Il est né à Tourville en 1945, à l’époque où le « Ciennar » était le principal employeur. Il lui faudra quelque temps avant de comprendre que « Ciennar » n’était pas un mot mais un sigle, CNR (Canadian National Railway), qu’il fallait prononcer à l’anglaise.
Dans son roman plein d’humour, Rancourt donne une large place à l’Église, qui représente la stabilité, mais ce qui ressort de son récit est plutôt le changement que représentent en particulier la télévision et ses vedettes, dont sa chère Janette Bertrand. Il voit passer la troupe de Grimaldi, mais il est évident que cette époque achève.
Rancourt sera aussi témoin de changements encore plus déterminants pour Tourville : les trains passent au diésel – ce qui rend caduc le dépôt de charbon –, l’usine de réparation des locomotives ferme en 1954, le chemin de fer perd des points au profit du camion et de l’autobus qui ont désormais des routes ouvertes à l’année.
La belle époque de Tourville est terminée. Pour les Rancourt, le déclin du CNR se traduit par le déménagement de la famille à Charny, dernier épisode du roman.
Et de Tourville? La gare est démolie en 1982 et les rails enlevés en 1986. La liste des commerces et des services se rétrécit. La municipalité compte maintenant moins de 600 habitants et doit sa survie au fait qu’elle est située sur une artère régionale importante (la route 204), à la jonction du « tronçon Monk », un sentier de 226 km pour motoneige et quad, ce qui fait de Tourville un indispensable carrefour de services entre Bellechasse et le Témiscouata.