Le 9 septembre 1759, des troupes dirigées par George Scott et Joseph Goreham débarquent simultanément à Kamouraska et à la rivière du Sud (Montmagny) dans le but de ravager les fermes de la Côte-du-Sud qui, depuis juin, avaient été laissées à la charge des femmes, des enfants et des vieillards, les hommes en état de porter les armes ayant été rassemblés à Québec pour défendre la capitale.
L’armée britannique assiégeait alors Québec depuis plus de deux mois. De Pointe-Lévy, Monckton bombardait inlassablement la ville. Campé sur la rive est de la rivière Montmorency, Wolfe avait cherché tout l’été le moyen de faire bouger Montcalm, résolument retranché à Beauport. Le 31 juillet, il avait vainement tenté de traverser la rivière. Indécis, malade, contesté par ses adjoints, il voyait le temps passer et appréhendait le moment où il faudrait lever le siège.
En juin, sachant que les postes qu’il installerait autour de Québec seraient vulnérables, Wolfe avait fait afficher un placard invitant les civils à demeurer à l’écart du conflit, mais cet avertissement n’avait pas eu l’effet souhaité. Comme il l’écrivait lui-même, « des vieillards de soixante-dix ans et des garçons de quinze ans postés à la lisière de la forêt font feu sur nos détachements, et tuent ou blessent nos hommes ». À la mi-juillet, il avait sommé les habitants de rentrer tranquillement chez eux avant le 10 août, sinon, « s’ils persistent à prendre les armes », il fera ravager leurs propriétés. C’est d’ailleurs ce qu’il avait prévu, dès le mois de mars, en cas d’échec de son expédition : détruire les fermes, les récoltes et le bétail, « expédier en Europe le plus grand nombre possible de Canadiens en ne laissant derrière [lui] que famine et désolation », comme en Acadie.
Sans attendre cette date-butoir, dès le début d’août, Wolfe fait incendier Baie-Saint-Paul et La Malbaie par Goreham qui mène aussi un raid du côté de la Grande-Anse (Sainte-Anne et Saint-Roch). Quelques paroisses de Lotbinière et toute la côte de Beaupré, de la rivière Montmorency jusqu’au cap Tourmente, subissent le même sort. Au début de septembre, dans la région sous contrôle britannique, il ne reste que la Côte-du-Sud à brûler.
Scott est donc chargé de ravager des paroisses qui se trouvent à plus de 100 kilomètres du théâtre des opérations et ne menacent pas directement l’armée britannique : Kamouraska, Rivière-Ouelle, Sainte-Anne, Saint-Roch, Saint-Jean, L’Islet et une partie de Cap-Saint-Ignace où il se rembarque pour retourner à Québec le 17 septembre. Sur ce territoire, qui comptait environ 600 foyers, Scott déclare avoir brûlé « 998 bons bâtiments, deux sloops, deux goélettes, dix chaloupes, plusieurs bateaux et petites embarcations ». De son côté, du 9 au 15 septembre, Goreham s’occupe de la région de la rivière du Sud, probablement jusqu’à Berthier, sans négliger l’île aux Grues.
Pendant cette semaine tragique, les Sud-côtois ont résisté dans la mesure de leurs moyens, multipliant les embuscades sur le chemin des incendiaires. L’Histoire retiendra le nom de Charlotte Ouellet qui a pris les armes avec d’autres femmes à Sainte-Anne. Dans la région de L’Islet, les hommes de Scott ont fait six prisonnières qui sont probablement aussi des résistantes. À Montmagny, le 13 septembre prochain, on dévoilera un monument à la mémoire du seigneur Jean-Baptiste Couillard qui a été tué par les Anglais le 14 septembre avec trois autres combattants.
(pour plus de détails, voir L’Année des Anglais ; la Côte-du-Sud à l’heure de la Conquête, Septentrion, 2009, http://www.septentrion.qc.ca/)
Le discours-canular de Fillon
Avez-vous reçu le texte du discours du premier ministre Fillon qui aurait dit aux musulmans français de retourner chez eux s’ils n’étaient pas contents? J’en ai quelques copies, je l’ai reçu cinq fois, au moins, dont deux fois aujourd’hui, je peux vous en fournir. Quoique… Sur le net, le tirage importe peu et c’est bien là le problème.
Ce « discours » est un canular qui circule depuis plus de deux ans. Le premier ministre français l’a évidemment dénoncé sur son blogue (http://www.blog-fillon.over-blog.com/article-18401508-6.html)
« Je dénonce un « hoax » détestable relayé sur le net. Depuis quelques semaines, la toile relaye des propos inacceptables sur les musulmans qui me sont attribués et qui se propagent sous forme de courrier électronique repris par plusieurs blogs. Je vous confirme qu’il s’agit d’un « hoax », en français un canular, détestable, en l’occurrence une fausse déclaration. Ce courrier circule en réalité dans le monde entier depuis plus d’un an et a déjà attribué ces propos à plusieurs dirigeants ou chefs de gouvernement étrangers. J’invite les internautes qui seraient susceptibles de croiser ce canular à le dénoncer. Le web ne doit pas être l’espace des mensonges et de la haine raciste. Ceux qui me connaissent savent que de tels propos sont aux antipodes de ce que je suis, de ce que je pense, de tout mon engagement politique républicain et humaniste. » (Fin de la citation)
Des milliers de personnes se sont fait prendre, comme cela arrive trop souvent sur le net, le Far West de l’information. Il en a été souvent question sur le site des chasseurs de canulars ( http://www.hoaxbuster.com/hoaxteam/forum_contributions.php?idForum=3152&idMess=76712). Onslir, par exemple, a écrit le 17 avril 2009 dernier :
« Il s’agit d’un détournement d’un message qui fut Canadien (2007) et Australien (2008). Voici quelques liens sur le sujet discuté ici : http://www.hoaxbuster.com/hoaxteam/forum_contributions.php?idForum=3152&idMess=75205
http://www.hoaxbuster.com/hoaxteam/forum_contributions.php?idForum=3152&idMess=64281
Bref, bel hoax qui s’internationalise et tous les chefs des gouvernements occidentaux vont finir par y passer. »
Un autre internaute a écrit ce qui suit:
« déjà vu celui là en BELGIQUE en mars 2007 sur Hoaxbuster; ce texte venait du Canada http://www.hoaxbuster.com/hoaxteam/forum_contributions.php?idForum=3152&idMess=55657.
J’ai pas retrouvé le même texte en France …
Mais l’original vient des USA, comme Paty nous l’a démontré à l’époque (http://www.barryloudermilk.com/About.htm). […] »
Cet article a été écrit il y a quelques années par un politicien républicain de droite de l’État américain de Georgie, Barry Loudermilk. L’article, intitule This is America, a d’abord été publié dans un journal local, The Bartow Trader, quelque temps après le 11 septembre 2001. »
En changeant quelques mots, on peut adapter le message à plusieurs chefs de gouvernement.
Certains sont désolés, mais ça n’a rien à voir avec le sens critique. Comme cette internaute repentie :
« Désolée… je retire de suite… habituellement je vérifie, là je n’y ai été que superficiellement et ça me retombe dans la face… encore une fois désolée! [...]
Par contre… qu’il ait ou non dit ces propos, je suis d’accord avec! »
D’accord avec… la fausse nouvelle?
Un autre fond de panier
Certains diront sûrement qu’on est rendu plutôt au fond du baril… Enfin. Allons-y quand même car le matériel s’accumule trop rapidement.
Édition payante
Selon des reportages publiés dans les journaux du 20 août, un éditeur montréalais bien connu a donné 1,3 M$ en espèces, un bar, deux voitures, huit (!?) manteaux de fourrures et bien d’autres choses (pour un total de 2M$) à une danseuse du cabaret Chez Parée.
Les auteurs vont nous voir venir : comment les convaincre que l’édition est une industrie peu rentable?
« Fake, Fake! »
L’ex-gardien de but Jonathan Roy essaie de faire arrêter les procédures engagées contre lui. Entre l’incident qui l’a mené en cour et l’acte d’accusation, la Direction des poursuites criminelles et pénales aurait modifié sa position sur les incidents de ce genre; jusqu’à ce moment, il n’y avait poursuites que s’il y avait des blessures.
D’après l’avocat de l’accusé, « quand il a sauté sur la patinoire, Jonathan Roy était en droit de s’attendre à ne pas être poursuivi s’il n’infligeait pas de blessures à un adversaire en vertu de la directive datant de 1977 » (JQ, 19 août 2009).
Pourquoi, diable, a-t-il frappé sur son adversaire à tour de bras, après lui avoir arraché son casque, s’il ne voulait pas le blesser? S’agissait-il d’un combat arrangé?
Les bonnes œuvres du PDG de l’Hydro
Chaque jour apporte de nouveaux éléments aggravants dans ce dossier qui n’a probablement pas encore montré toutes ses coutures.
On est parti d’un cas qui devait être unique, selon un porte-parole de l’Hydro. Il y en a eu ensuite un second, mais il ne devait pas y avoir d’autres contribution « à aucun autre établissement secondaire » (Presse, 19 août). Mais le lendemain, on déterrait d’autres cas, dont le Séminaire de Sherbrooke et un high school, sans compter trois fondations qui aident des institutions qui ne sont visiblement pas des universités. Mieux encore, un autre porte-parole reconnaissait candidement qu’elle ne savait pas que son PDG était au conseil d’administration d’un autre bénéficiaire (Conference board). Il serait difficile de contredire le citoyen qui a eu l’impression de se faire bourrer.
Ce dossier pourra servir de cas pour les examens des étudiants en administration publique et en éthique pendant plusieurs années. Et plusieurs intervenants devraient retourner en recyclage et se soumettre à cette évaluation. La ministre des Ressources naturelles ne voit pas de conflit d’intérêts dans la subvention accordée au Collège Notre-Dame. « Pas d’avantage personnel », dit-elle. Comme si c’était un mannequin qui occupait la présidence du conseil d’administration de cette institution. Le directeur des ressources humaines du Collège Brébeuf estime pour sa part que des tranches de 40 000$ par an, « ce n’est pas une grosse somme », comme si le montant de la subvention avait la moindre importance (Presse, 19 août). Peut-être a-t-il été mal cité, ce qui n’est pas le cas de l’éditorialiste de la Presse (18 août) qui joue une défense semblable quand il écrit que « la subvention au collège Notre-Dame représente un dix millième des redevances versées annuellement par l’Hydro-Québec au gouvernement »…
Pourquoi tant d’histoires pour des peanuts?
Pour voir du bleu, allez au Vermont!
Le Vermont célèbre cette année le 400e anniversaire de l’arrivée de Champlain au lac qui porte son nom et, manifestement, personne ne songe à en attribuer le mérite à Dugua de Monts…
Le programme (http://celebratechamplain.org/) comprend des activités de toutes sortes organisées dans une quarantaine de localités : spectacles, expositions, conférences, excursions, compétitions, etc. Plusieurs activités soulignent le « French Heritage » et les racines françaises d’une bonne partie de la population. St. Albans avait son « Franco-American Heritage Festival » en juin et Vergennes, ses « French Heritage Days » en juillet.
Burlington pavoise autant qu’ici l’an dernier, à cette différence que le bleu domine outrageusement. On se croirait à Québec avant son amnésie transitoire de 2008.


Les fleurdelisés bâtards
Il suffit de porter un minimum d’attention aux drapeaux arborés par les institutions publiques québécoises pour constater que plusieurs d’entre elles ne respectent pas les dispositions de la Loi sur le drapeau et ne remplissent pas leurs obligations en matière de pavoisement. On ne parle évidemment pas ici des commerces, des hôtels et des autres établissements privés qui sont encore plus nombreux à pavoiser avec des fleurdelisés bâtards et des fleurs de lis qui ressemblent à peine au modèle défini par le Bureau de normalisation.
L’article 1 de la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec (L.R.Q., chapitre D-12.1) définit le format du fleurdelisé : « La largeur et la longueur du drapeau sont de proportion de deux sur trois » (2:3). On arbore donc normalement des drapeaux qui ont, par exemple, 60 cm sur 90 cm, 120 cm sur 180 cm, etc. La hauteur d’un fleurdelisé est égale aux deux tiers de sa longueur.
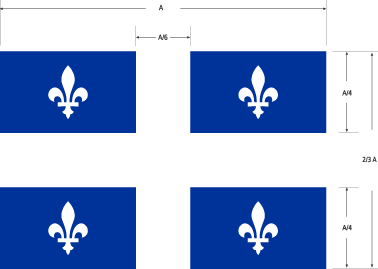
Par ailleurs, le Règlement sur le drapeau du Québec (c. D-12.1, r. 2.1) décrète que le fleurdelisé « doit être déployé de façon officielle par une institution publique ou un établissement relevant de l’Administration gouvernementale afin d’identifier son appartenance à cette dernière ». Il doit donc être déployé sur ou devant les édifices des ministères et des organismes gouvernementaux, des commissions scolaires, des cégeps et des universités, des organismes du secteur de la santé et des services sociaux, les édifices où siègent les tribunaux relevant de la compétence du Québec et les conseils municipaux, les bibliothèques municipales « et en tout lieu où une municipalité déploie sa bannière ». Ce règlement précise que « tout drapeau déployé doit être conforme aux normes du Bureau de normalisation du Québec » qui définit précisément les modalités de fabrication du fleurdelisé et, naturellement, son format légal.
Une simple promenade dans les rues de Québec ou de Montréal permet de constater que plusieurs institutions publiques et parapubliques arborent des drapeaux qui sont de proportion un sur deux (1:2), au lieu de deux sur trois (2:3), alors qu’il est pourtant facile d’acquérir des drapeaux normaux par l’intermédiaire du Centre des services partagés du gouvernement du Québec ou encore aux Publications du Québec.
Est-ce une question de coût ? Faut-il conclure que des organismes publics et parapublics acquièrent leurs fleurdelisés à meilleur coût directement du manufacturier, sans se soucier des normes de fabrication ? Interrogé sur ce sujet, un fabricant a répondu qu’il avait des fleurdelisés de format 1:2 dans son catalogue « pour répondre à des demandes venant de certains organismes publics ».
S’agit-il de simple ignorance ? Possible, mais on notera que l’université Laval arborait un fleurdelisé hors normes jusqu’à tout récemment et que la Grande Bibliothèque en a encore un, comme en témoigne cette photographie prise en juin 2009.

Dans le cas des institutions qui pavoisent simultanément aux couleurs du Québec et du Canada, le motif de « l’infraction » serait d’ordre protocolaire. En effet, le fleurdelisé et l’unifolié sont foncièrement incompatibles. Un fleurdelisé normal qui a la même longueur qu’un unifolié, disons 60 cm, est plus grand que ce dernier à cause de sa largeur (40 cm contre 30 cm) ; et, si le drapeau québécois a la même largeur que l’autre, disons, 40 cm, il sera plus petit parce que plus court (60 cm contre 80 cm). On peut arriver à leur donner la même surface mais ils n’auront jamais la même forme. Afin d’avoir des drapeaux de même grandeur, plusieurs institutions publiques « accommodantes » croient alors résoudre la quadrature du cercle en se procurant des fleurdelisés fabriqués selon la norme canadienne (1:2), au mépris de la Loi sur le drapeau (comme les incite d’ailleurs le catalogue du plus important fabricant de drapeau de la région de Québec avec son illustration fautive du fleurdelisé). Rares sont celles qui font l’inverse, ce qui serait pourtant plus logique et plus respectueux envers l’État auquel elles appartiennent.
Sur une page consacrée au fleurdelisé, le site Internet du gouvernement du Québec rappelle les normes de fabrication du drapeau et invite les citoyens et les administrations à « demeurer vigilants à cet égard et [à] n’utiliser que des drapeaux de format légal ». Le citoyen peut effectivement signaler les anomalies à la personne responsable du dossier au ministère de la Justice et il arrive que la situation soit corrigée. À la longue, on pourrait théoriquement amener un par un les administrateurs publics à respecter les lois et les règlements qui les gouvernent en matière de pavoisement, mais ce serait plus simple et plus efficace si la ministre chargée de l’application de la Loi sur le drapeau prenait ses responsabilités et, à défaut de contraindre les fabricants à respecter la loi et les normes du Bureau de normalisation, demandait la collaboration de ses collègues ministres pour adresser un rappel aux institutions qui relèvent de leur autorité.