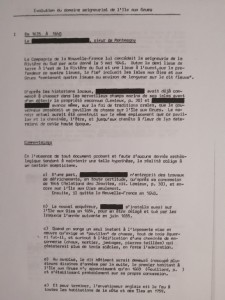Dans un texte du 5 novembre annonçant que le drapeau canadien retrouvera bientôt sa place normale, Radio-Canada rappelait que l’unifolié avait été mis en berne le 30 mai « après la découverte des restes de 215 enfants près du terrain d’un ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique » (https://www.msn.com/fr-ca/actualites/quebec-canada/l-unifoli%C3%A9-sera-hiss%C3%A9-de-nouveau-dimanche-soir/ar-AAQmOwC?parent-title=maux-de-lhiver-nos-solutions-douces-pour-passer-au-travers&parent-ns=ar&parent-content-id=AAk6mRi).
Quelques jours plus tôt (31 octobre, https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1835997/unifolie-pensionnats-autochtones-parlement-commemoration), la Presse canadienne (PC) avait adopté une formulation différente : le drapeau a été mis en berne « après que la Première Nation Tk’emlups te Secwepemc eut annoncé qu’un radar à pénétration de sol avait détecté ce que l’on pense être les restes de 215 enfants autochtones. »
La première formulation est courante, dans les médias québécois, pour parler du cas de Kamloops et des autres « découvertes ». Une chroniqueuse du Devoir a écrit le 23 octobre qu’on avait « trouvé » les corps de 751 enfants sur le terrain de l’ancien pensionnat de Marieval.

(photo CBC)
***
Il faut consulter les médias du Canada anglais pour comprendre la prudence de la PC. Le rapport préliminaire sur le cas de Kamloops a été dévoilé à la mi-juillet, mais ne semble pas avoir eu d’échos au Québec. Tel que rapporté notamment dans le Toronto Star du 16 juillet, le radar a repéré des « anomalies » dans le sol, mais on ne saura rien des « restes » tant qu’on ne les aura pas exhumés, comme l’a déclaré, la veille, le Dr Sarah Beaulieu, de l’Université Fraser Valley, qui supervise la recherche : « With ground-penetrating radar, we can never say definitely they are human remains until you excavate, which is why we need to pull back a little bit and say they are probable burials, they are targets of interest (Avec un radar à pénétration de sol, nous ne pouvons jamais dire avec certitude qu’il s’agit de restes humains tant qu’il n’y aura pas excavation, c’est pourquoi nous devons prendre un peu de recul et dire qu’il s’agit de sépultures probables, ce sont des cibles d’intérêt) » (https://www.thestar.com/news/canada/2021/07/16/number-of-probable-graves-near-former-residential-school-pegged-at-200.html).
La même observation s’applique vraisemblablement aux autres cas :
Notons qu’il ne s’agit de sépultures individuelles et non de « charnier », comme on a pu le lire dans de nombreux textes ici cet été.
***
D’autres éléments doivent aussi être pris en considération.
Les médias ont conclu que 751 sépultures repérées à la fin de juin étaient celles de pensionnaires de la Marieval Indian Residential School. « But, according to a band councillor, that’s not necessarily the case. “It appears that not all of the graves contain children’s bodies,” Jon Z. Lerat told the Globe and Mail, noting that this was also the burial site used by the rural municipality. […] “We did have a family of non-Indigenous people show up today and notified us that some of those unmarked graves had their families in them — their loved ones,” Lerat said. [Cowessess Chief Cadmus] Delorme added that oral stories said the graves belong to “both children and adults” as well as “people who attended the church or were from nearby towns” (https://torontosun.com/opinion/columnists/malcolm-its-important-to-bring-accuracy-to-residential-school-graves-conversation?fbclid=IwAR3rztbI-M2FkbYkk76qpzO4UXVTeG1haQEpso751gSDpbYbh_zpcw3HOlM) ».
Contexte similaire pour les « 182 tombes non marquées » repérées quelques jours plus tard : « Like the Cowessess cemetery graves, the Lower Kootenay unmarked graves are within an existing cemetery — and again the cemetery was used by the broader community. […] Former chief Sophie Pierre told Global News “there’s no discovery, we knew it was there, it’s a graveyard. The fact there are graves inside a graveyard shouldn’t be a surprise to anyone.” » Les archives de ce cimetière démontrent qu’il a été ouvert en 1865, 50 ans avant l’ouverture du pensionnat, et qu’il a été utilisé, à partir de 1874, par le seul hôpital de la région de Cranbrook (https://torontosun.com/opinion/columnists/malcolm-its-important-to-bring-accuracy-to-residential-school-graves-conversation?fbclid=IwAR3rztbI-M2FkbYkk76qpzO4UXVTeG1haQEpso751gSDpbYbh_zpcw3HOlM). On peut donc prévoir y trouver d’autres sépultures que celles d’enfants pensionnaires.
Les chiffres évoqués ci-dessus sont d’ailleurs intrigants. La Commission de vérité et de réconciliation a compté 139 pensionnats et 3200 enfants décédés, soit une vingtaine de décès par pensionnat, en moyenne. Or, dans les 4 cimetières mentionnés ci-dessus, on parle de 1300 sépultures, au total, soit une moyenne de plus de 300. Ce sont des chiffres difficiles à… réconcilier.
***
« Les drapeaux canadiens resteront en berne tant et aussi longtemps que le gouvernement fédéral n’aura pas eu l’aval des communautés autochtones pour les remonter », a déclaré Justin Trudeau au début de septembre (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1823325/drapeaux-canada-pensionnats-autochtones-trudeau-lever, 10 septembre), concédant ainsi aux Autochtones ce qu’on pourrait appeler « une victoire dans la course victimaire » : leur cause occulterait toutes les autres, car la mise en berne « permanente » du drapeau empêcherait toute autre commémoration sur la tour du Parlement canadien.
Trudeau s’était « peinturé dans le coin » avec sa mise en berne sans échéance et, avec le temps, les représentants autochtones ont interprété « une levée des drapeaux non pas comme un retour à la normale, mais comme une insulte » (Dumont).
L’Assemblée des Premières Nations (APN) en rajoutait le jeudi 4 novembre en réclamant que « l’unifolié soit hissé dimanche sur tous les bâtiments fédéraux aux côtés d’un drapeau orange portant la mention ’Chaque enfant compte’ » et « que les deux drapeaux, l’orange et l’unifolié, flottent côte à côte jusqu’à ce que toutes les dépouilles d’enfants soient récupérées et envoyées dans leur terre d’origine – physiquement ou symboliquement »… Heureusement, malgré cette proposition peu réaliste, Ottawa et ses partenaires autochtones ont annoncé le lendemain que la mort des enfants qui ont fréquenté les pensionnats serai rappelée autrement, ce qui a permis de relever le drapeau en vue de la commémoration de l’Armistice (https://ici.radio-canada.ca/rci/fr/nouvelle/1837591/chaque-enfant-compte-unifolie-jour-souvenir-pensionnats). L’exhumation des dépouilles d’enfants pose des problèmes techniques, légaux et scientifiques d’une telle ampleur qu’on ne peut imaginer le jour où elles auraient toutes été identifiées, à la grandeur du Canada et à la satisfaction de l’APN.
***
Comme l’écrivait Mario Dumont le 3 novembre (https://www.journaldemontreal.com/2021/11/03/relevez-ce-drapeau), « cette mise en berne permanente est un cul-de-sac. Oui, il fallait mettre les drapeaux en berne à l’époque pour souligner la tristesse et l’indignation collective devant des horreurs du passé. […]
Les millions de citoyens du Canada veulent une réconciliation, certes. Ils sont d’accord pour que leur gouvernement prenne des moyens pour assurer la réconciliation. Mais les citoyens du Canada ne vivent pas dans la honte en permanence. »