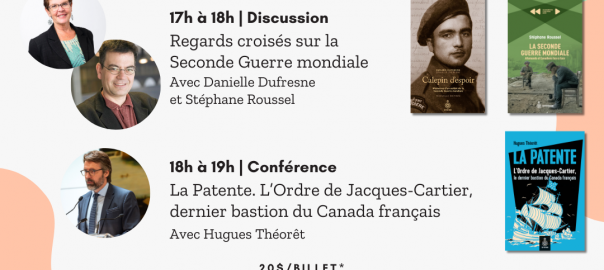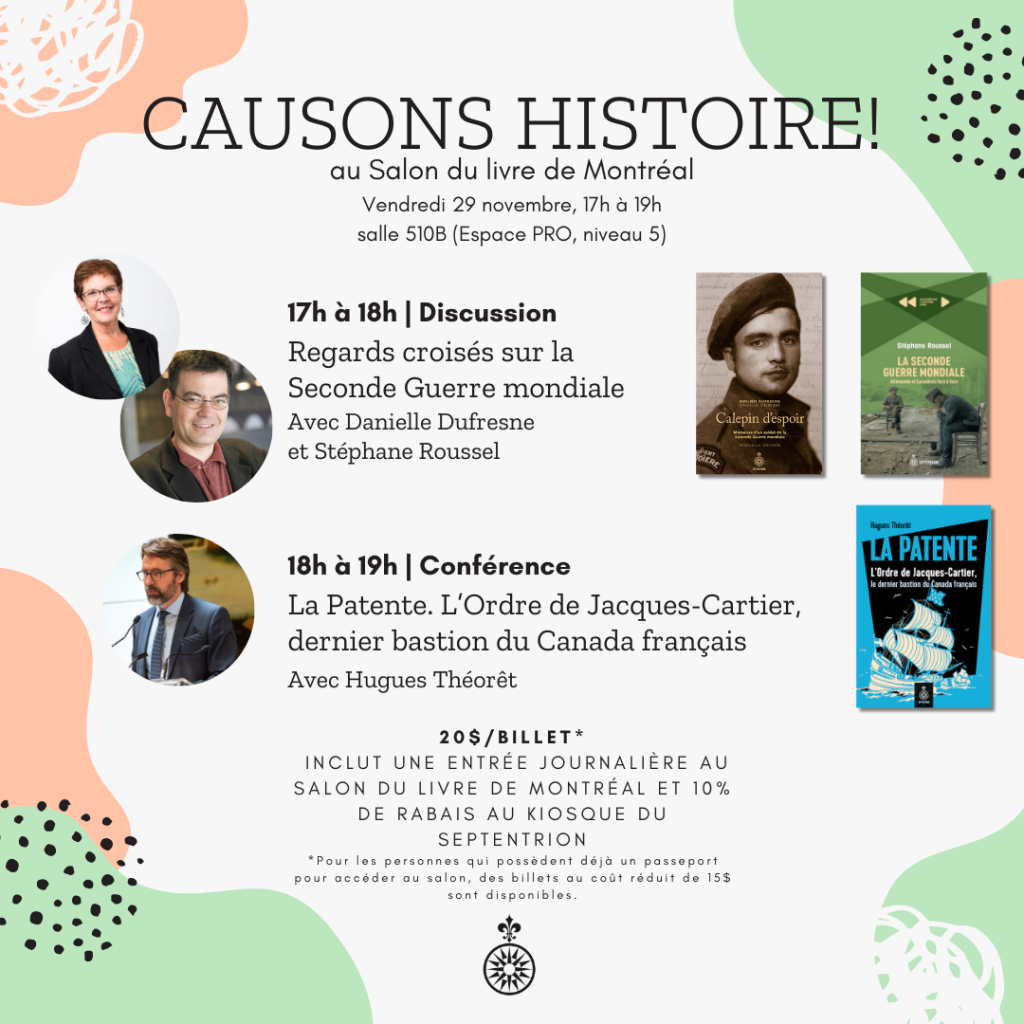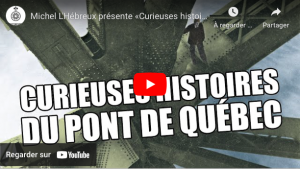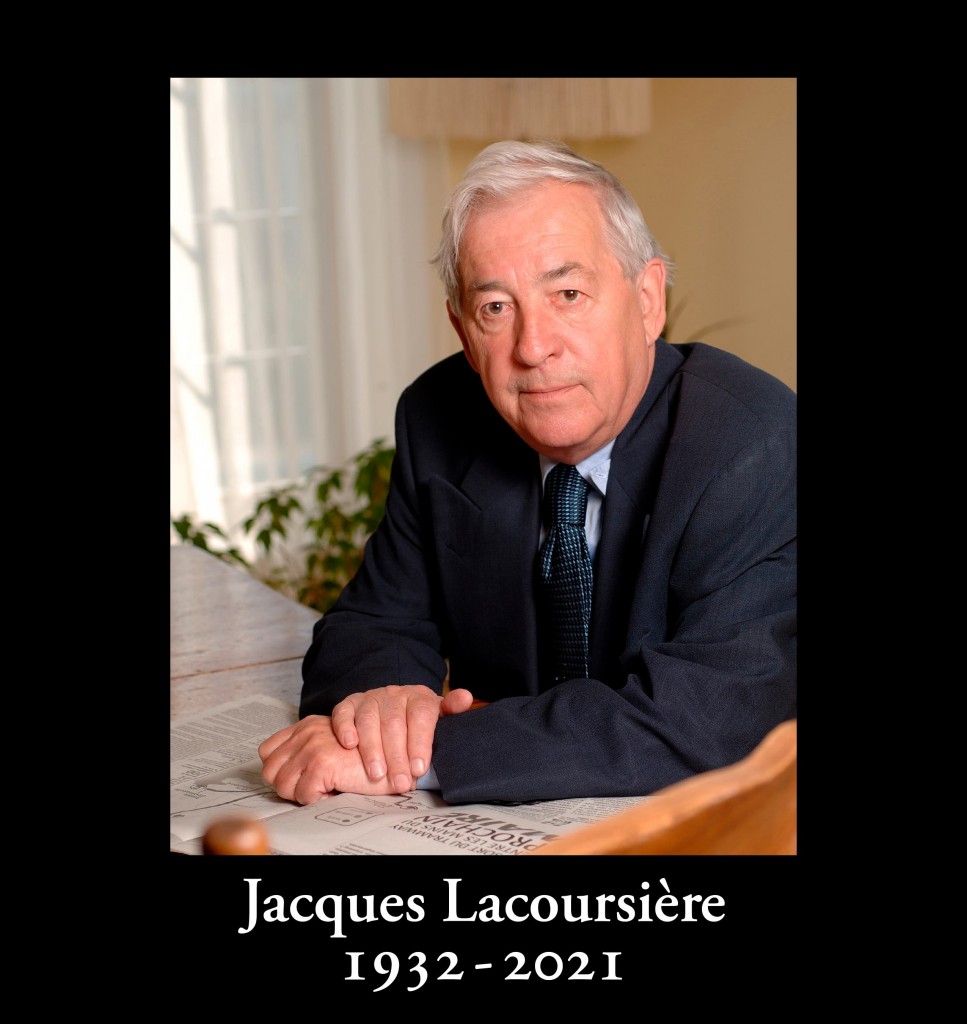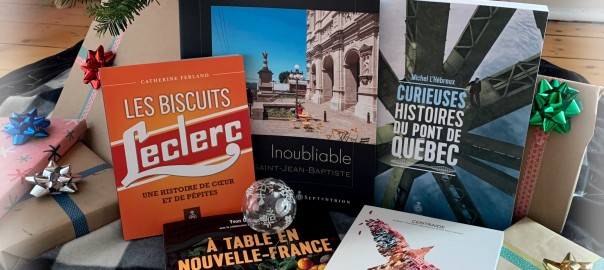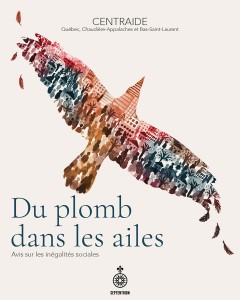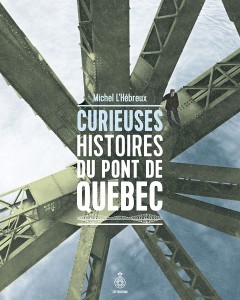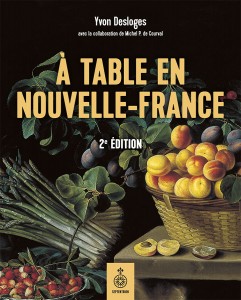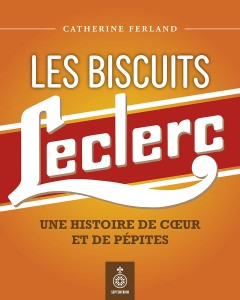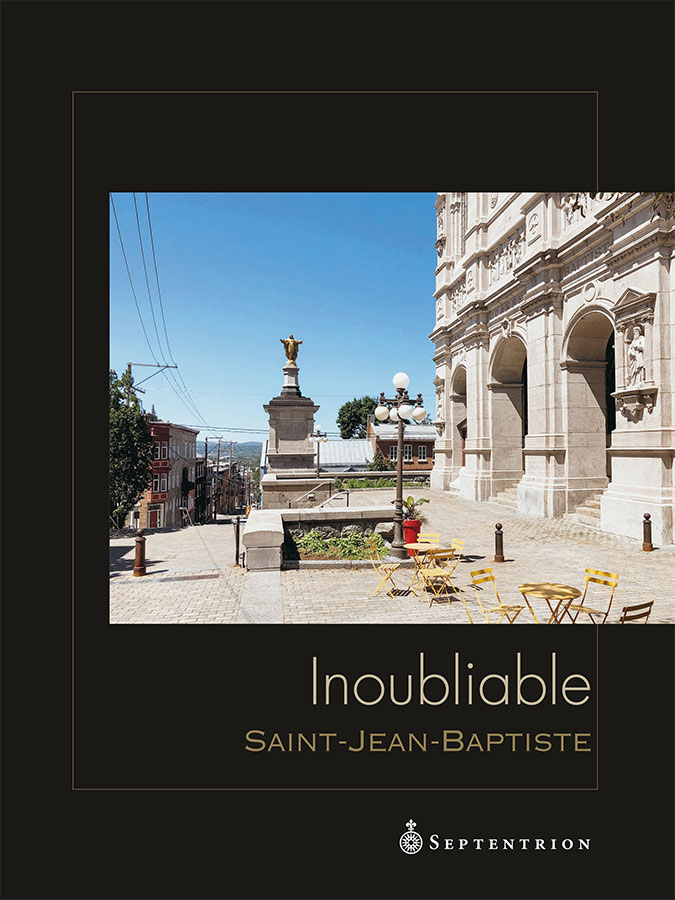Par Denis Vaugeois, le 24 mai 2023
«Le nouveau régime d’assurance automobile est entré en vigueur aujourd’hui» déclare Normand Harvey en présentant le bulletin de nouvelles de Radio-Canada du 1er mars 1978. «Dorénavant tous les résidents du Québec, qu’ils soient piétons ou conducteurs, seront indemnisés pour leurs dommages corporels et les pertes de revenus en découlant par la régie de l’assurance automobile.»
La loi de l’assurance automobile fut un grand moment pour Lise Payette, alors ministre des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières. Elle venait de réaliser une des plus importantes promesses du Parti québécois. Sanctionnée par «Sa Majesté» le 22 décembre 1977, cette loi qui compte 245 articles est entrée en vigueur par étapes, lesquelles s’échelonnent du 2 janvier jusqu’au 1er mars 1978.
Dans une émission d’Aujourd’hui l’histoire sur Radio-Canada, l’historien Jean-Charles Panneton rappelle que, avec la loi 101 et la loi de protection du territoire agricole, cette loi est une des plus importantes votées par le gouvernement du Parti québécois. Pour chacune d’elles, le Gouvernement dut affronter une forte opposition, mais madame Payette en retrouva une à l’endroit le plus inattendu. Lors de l’émission Tout le monde en parlait du 8 août 2006, elle a raconté l’accueil que lui a fait son sous-ministre: «La première chose qu’il me dit, c’est: “Je regrette beaucoup, Madame, mais nous ici on a déjà écrit 7 ou 8 projets de loi sur l’assurance automobile et on n’a pas l’intention d’en écrire un autre”». Lise Payette, estomaquée, l’aurait congédié sur-le-champ! Elle ne pouvait en faire autant avec ses collègues récalcitrants.
Dans ses mémoires, Le pouvoir? Connais pas! (Québec-Amérique, 1982), elle rappelle l’opposition de plusieurs d’entre eux qui voulaient «reporter la réforme de l’assurance automobile à un an, disait Marc-André Bédard, à deux ans, disait un autre, jusqu’à ce qu’on sache où on s’en va, disait un troisième». Marc-André Bédard et Bernard Landry affirmaient que cette loi entraînerait la perte du référendum et probablement une défaite aux élections suivantes. «Seul Lucien Lessard finit par dire que c’était ridicule, rappelle madame Payette (p. 50), qu’on était trop avancés et que le Bureau des véhicules automobiles, dont il avait alors la responsabilité comme ministre des Transports, était pratiquement prêt à fonctionner.» Monsieur Lévesque avait tranché : «On va de l’avant!»
Début mars 1978, un autre bulletin de nouvelles de Radio-Canada rappelle l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de l’assurance automobile. J’en ai retrouvé des extraits dans un important documentaire qui présente un survol de la carrière de Lise Payette. Intitulé Un peu plus haut, un peu plus loin, il a été réalisé en 2013-2014 par Jean-Claude Lord et Flavie Payette Renouf, la petite fille de Lise Payette. «Dans quelques jours, annonce l’animateur Normand Harvey, quelque 3 700 000 avis de renouvellement des plaques d’immatriculation pour les automobiles seront mis à la poste avec des dépliants d’information sur le nouveau régime d’assurance automobile.» Et Flavie Payette-Renouf ajoute : «C’est la naissance de la société d’assurance automobile du Québec, la SAAQ, et l’adoption d’une nouvelle plaque d’immatriculation sur laquelle elle fait écrire la devise du Québec Je me souviens.»
En somme, la même nouvelle est présentée deux fois dans le documentaire. On annonce d’abord de nouvelles plaques d’immatriculation, puis indirectement un nouveau régime d’assurance automobile, ensuite une voix féminine reprend l’information en soulignant la naissance d’une société d’assurance automobile, ce qui n’est pas exact, et de façon ambiguë annonce l’adoption d’une nouvelle plaque sur laquelle elle fait écrire la devise du Québec. «Elle»? La SAAQ ou madame Payette? La SAAQ n’existe pas encore et, de toute façon, il est difficile de ne pas comprendre que cette décision est attribuée à madame Payette. Depuis 1977, on l’a maintes et maintes fois répétée.
C’est Gisèle Tremblay qui part le bal. En effet, selon cette journaliste, dès les «100 premiers jours du gouvernement Lévesque», le chat serait sorti du sac : «Les plaques d’enregistrement des voitures n’évoqueront plus, en 1978, “La belle province”. On y lira : “Je me souviens.” La suggestion est de Mme Lise Payette. Après la victoire, raconte-t-elle, les gens lui disaient : “N’oubliez pas ceci, n’oubliez pas cela…” D’où l’idée de la devise. “Ma grand-mère disait, ajoute-t-elle : les Québécois, ce n’est pas le cœur qui leur manque, mais la mémoire!”» (L’Actualité, mars 1977).
Sur quoi se base la journaliste? Quelle est sa source? À quel moment cette suggestion est-elle faite? Et dans quel contexte? Madame Payette est ministre des consommateurs avec un mandat spécial pour réviser la loi d’assurance automobile. Elle a ce mandat depuis trois mois à peine. En priorité, pour écouter le cri du cœur de sa grand-mère, elle aurait décidé de faire modifier les plaques d’immatriculation. D’appeler à la rescousse la devise du Québec, Je me souviens.
Comme historien, je peux difficilement accepter ce scénario. En outre, je considère être responsable du sort réservé au slogan La belle province présent sur les plaques d’immatriculation à partir de 1963 et qui fut remplacé par la devise du Québec Je me souviens en 1978. Voici donc ma version des évènements qui vont finalement opposer, devant le tribunal de l’histoire, les ministres Lise Payette et Lucien Lessard.
Mon cheminement personnel
S’il y a une vie après la politique, il y en une également avant. La mienne consistait à défendre les intérêts du Québec à l’étranger. En septembre 1976, j’étais quelque part dans le vaste monde sans me douter que des élections auraient lieu à court terme. Trois ans auparavant, le gouvernement de Robert Bourassa avait fait élire 102 députés sur un total possible de 110. Pour plusieurs, c’était mon cas, ce résultat avait des allures d’une victoire à la Pyrrhus. Comment contrôler une telle majorité?
Comme directeur général des relations internationales, je représentais le Québec à l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) où nous avions le statut de gouvernement participant. Après avoir bien ferraillé, Yves Michaud, commissaire général à la coopération, obtenait que le Québec soit l’hôte des Jeux de la francophonie en 1974. Ce fut un énorme succès et les stratèges libéraux se mirent à en craindre l’effet. M. Bourassa semblait avoir perdu le contrôle de ses troupes.
Notre ministre, Gérard D. Lévesque, en avait vu d’autre. Il fallait laisser passer la tempête. Il me recommanda auprès de l’ACDI qui me proposa la direction de deux projets à l’étranger, l’un au Pérou, l’autre au Maroc où j’aurais la responsabilité de démarrer deux Centres pédagogiques régionaux (CPR), clés en mains. Je devais diriger leur construction à Safi et à Rabat. Surtout, je devais prévoir la formation des futurs enseignants, en organisant des stages et des échanges. C’était un merveilleux projet qui me convenait tout à fait tout comme celui au Pérou, où les cégeps québécois devaient servir de modèles.
Je suis un inconditionnel des agendas. J’en ai même créé un, nommé Memini (Je me souviens en latin), sur le modèle du Quo Vadis. J’ai devant moi mon exemplaire de l’année 1976.
Le 9 septembre, je prends un vol pour Casablanca. Le 10, je suis à Rabat où se trouve notre chef d’équipe, l’astrophysicien Marcel Sicotte, puis je décide de passer la fin de semaine à Marrakesh.
Le lundi 13, je suis à Safi où je constate que la guerre au Sahraoui affecte le déroulement de nos travaux de construction. Je reprends la route pour Rabat avec un arrêt à El Jadida. Le samedi 18 septembre, je quitte pour Francfort où se tient la foire du livre.
Le lundi 20, je me mets en route pour Strasbourg et Lausanne, puis je participe à trois jours de réunion de l’ACCT à Monte-Carlo; le samedi 25 je suis à Aix, le 26 à Lyon puis le 27 je mets le cap sur Paris où je retrouve les Milot, Denise et René, celui-ci en stage de formation au Musée d’Arts et Traditions populaires.
Le vendredi 1er octobre, je rentre à Montréal en première classe, faveur que me fait Air Canada en guise d’appréciation pour le pont aérien Montréal-Paris créé avec tous nos programmes de coopération franco-québécois. À 6 h, je suis chez moi à Québec. Des messages de l’exécutif du PQ de Trois-Rivières se sont accumulés. Des élections seront annoncées sous peu. Je ne le crois pas vraiment. On me propose d’être candidat. Je demande des rendez-vous à Jacques Parizeau et Claude Morin, dont j’ai édité Le Pouvoir québécois et Le Combat québécois, deux véritables best sellers.
La campagne électorale est déclenchée le 18 octobre. Le jour même, Réjean Séguin, un permanent du PQ, prend rendez-vous avec moi. Je deviens membre du PQ et, quelques jours plus tard, je suis désigné candidat sans opposition. Bernard Landry vient à Trois-Rivières, pour présider l’évènement et me confie à Réjean Séguin qui me dira quoi faire et quoi dire. Dès lors, ce dernier, très affable par ailleurs, a pris le contrôle de ma vie.
Le 15 novembre, me faufilant entre l’Union nationale et le Parti libéral, je suis élu député de Trois-Rivières. Les pages de Memini resteront blanches jusqu’au 26 novembre. Ce soir-là, je soupe Chez Nicolas avec des membres de l’exécutif trifluvien venus à Québec pour l’assermentation des membres du cabinet. Je reprends peu à peu le contrôle d’une partie de mon agenda. Je commence à faire la navette, Québec-Trois-Rivières. Tout va tellement vite et il y a tellement à faire.
Un premier caucus. Atterrissage plutôt brutal
Novembre 1976, une nouvelle vie commence. C’est dans l’excitation et l’indiscipline que, le 27 du même mois, débute un premier vrai caucus, inscrit dans mon agenda comme «réunion du PQ». Pour faire les choses correctement, les responsables nous remettent notre premier chèque de député. Un premier choc. À cause du montant? Oui un peu, mais surtout parce que ce chèque est émis par le Gouvernement de la Province de Québec.
Je tombe de haut, incrédule. «Province», ce mot n’est-il pas à proscrire? Oui et non. Ça dépend! Il faut en effet bien en comprendre le sens. Les fédéraux aiment utiliser ce mot pour bien marquer le statut d’infériorité politique du Québec.
Un jour, j’ai eu à préparer, avec l’historien Guy Frégault, un projet de lettre en réponse à celle reçue par Jean-Jacques Bertrand, adressée au premier ministre de la Province de Québec. Notre projet de réponse sera préparé à l’intention de Pierre E. Trudeau, premier ministre du Dominion du Canada. Les Britanniques ont longtemps désigné leurs territoires et possessions comme des dominions. M. Bertrand avait bien ri et signé sans hésitation. L’emploi du mot Dominion est disparu sauf dans «Fête du Dominion», tandis qu’au Québec le mot province est bien ancré dans la langue populaire et même dans le jargon administratif. Il fut un temps où le mot «provincial» en imposait, commandait le respect. C’était le cas de la Police provinciale avant qu’elle devienne la Sûreté du Québec.
Duplessis utilisait le mot provincial sur ton autoritaire, Lesage semble l’avoir vite écarté. Questionné à ce sujet, Claude Morin, un des principaux rédacteurs de discours du premier ministre de l’époque, me le confirme : «Ça fait des années qu’on utilise la formule Gouvernement du Québec. Province et provincial sont devenus des archaïsmes. On n’utilise plus Gouvernement de la Province de Québec. Province de Québec a rapidement cédé la place à État québécois ou État du Québec.»
Le caucus du 27 novembre se déroule sans ordre du jour. Je ne suis pas bien brave, mais la question me tient à cœur. Je demande la parole au whip : «Je veux intervenir sur le libellé de notre chèque de paie.» Jérôme Proulx a tout deviné. Je me lance : «Le libellé de nos chèques est une vraie provocation…» La plupart des députés n’ont rien remarqué. Certains cherchent leur chèque, fouillent dans leur poche. Des députés s’énervent : «Où veux-tu en venir?» Louis Bernard, l’éminence grise du PQ, a bien compris, mais il se montre impatient : «Si tu veux être payé, c’est comme ça!» Un autre lance : «Où est le problème?»
J’ai alors eu l’audace d’improviser un petit cours d’histoire 101 encouragé, si je me souviens bien, par Lucien Lessard, ancien professeur d’histoire, Gérald Godin qui avait été coéditeur de mon essai L’Union des deux Canadas. Nouvelle conquête? et par quelques autres comme Jérôme Proulx, Pierre de Bellefeuille, Jean-Pierre Charbonneau, etc. Monsieur Lévesque était ravi. Par la suite, il me dira parfois : «Aujourd’hui, un petit cours d’histoire ne serait pas de trop. Je compte sur vous.»
Le traité de Paris, 10 février 1763
(texte reconstitué à partir de mes notes)
Au lendemain du traité Paris signé le 10 février 1763, par lequel la France cède le Canada à l’Angleterre, Londres avait entrepris d’organiser ses nouvelles conquêtes. Le 13 août 1763, le comte d’Egremont, secrétaire d’État aux affaires coloniales, annonce à James Murray que Sa Majesté veut lui confier «le gouvernement du Canada». Mais Londres devait aussi nommer des gouverneurs pour la Floride orientale, la Floride occidentale. Grenade et la Nouvelle-Écosse. Finalement, le 14 novembre 1763, George III désignait James Murray «capitaine général et gouverneur en chef de la province de Québec», cette commission étant enregistrée le 28 novembre 1763. L’expression «province de Québec» faisait son entrée dans l’histoire. Pour les historiens de l’école de Montréal, c’était la marque du conquérant.
Dans la brochure No 3 de la Société historique du Canada, l’historien Guy Frégault parlant de l’empire français et de la Nouvelle-France résume froidement la situation : «Celui-ci disparaît de l’Amérique et celle-ci s’efface de la carte. En 1760-1763, le Canada n’est pas simplement conquis, puis cédé à l’Angleterre; il est défait. Défaite signifie désintégration. Une armée subit la défaite : il peut rester encore des soldats. Il ne reste plus d’armée. En 1763, il reste encore des Canadiens, il ne reste plus de Canada» (p. 15). Bref, une nouvelle colonie britannique vient de voir le jour en Amérique du Nord, c’est la province de Québec.
Londres a son plan qui sera longuement décrit dans une première constitution qui prend la forme d’une Proclamation royale. Les frontières de la «Province de Québec» sont limitées, en 1763, aux terres colonisées de la vallée du Saint-Laurent et de la rive nord de la baie des Chaleurs. Les autres territoires de l’Amérique du Nord sont réservés aux Autochtones placés sous tutelle britannique.
À noter que les Îles-de-la-Madeleine, Anticosti et la côte du Labrador sont annexées au gouvernement de Terre-Neuve. De plus, l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard) et le Cap-Breton sont rattachés à la province de la Nouvelle-Écosse formée en 1758. Celle-ci était déjà dans la mire des Treize Colonies établies sur la façade atlantique. Elle devient la 14e colonie. Son annexion permet à l’Angleterre de prolonger son expansion coloniale jusqu’aux riches bancs de morue convoités depuis les débuts de la colonisation européenne. C’est aussi le signal de la déportation des deux tiers de la population acadienne évaluée à environ 18 000 habitants.
La Province de Québec devient pour sa part une 15e colonie anglaise; ses limites seront grandement élargies avec l’Acte de Québec de 1774, à l’est jusqu’au Labrador et à l’ouest bien au delà des Grands Lacs pour rejoindre le confluent de l’Ohio et du Mississippi. Cette forte expansion territoriale est tout à fait intolérable pour les Treize Colonies d’origine. Elle conduit à la révolution américaine. L’Amérique du Nord se divise en deux : une Amérique républicaine au sud et une Amérique britannique au nord. En 1791, la «Province de Québec» sera elle-même partagée en deux parties pour donner naissance à deux Canadas, le Bas-Canada qu’on associe historiquement à l’ancienne Province de Québec, à cause de sa population d’origine française et leCanadaCanada, territoire à l’ouest de la rivière Outaouais.
Une «Province de Québec» va renaître de ses cendres en 1867 avec l’Acte de l’Amérique britannique du Nord. Une province parmi quatre, puis dix aujourd’hui, auxquelles il faut ajouter trois territoires fédéraux.
Étymologiquement et historiquement, pour les péquistes bon teint, le mot province (pro vincere) est associée à la subdivision, la subordination, voire à la défaite. Assez curieusement, les services de la trésorerie de l’Assemblée nationale n’avaient pas vu passer le train. Leur libellé, «gouvernement de la province», avait des allures d’artefact. Tout en maugréant, Louis Bernard avait bien compris le message. La modification ne tarda pas.
Restait le problème du mot «province» sur les plaques d’immatriculation. Mon intervention au caucus visait strictement le libellé présent sur nos chèques, mais à la vérité j’avais comme préoccupation d’éviter le plus possible le mot province, fut-ce avec un sympathique slogan, tel la «belle province». J’ai une expérience personnelle à raconter à cet égard.
En Europe avec une plaque du Québec
En 1968-1969, j’avais été happé par de nouveaux défis. Marcel Masse, nouveau ministre des Affaires intergouvernementales, ne m’avait guère laissé le choix. Il me demanda de devenir son chef de cabinet. J’avais déjà passablement quitté le champ de l’histoire en acceptant de devenir codirecteur du Centre franco-québécois de développement pédagogique, mon passage au cabinet me conduit rapidement à la direction générale des relations internationales. Au lieu de faire Québec-Montréal, semaine après semaine, je ferais Montréal-Paris. J’adopte le modeste Hôtel de l’Observatoire puis l’Hôtel de Suez, j’ouvre un compte à la succursale de la Banque nationale, rue de Rivoli, puis je décide de m’acheter une voiture. J’opte pour une Peugeot 404 et fait émettre une plaque en TT (hors taxe). Mon ami le géographe Henri Dorion qui sillonne l’Europe avec une Westfalia avait finalement troqué sa plaque TT pour une plaque d’immatriculation du Québec. Je décide de l’imiter et par précaution je prends conseil auprès de mon ami Paul Berthiaume, adjoint parlementaire du ministre des Transports. Sans trop de difficultés, je fais émettre une plaque d’immatriculation pour ma 404 qui est à Paris. Je me présente au bureau des licences à Québec avec mes papiers d’acquisition et on ne me demande pas où est ma voiture. Je glisse mes deux nouvelles plaques dans ma valise.
Je me souviens très bien du jour où je les ai fixées sur ma 404. Celle-ci est garée sur la rue en face des bureaux de l’Agence de coopération culturelle et technique où je participe à une réunion comme délégué du Gouvernement du Québec. Pendant une pause-café, je demande à Gérard Fayolle, un fonctionnaire de l’Agence, de trouver un tournevis et nous nous dirigeons vers ma voiture.
Je suis accroupi à l’arrière pour enlever la plaque qui s’y trouve quand Gérard me fait : «Oups! On va avoir un petit problème». Deux motards de la police se rangent près de moi, l’air sévère. Je suis pris en flagrant délit. En France, les plaques sont permanentes. J’essaie d’expliquer à l’agent que la voiture m’appartient. Il accepte de me suivre à l’intérieur, fait des vérifications et quelques appels. Rapidement, l’air dépité, il se tourne vers moi : «Tout est en ordre. Vous êtes libre».
Cette voiture m’a donné toutes sortes d’émotions. Fréquemment, quand je revenais vers ma 404, je trouvais dans le pare-brise une enveloppe : «Salut cher Québécois! J’ai vu ta “licence”! La belle province! Oui il est beau notre Québec. Et bla bla.» Parfois ça se terminait par une invitation à prendre un pot.
Promotion touristique vs assurance automobile
«La belle province!» C’est vrai que ce slogan avait son charme. Robert Prévost, responsable du tourisme, l’adorait. Il jubilait quand il fut décidé de le mettre sur les plaques d’immatriculation.
«La belle province, écrit-il dans Trois siècles de Tourisme au Québec (Septentrion, 2000, p. 200), devint si populaire que les touristes des États-Unis se plaisaient à l’insérer dans leurs échanges avec les gens du cru. Plus tard [1963], on retrouva la formule sur les plaques d’immatriculation de nos voitures. Mais avec les années, le mot province dérangeait à mesure que se répandait la conviction que le Québec était plutôt un État».
Robert Prévost avait su vendre La belle province mais il rêvait aussi d’un Québec maître de son destin. Homme d’une vaste culture, il était de ceux qui savaient se souvenir de celles et ceux qui avaient marché, reconnu, exploré et nommé la majeure partie de l’Amérique du Nord. Au moment de sa retraite, il publiera un ouvrage très original intitulé Mémorial de Canadiens français aux U.S.A. (Septentrion, 2003), référence qui me ramène au député-historien qui, en novembre 1976, examine incrédule ce chèque reçu en tant que parlementaire péquiste et émis, je le répète, par le Gouvernement de la Province de Québec.
Je me souviens
L’historien Gaston Deschênes me parlait souvent des débats entourant les origines de la devise du Québec, Je me souviens. J’en avais fait le nom d’un agenda à caractère historique en utilisant le mot latin, Memini, en souvenir de mon merveilleux professeur de latin Jan De Groot.
La promotion de Memini se fit avec le journal indépendantiste Le Jour qu’avait lancé mon ancien patron Yves Michaud. Les profits étaient remis au Journal. Lors de ce premier caucus, face aux députés nouvellement élus sous l’étiquette péquiste et certainement des lecteurs du Jour, je me disais qu’ils connaissaient forcément l’agenda Memini/Je me souviens. «Pourquoi ne pas inscrire cette devise sur les plaques?», ai-je lancé à la suite de mon laïus sur le mot province. J’improvisais. Je n’avais pas prévu faire une telle suggestion.
Lucien Lessard, l’historien, me seconda sans hésiter. Sans doute qu’il connaîssait Memini. Madame Payette approuva également en insistant sur l’importance de la mémoire. Elle fut tout naturellement éloquente. Elle était une vedette indépendantiste, auréolée par ses succès l’année précédente à la tête de la fête nationale. Sa victoire dans Dorion avait provoqué un vrai délire et les députés étaient fort impressionnés de la retrouver parmi eux. Ils le lui firent savoir par de chaleureux applaudissements, tellement qu’elle se convainquit peut-être que son intervention avait fait la différence.
Madame Lise Payette a plusieurs fois affirmé qu’elle était «la ministre qui a fait mettre “Je me souviens” sur les plaques d’immatriculation». Et on l’a répété un peu partout. Avec les années, elle a étoffé ses explications comme on peut le constater lors d’une entrevue qu’elle donne au journaliste Claude Saucier, le 1er mars 1999 dans le cadre de l’émission La vraie vie.
Saucier apparaît à l’écran en montrant à la caméra une plaque du Québec de 1979 et innocemment lance :
Claude Saucier: «En conclusion de cette émission sur la mémoire, j’ai une plaque à vous montrer, qui est la plaque d’immatriculation du Québec avec inscrit en dessous « Je me souviens ». C’est ça, hein? Lise Payette, c’est vous qui êtes à l’origine de cette plaque.»
Lise Payette : «Ben oui, c’est moi qui suis à l’origine de ça parce que à un moment donné, il a été question de changer le slogan habituel qui était « La belle province ». Ça plaisait pas évidemment au gouvernement du Parti québécois qui souhaitait [être] un bel État, mais pas nécessairement une province. Et on a cherché par quoi remplacer ça. C’est à une réunion des députés où la question a été soumise à tout le monde en disant « on cherche une idée et on est pressés » parce que fallait que ça soit réglé en quelques jours. [Alors] j’ai dit? Il me semble que « Je me souviens », il y a plus personne qui sait que c’est la devise du Québec, un, on commence comme ça…»
C.S. : «C’était la devise. Ce l’était déjà?»
L.P. : «Ça va nous… C’est la devise du Québec depuis toujours. Donc, ça va nous rafraîchir la mémoire. « Je me souviens », quand on vient d’être réélu comme gouvernement, c’est une sacrée bonne idée de se souvenir de ce qu’on a promis. Et je trouvais que ça aidait ce peuple sans mémoire que nous sommes. C’est-à-dire juste le voir se promener, voir ce slogan se promener sur toutes les voitures, il me semble qu’il devrait nous rappeler d’où on vient, qui on est, tout ça, mais Dieu que ça nous manque.»
Cette entrevue a lieu en 1999, soit plus de vingt ans après le changement d’inscription qui s’est fait en 1978, mais en se promenant sur Internet on découvre avec surprise que ce que raconte madame Payette à Claude Saucier en 1999, elle le répète ou d’autres le répètent pour elle à plusieurs reprises.
Elle a une fixation sur les plaques d’immatriculation et semble oublier son triomphe avec sa loi «sans égard à la faute», le fameux No Fault. Jean P. Vézina qui fut un des grands patrons de la SAAQ a hérité du coup de force réalisé par le gouvernement Lévesque et «surtout sa ministre des institutions financières, Mme Lise Payette».
Le régime de l’assurance automobile du Québec, conclut Vézina (La Fonction publique malmenée, Septentrion, p. 83), est considéré comme l’un des deux ou trois régimes les meilleurs au monde. De gouffre financier et fouillis administratif, l’ensemble de ce secteur affiche à partir de 1992, une réserve actuarielle de près de quatre milliards (p. 84). Voilà un héritage issu du travail et de la détermination de madame Payette qui, assez curieusement, semble toutefois plus à l’aise pour commenter, ou même s’approprier, le changement effectué par son collègue du ministère des Transports. Nous y voici.
Moins de trois semaines ont suffi à Lucien Lessard
Grâce au blogue de Gaston Deschênes, je sais que, dès le 15 décembre 1976, Lucien a annoncé par communiqué le changement d’inscriptions sur les plaques. Plusieurs journaux ont réagi. Je retiens l’article de La Presse du 16 décembre 1976.
QUÉBEC – La devise du Québec «Je me souviens» remplacera l’expression «La belle province» sur les plaques d’immatriculation des véhicules en 1978.
Ainsi en a décidé le ministre des Transports, M. Lucien Lessard, qui a fait connaître sa décision dans un bref communiqué. M. Lessard dévoile du même coup que les plaques de l’an prochain seront de couleur beige avec lettres et chiffres de couleur marron mais le communiqué ministériel précise que le choix de ces couleurs a été fait par l’ancien ministre des Transports, M. Raymond Mailloux.
Quant à la devise «Je me souviens», M. Lessard estime qu’elle collera plus à la réalité québécoise que l’inscription «La belle province» choisie en 1963 «et qui apparaissait à d’aucuns comme un calque et une traduction des plaques américaines».
Le Quotidien du Saguenay, Le Nouvelliste, Le Soleil et le Sherbrooke Record emploient sensiblement les mêmes mots avec des variantes concernant le choix des couleurs. J’y reviendrai plus loin dans ce texte.
Lucien Lessard était terriblement efficace. Comme ministre des Affaires culturelles, j’en ai souvent fait l’expérience. Un cas parmi plusieurs. Un jour, je reviens de Trois-Rivières par la 138. La circulation ralentit. On est en train d’abattre de magnifiques arbres près de Batiscan. Je m’informe. «Ordre du ministre!», me lance un travailleur. Rapidement, j’ai Lucien au bout du fil. Lui aussi adore cette route historique. On convient tous les deux que le Chemin du Roy sera d’ici peu, étant donné les travaux en cours sur la 40, une superbe route touristique qu’il faut «chouchouter» pour reprendre une expression de Lise Payette. Peu après, je circule sur la même route dans la même direction et nous devons freiner brusquement. Une longue rangée d’arbres a été conservée… «Cré, Lucien!»
Entre le caucus de fin novembre et le 15 décembre 1976, il y a eu trois conseils des ministres. L’un le 1erdécembre, un autre le 8 et un troisième le 15. Le 8, il est question des plaques d’immatriculation. Eureka! Ce n’est pas plus compliqué que ça. BANQ a des outils de recherche de plus en plus performants. Merci à Rénald Lessard qui m’apprend à m’en servir.
Sauf que, lors du conseil du 8, Lucien évite de parler du changement qu’il a à l’esprit.»Le ministre des Transports, peut-on lire dans le procès-verbal, expose à ses collègues le mode de nomination qui existait sous le gouvernement précédent en ce qui concerne les émetteurs de plaques d’immatriculation. Il explique à ses collègues que ce mode de nomination était basé sur le favoritisme et il considère qu’on devrait y mettre fin dans les meilleurs délais.
Après discussion, le Conseil demande au ministre des Transports de lui soumettre d’ici le 15 janvier 1977, un mémoire visant à modifier le mode de nomination des émetteurs de plaques d’immatriculation.
Député depuis 1970, Lucien en avait vu de toutes les couleurs. Il était de notoriété publique que l’émission des plaques était un chef-d’œuvre de combines et de favoritisme. Le 8 décembre, les ministres s’inquiètent de la nomination des membres du comité qui accorde les contrats, rien d’autre, mais, de toute évidence, Lucien a l’esprit ailleurs.
Dès le début de décembre 1976, il en savait assez pour prendre sur lui la décision contenue dans son communiqué du 15 décembre. Le code de la route est précis à ce sujet. Le chapitre 231 accorde au directeur du Bureau des véhicules automobiles (BVA) la responsabilité des plaques d’immatriculation sous la responsabilité du ministre des Transports. Ce n’était surtout pas un secret pour Gaston Deschênes, ancien directeur de la recherche à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale. Il le mentionne au passage dans son blogue.
L’article 4 est clair : «Un service pour l’immatriculation des véhicules automobiles et la délivrance des permis est constitué au ministère des Transports et Communications, sous le nom de Bureau des véhicules automobiles Le directeur administre et dirige le Bureau, sous l’autorité du ministre et sous la surveillance du ministre du revenu en ce qui concerne la perception des droits exigibles.»
Le directeur du BVA, Ghislain K. Laflamme, est tout un personnage. Lucien et moi, nous l’apprendrons pendant notre mandat comme membres du Conseil du trésor. Et lui apprendra à nous connaître, en particulier lors de discussions sur la réduction des effectifs et la lourdeur de la gestion des points d’inaptitude.
Les ministères avaient reçu instruction de réduire leurs effectifs pour faire face au déficit appréhendé. Le BVA demanda plutôt une augmentation assortie d’arguments. Finalement, je proposai innocemment de ramener tous les dossiers de points d’inaptitude à zéro. Évidemment, aucune plainte n’était à prévoir et le BVA pourrait redémarrer en connaissance de cause. Quelques mois plus tard, le BVA revenait à la charge. Je me préparais à leur tenir tête quand M. Parizeau, avec un grand sourire, fit non du doigt. «M. Vaugeois, on m’a informé que vous aviez à votre dossier plusieurs points d’inaptitude. Je regrette mais vous êtes en conflit d’intérêt».
Le 26 novembre 1976, Lucien Lessard s’était vu confier deux ministères, les Travaux publics et les Transports. Il savait qu’il ne garderait pas longtemps les deux. Pendant six ans député de l’opposition, il avait eu le temps de s’en promettre pour le jour où il serait au pouvoir.
En sortant du caucus de novembre, il était bien décidé. Il agirait rapidement. Hugues Morrissette était-il déjà sous-ministre ou sous-ministre adjoint aux Transports? Si oui, il était lui-même synonyme d’efficacité. Comment régler la question des plaques d’immatriculation? Tout simplement en convaincant Ghislain K. Laflamme, le tout puissant directeur du BVA. Lucien prit ses précautions. Le 1er décembre, il observa le fonctionnement du conseil des ministres. Son premier. De toute façon, il n’était pas prêt ce jour-là à proposer un changement de plaques. On peut supposer qu’il voulait au préalable consulter le bureau du premier ministre, en parler avec quelques ministres et se faire clairement expliquer la procédure à suivre.
Le 8, il se concentra donc sur «la nomination des émetteurs de plaques» et jugea que ceux-ci seraient plus occupés à sauver leur poste qu’à défendre un slogan. Le 15, il était prêt à émettre un communiqué de presse à l’allure assez inoffensive prenant même la précaution de ménager la décision de son prédécesseur, l’ex-ministre Raymond Mailloux, quant aux couleurs des prochaines plaques, beige et marron. S’il y eut discussion au conseil des ministres, il n’en est resté aucune trace. Voilà bien un des paradoxes de l’administration publique, une décision qui affecte tout monde et qui passe comme du beurre dans la poêle. Quant au code de la route, il appartient à l’univers de la législation déléguée et échappe à l’œil des élus. C’est un cas extrême.
Le changement de plaques proposé par Lucien Lessard passa d’abord un peu inaperçu. Chaque journal se limita à quelques lignes. Les voici.
La belle province disparaît
QUEBEC (PC) – Les mots «La belle province» seront remplacés en 1978 sur les plaques d’immatriculation par la devise «Je me souviens».
Ce changement a été apporté à la demande du ministre des Transports Lucien Lessard, qui a cependant respecté le choix des couleurs – marron sur fond beige – fait par l’ex-ministre Raymond Mailloux.
Le Quotidien du Saguenay–Lac-St-Jean, 16 décembre 1976
«Je me souviens» remplacera «La belle province»
QUEBEC – «Je me souviens». Telle est l’inscription qui apparaîtra en 1978 sur les plaques d’immatriculation du Québec, à la demande du ministre des Transports du Québec, Monsieur Lucien Lessard.
En effet, si le choix de la couleur des plaques, soit marron sur fond beige, revenait à monsieur Mailloux, l’ex-ministre des Transports, Monsieur Lessard s’est réservé le droit de remplacer l’ancienne inscription par la devise de la province de Québec.
Nul doute que cette nouvelle inscription collera beaucoup plus à la réalité québécoise que «La belle province» choisie en 1963 qui apparaissait à d’aucuns, comme un calque et une traduction des plaques américaines.
Le Nouvelliste, 16 décembre 1976
« Je me souviens » to replace « La Belle province »
QUEBEC (CP) – Quebec drivers will no longer be identified as coming from the beautiful province.
“La Belle Province”, the motto which appears on current licence plates, is to be dropped in favor of “Je Me Souviens” – I Remember – Transport Minister Lucien Lessard announced Wednesday.
In addition to replacing the provincial connotation, the new phrase evokes for Quebec nationalists the three centuries of French presence in North America.
“No doubt this inscription will adhere more closely to the Quebec reality than ‘La Belle Province’, which appeared to some as a copy and translation of American plates”, said Mr. Lessard.
The Sherbrooke record, 16 décembre 1976
C’est toutefois Pierre Beaudry, chroniqueur de La Presse, qui afficha clairement un réel enthousiasme la veille du Jour de l’an 1977.
Les maux de notre langue. Bravo et merci!
Qu’on me permettre de féliciter et remercier notre nouveau gouvernement de nous avoir offert pour les fêtes non pas un mais deux magnifiques cadeaux.
Le premier : à l’Assemblée Nationale, il n’est plus question de frapper les pupitres de la main en guise d’approbation, coutume anglaise si jamais il en fût. Désormais, on agira à la française, c’est-à-dire en applaudissant. Même s’il ne s’agit pas d’une question de mots, cette décision n’en est pas moins reliée à la langue : on ne le dira jamais assez, celle-ci n’est pas uniquement un mode d’expression, elle est avant tout le reflet d’une civilisation, d’une culture, bref d’un mode de vie. Et chaque fois que les Québécois s’habituent à un usage d’origine anglo-saxonne ils perdent d’autant leur qualité française. D’où l’importance de réagir comme l’a fait notre gouvernement.
Le second “cadeau” est encore plus réjouissant, car alors c’est vraiment l’esprit français qui a triomphé sur une expression d’inspiration anglaise représentant une imposition plus que centenaire. Je veux parler de l’annonce de l’élimination, dès 1978, de l’insipide slogan “La belle province” qui dépare nos plaques d’immatriculation automobiles depuis plus de 15 ans, malgré les nombreuses protestations de personnes s’intéressant à la langue, dont votre humble serviteur. J’ai consacré à ce problème mes chroniques des 22 janvier et 5 décembre 1973 et 22 janvier 1975. Dans ces deux dernières, je ne faisais que répéter la première, tant je me trouvais incapable d’apporter d’autres précisions.
Et voilà donc que la bataille est gagnée. Le français a triomphé. Comme toujours, ainsi qu’en témoigne notre évolution linguistique des 15 dernières années. Car en français le mot province n’a pas le sens que lui donne l’anglais et est plutôt synonyme de “colonies”, ce qui rend son emploi pour désigner le Québec, même sous l’actuel régime constitutionnel, aussi faux qu’humiliant.
La Presse, 31 décembre 1976.
Et Beaudry conclut en rappelant «à quel point il est facile de se corriger, quand on veut».
L’affrontement entre Payette et Lessard
Lise Payette et Lucien Lessard quittent la politique en 1981 et 1982. En réalité, il ne la quitte pas vraiment. La politique continue de les habiter. La télésérie sur René Lévesque, diffusée en 2008, dans laquelle joue Emmanuel Bilodeau leur déplaît dans l’ensemble, mais aussi sur le plan personnel. Madame Payette s’attribue le choix de la devise Je me souviensde même que Lucien Lessard. Dans Le Soleil du 4 août 2008, Gilbert Lavoie le raconte sous le titre «La grogne monte chez Lessard et Payette.» Dans la série télévisée, on fait dire à Lise Payette que c’est sa mère qui est à l’origine de cette inscription sur les plaques et moqueur, Lucien Lessard rétorque: «Je n’ai pas souvenance que Lise Payette ait fait suspendre le conseil des ministres pour nous parler de sa mère.»
Madame Payette réagit et «nie avoir été inspirée par sa mère mais elle confirme avoir été à l’origine de ce changement susceptible d’empêcher les politiciens d’oublier leurs promesses». Elle l’avait dit à Saucier : elle a de la suite dans les idées. En 1977, Gisèle Tremblay lui faisait dire : “Ma grand-mère disait, ajoute-t-elle : les Québécois, ce n’est pas le cœur qui leur manque, mais la mémoire!” La grand-mère est devenue la mère, mais Lise Payette ne lâche pas le morceau. Lessard fulmine.
Rien à faire, une réelle confusion persiste. Le 6 décembre 2018, soit le lendemain de son décès, le télé-journal de Radio-Canada lui consacre plus de trois minutes sous le titre «Retour sur la vie de Lise Payette».
La journaliste Solveig Miller rappelle : «Contre vents et marées, elle crée l’assurance-automobile. [Pause] C’est elle qui fait inscrire la devise du Québec je me souviens sur les plaques d’automobile.» Encore une fois, apparaissent une photo de Madame Payette et une plaque de 1978. Pour elle, le «je me souviens» était là pour «nous rappeler d’où on vient, qui on est».
À Jean-François Lisée qui s’étonnait de son intérêt pour Pax Plante, le justicier montréalais, elle avait répondu : «Je suis la ministre qui a fait mettre « Je me souviens » sur les plaques automobiles, car je crois que si on ne connaît pas l’histoire, on refait les mêmes erreurs. Hélas! On n’a pas de mémoire.» (L’Actualité, février 1992)
Dans la première édition de Femmes d’honneur (3e tome, octobre 1999), après s’être demandé si les gens se souvenaient que Trudeau avait mis son siège en jeu pendant la campagne référendaire, elle ajoute : «J’étais celle qui avait suggéré qu’on mît la devise du Québec sur les plaques d’immatriculation en remplacement de la belle province. J’espérais que la mémoire nous reviendrait. Il n’en fut rien.»
Au moment de la réédition en 2014, le ton est plus ferme, elle se fait plus mordante: «J’avais réussi pendant que j’étais en politique à faire graver notre devise sur les plaques automobiles. Le « Je me souviens » allait peut-être nous donner envie de fouiller tout notre passé pour nous donner des repères…»
«J’avais réussi», écrit-elle. Et par précaution, elle ne se contente pas de «faire mettre», mais bien de «faire graver». Malicieusement, je pourrais ajouter : elle avait surtout réussi à se convaincre d’être responsable du changement.
En préface, Josée Boileau, de sa plus belle plume, écrit : «C’est à elle qu’on doit cette transformation si puissamment symbolique de nos plaques d’immatriculation : le “je me souviens” agissant qui a délogé le bonasse “la belle province”.»
Au moment de mes entrevues avec John Grant destinées à Mémoires de député, je viens près moi aussi de tomber dans le panneau : «Dans les échanges avec des députés, un peu par provocation, je lance on pourrait mettre memini/ je me souviens sur les plaques. Madame Payette…elle a allumé. Elle fait Ah! Elle était à l’assurance automobile. Alors c’est devenu ça.» (2e partie, 3:10) Je le raconte ainsi et c’est maladroit. C’est un épisode vieux de plus de 40 ans, je fais spontanément un lien entre la loi d’assurance automobile, qui est le grand fait d’arme de Lise Payette, et le changement sur les plaques. Après coup, je me rends compte de la confusion que j’engendre. Cette entrevue est du 19 février 2017. Je profite des Entretiens avec Stéphane Savard (Boréal, 2019, p. 201) pour préciser que «c’est Lucien qui s’est chargé du changement en tant que ministre des Transports».
Point final.